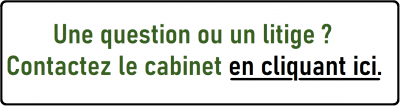- Accueil
- Blog
Blog
Le 09/05/2022
Par un arrêt n° 19DA01886 du 5 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Douai rappelle dans quelles conditions les capacités d’accueil en master et les modalités d’admission en master entrent en vigueur et peuvent donc permettre de justifier un refus d’admission en master.
● Dans le cadre de la sélection à l’entrée en master 1 ou, par dérogation, en master 2 (voir sur ce point l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective), les capacités d’accueil et les modalités d’admission présentent une importance particulière.
En effet, pour pouvoir opposer un refus d’admission fondé sur une sélection des candidatures, il est nécessaire que :
- Les capacités d’accueil aient été atteintes,
- Les modalités de sélection pour l’admission en master aient été respectées.
C’est ce qui explique que dans les recours contre les refus d’admissions en master, ces points soient âprement débattus par les universités, les étudiants et leurs avocats.
● Dans l’arrêt commenté, la cour rappelle que pour être opposables, les délibérations fixant les capacités d’accueil et les modalités d’admission en master doivent :
- Avoir été régulièrement publiées.
Ce point est assez classique dans la mesure où, pour entrer en vigueur, tous les actes administratifs réglementaire doivent avoir été préalablement publiés (article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration).
Tel est notamment le cas des actes réglementaires des universités (voir, par exemple : CAA Paris, 8 octobre 2021, n° 19PA02717 ; TA Montreuil, 17 avril 2018, M. Julien C, n°1710666 ; TA Melun, 5 février 2021 M. Ameziane A, n° 1910503).
Dans l’arrêt commenté, la cour rappelle que les capacités d’accueil en master et les modalités d’admission en master doivent avoir été publiées pour être opposables.
A défaut, elles ne peuvent justifier un refus d’admission en master.
- Avoir été transmises au recteur.
Il s’agit là d’un point particulier, spécifique aux décisions réglementaires des universités.
En effet, celles-ci doivent avoir été transmises au rectorat de la région académique pour entrer en vigueur (article L. 719-7 du code de l’éducation).
Sans cette transmissions, l’acte n’entre pas en vigueur et ne peut donc être opposé, notamment à l’occasion d’un refus d’admission en master.
C’est ce que juge ici la cour administrative d’appel de Douai en cohérence avec la jurisprudence d’autres cours administratives d’appel (voir, dans le même sens : CAA Paris, 21 septembre 2021, n° 20PA03428 à propos d’un ajournement) et du libellé de l’article L. 719-7 du code de l’éducation.
Ainsi, ce n’est que dans l’hypothèse où les capacités d’accueil et modalités d’admission ont été régulièrement adoptées, publiées et transmises au recteur de la région académique avant que la décision soit prise qu’elles peuvent légalement justifier un refus d’admission en master.
● Cet arrêt retient également l’attention dans la mesure où, dans cette affaire, la cour juge néanmoins que la décision de refus d’admission en master était justifiée par un nouvel élément avancé en appel par l’université.
En effet, en appel, l’université avançait (comme le permet la jurisprudence) qu’un autre motif justifiait sa décision de refus d’admission en master, à savoir, l’incomplétude du dossier de l’étudiant.
Il n’est certes pas contestable qu’un dossier incomplet doit immanquablement être rejeté (qu’il s’agisse d’une demande d’admission en master ou de toute autre décision administrative).
Cependant, la position de la cour paraît, en l’espèce, discutable dans la mesure où en principe un dossier incomplet ne peut pas être rejeté automatiquement. En effet, en vertu de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, une demande ne peut être rejetée pour incomplétude sans que l’administration ait préalablement indiqué au demandeur que sa demande était incomplète et lui ait donné un délai pour fournir les éléments manquants.
Or, en l’espèce, la cour ne recherche pas si l’administration a effectivement indiqué à l’étudiant l’incomplétude de son dossier et lui a donné un délai pour compléter sa demande d’admission en master.
Dans cette mesure, la position de la cour est donc contestable.
La suspension d’un fonctionnaire de l’enseignement supérieur ne peut jamais dépasser 1 an
Le 21/04/2022
La suspension d’un fonctionnaire, qui a un caractère « provisoire », suit un régime particulier et assez peu protecteur pour les agents (voir l’article : La suspension dans la fonction publique).
Ainsi, et notamment, il est en principe possible, lorsque le fonctionnaire est suspendu et que des poursuites pénales sont engagées en parallèle, de maintenir la suspension jusqu’au terme desdites poursuites pénales (voir, par exemple : CE. CHR. 12 octobre 2021, n° 443903, mentionnée aux tables).
La question qu’avait à trancher ici le Conseil d’Etat était de savoir si le régime spécial de suspension prévu pour l’enseignement supérieur, qui ne se fonde pas sur l’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (devenu les articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique) mais sur l’article L. 951-4 du code de l’éducation, suivait le même régime.
En effet, à la différence de l’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, l’article L. 951-4 du code de l’éducation prévoit que la suspension d’un agent de l’enseignement supérieur ne peut être prononcée que « pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ».
Ainsi, aucune réserve n’est faite quant à l’hypothèse de poursuites pénales et aucune précision n’est apportée quant à leur impact sur la suspension.
Il aurait pu être envisagé que, dans ce silence, le régime général applicable aux fonctionnaires trouve à s’appliquer de sorte que les universités soient en droit de maintenir la suspension au-delà d’un an dans l’hypothèse où les poursuites pénales n’auraient pas encore abouti à un jugement.
Cependant, le Conseil d’Etat fait une application littérale de l’article L. 951-4 du code de l’éducation est estime que la suspension du fonctionnaire ne peut dépasser un an :
« 3. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que la durée totale de la suspension susceptible d'être infligée à un enseignant-chercheur ne peut excéder une durée totale d'un an, quand bien même l'intéressé fait l'objet de poursuites disciplinaires ou de poursuites pénales. […] ».
Aussi, il annule en l’espèce les décisions de l’université qui avait décidé de maintenir l’enseignant en suspension, à demi-traitement, jusqu’au terme des poursuites pénales.
En revanche, il rejette la demande de l’enseignant d’être provisoirement autorisé à prendre un autre poste.
En effet, il considère que les termes du contrôle judiciaire de l’agent, qui interdisent toute activité d’enseignement ou toute mission pour le compte de l’université, s’opposent à une telle demande.
Par conséquent, il en déduit que l’agent ne peut pas être réaffecté sur un poste quelconque auprès de cette université.
Le résultat est donc que l’agent voit officiellement un terme mis à sa suspension mais n’est pas autorisé à retourner à son poste. Il se trouve dans en pratique dans une sorte d’entre-deux puisqu’il n’est plus suspendu mais ne peut pas travailler pour son université en raison de son contrôle judiciaire, qui s’impose logiquement à l’administration.
Cette situation est donc particulière à la fonction publique de l’enseignement supérieure puisque, dans la fonction publique en général, au bout de 4 mois de suspension (qui est le terme normal de la suspension dans la fonction publique générale), la suspension de l’agent peut être maintenue jusqu’au terme des poursuites judiciaires, et ce, à demi-traitement.
La naturalisation, le casier judiciaire et la réhabilitation pénale
Le 15/04/2022
Par une décision n° 447231 du 21 décembre 2021, le Conseil d’Etat vient apporter des précisions quant à la naturalisation, l’inscription d’une infraction au casier judiciaire et la réhabilitation pénale.
● En effet, en vertu de l’article 21-27 du code civil, la condamnation à une « peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis » s’oppose à la naturalisation du demandeur.
Néanmoins, cet article prévoit une limite à ce principe selon lequel une condamnation à une peine de 6 mois de prison ferme (ou plus) s’oppose à toute naturalisation.
Plus précisément, il indique que la réhabilitation de la personne condamnée (que ce soit par l’écoulement du temps ou par décision judiciaire) fait tomber cette opposition de principe à la naturalisation.
Le mécanisme de la réhabilitation de plein droit est prévu par l’article 133-13 du code pénal qui prévoit différents délais aux termes desquels, si la personne n’a pas commis de nouvelles infractions, elle est regardée comme étant réhabilitée aux yeux de la société.
● Dans l’affaire jugée ici par le Conseil d’Etat, il n’existait pas de réel débat sur la réhabilitation du demandeur à la naturalisation.
Cependant, le préfet puis le ministre s’étaient fondés, pour rejeter la demande de naturalisation, sur la circonstance que la condamnation était toujours inscrite au casier judiciaire du demandeur. L’intéressé avait alors formé un recours contre le refus de sa demande de naturalisation (voir l’article : Comment contester un refus de naturalisation ?).
Ce raisonnement du ministre avait été censuré par la cour administrative d’appel de Nantes qui avait estimé que cette mention au casier judiciaire du demandeur était indifférente : en présent d’une réhabilitation, l’administration ne pouvait pas se fonder sur cette condamnation pour rejeter la demande de naturalisation.
Le ministre s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Aussi, le Conseil d’Etat avait à trancher cette question, tirée de l’articulation entre naturalisation, casier judiciaire et réhabilitation.
Suivant la cour administrative d’appel de Nantes dans son raisonnement, le Conseil d’Etat estime que la mention au casier judiciaire de l’infraction est indifférente.
Dès lors que le demandeur a été réhabilité (en l’occurrence par l’écoulement du temps), il n’est pas possible de lui opposer cette condamnation pour refuser sa naturalisation.
Il fait donc une application littérale du texte et ne vient pas ajouter, comme le lui suggérait le ministre, une condition tenant à la disparition de l’infraction du casier judicaire.
Cela signifie donc bien qu’une personne réhabilitée ne peut, conformément à l’article 21-27 du code civil, se voir opposer une condamnation pour refuser sa demande de naturalisation.
● Il convient néanmoins de souligner que ce raisonnement trouve une limite.
En effet, la circonstance qu’une personne ait été réhabilitée ou même qu’elle n’ait reçu aucune condamnation (voir l’article : Les demandeurs à la naturalisation sont-ils présumés coupables ?) ne s’oppose pas nécessairement au rejet de la demande de naturalisation.
Plus précisément, il est toujours possible de se fonder sur les « renseignements défavorables » obtenus auprès des services de police.
Ainsi, il faut relativiser l’impact de cette décision du Conseil d’Etat.
Elle signifie simplement que le demandeur à la naturalisation ne peut pas se voir opposer un refus en affirmant que sa demande méconnaît l’article 21-27 du code civil.
En revanche, il demeure possible de se fonder sur les « renseignements défavorables » obtenus auprès des services de police, qui consistent notamment à examiner les condamnations antérieures.
C’est d’ailleurs ce qu’a déjà jugé expressément la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 12 février 2018, n° 16NT04151) :
« Considérant […] que, si M. B...a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application des dispositions de l'article 133-12 et du 2° de l'article 133-13 du code pénal, cette circonstance a eu pour seul effet d'effacer les condamnations pénale dont il a fait l'objet, mais non les faits commis ayant donné lieu à ces condamnations ; ».
Aussi, bien qu’utile cette décision ne modifie pas la politique, particulièrement stricte, en matière de naturalisation.
Le 12/04/2022
Par une décision n° 456394 du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat apporte une nouvelle pierre au contentieux abondant des refus d’admission en master.
En effet, il est désormais bien établi que l’entrée entrée en master peut être sélective (voir sur ce point l’article L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective). Aussi, une demande d’admission en master peut être refusée à la suite d’une sélection.
En vertu des articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l’éducation, la situation est désormais la suivante :
- Une sélection est possible, par principe, à l’entrée en première année de master. Si tel est le cas, l’accès à la seconde année de master est libre.
- Par exception (dans des hypothèses limitativement énumérées par décret), l’entrée en master 1 est libre et la sélection est opérée entre le master 1 et le master 2.
Il résulte clairement de ces principes que la sélection ne peut donc intervenir qu’une seule fois, soit à l’entrée en master 1, soit à l’entrée en master 2.
Dans l’affaire jugée ici par le Conseil d’Etat, l’université (comme un certain nombre d’universités persistent à le faire) avait organisé une sélection à l’entrée en master 1 et à l’entrée en master 2.
Cette double sélection étant illégale, le tribunal administratif saisi du litige avait annulé le refus d’admission en master 2 opposé par l’université.
Il avait alors enjoint à celle-ci d’inscrire, à titre provisoire, le requérant dans l’un des trois masters 2 qu’il avait demandés.
C’est sur cette injonction que se concentre le débat tranché par le Conseil d’Etat.
En effet, le requérant avait validé un master 1 « droit des affaires » et avait demandé à être inscrit en master 2 « droit des affaires » et « droit notarial ».
Or, il est certain que ces deux masters 2 relèvent de spécialités différentes.
S’il ne faisait pas de doute qu’en raison de l’illégalité de la sélection, l’étudiant devait, en vertu de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, être admis en master 2 « droit des affaires » qui relève le même cursus, cette solution paraissait loin d’être évident pour le master « droit notarial ».
Aussi, le Conseil d’Etat annule la décision du juge en estimant qu’il devait rechercher « si la première année de master validée [relevait] de la même formation du deuxième cycle au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation ».
En effet, cet article donne un droit à être inscrit en master 2 du même cursus, mais pas dans tout master 2.
La position du Conseil d’Etat est donc logique puisqu’elle rappelle seulement que l’accès « de droit » en master 2 ne concerne que les étudiants qui étaient en master 1 dans la même formation.
Les modalités de contrôle des connaissances doivent être précises
Le 12/04/2022
Par un jugement n° 1910503 du 5 février 2021, obtenu par le cabinet, le tribunal administratif de Melun vient préciser le contenu des modalités de contrôle des connaissances (MCC) prévues par l’article L. 613-1 du code de l’éducation.
● En effet, l’article L. 613-1 du code de l’éducation se borne à indiquer que les modalités de contrôle des connaissances doivent être adoptées au début de l’année scolaire :
« […] Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. […] ».
Ainsi, le code de l’éducation ne précise pas ce que sont ces « modalités » et la précision avec laquelle les universités doivent les décrire. En effet, peuvent-elles se contenter de règles générales sur le déroulement des épreuves ? ou doivent-elle préciser pour chaque formation, la nature, la durée, le coefficient, etc. de chaque épreuve ?
● La logique veut, pour respecter ce texte, que les modalités de contrôle des connaissances (dont l’adoption est confiée à la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) en vertu de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation) soient entendues de manière large.
Plus précisément, il est certain que la durée ou le coefficient d’une épreuve est une modalité de contrôle de contrôle des connaissances. Aussi, pour respecter l’article L. 613-1 du code de l’éducation, il est nécessaire que ces modalités précises soient adoptées par la CFVU dès le début de l’année.
Or, dans l’affaire jugée par le tribunal administratif de Melun, la juridiction avait précisément à trancher cette question.
En effet, l’université prétendait que les documents qu’elles transmettaient, relatifs au déroulement général des épreuves, au fonctionnement des jurys et à la validation des unités d’enseignement était suffisants.
● Le tribunal écarte cet argument et juge au contraire, avec clarté, que les modalités de contrôle des connaissances doivent être précises pour permettre un déroulement régulier des épreuves :
« 4. […] Il résulte de ces dispositions que les examens conduisant à la délivrance du diplôme de master doivent être organisés conformément à des modalités définissant notamment le nombre d’épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. La définition de ces modalités de contrôle des connaissances ressort à la compétence de la commission de la formation et de la vie universitaire. Edictées en vue d’assurer l’égalité entre les étudiants, elles doivent être arrêtées au plus tard au terme du premier mois de l’année d’enseignement, ne pas être modifiées en cours d’année et avoir été portées à la connaissance des étudiants.
5. […] L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée se prévaut en défense de quatre documents adoptés par la commission de la formation et de la vie universitaire lors de ses séances des 3 mai et 28 juin 2018 et constituant selon elle le règlement des examens applicables à la formation considérée, à savoir : le « règlement des examens 2018/2019 », le « règlement des jurys 2018/2019 », les « dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes en master 2018/2019 » et un document intitulé « organisation de la formation et modalités de contrôles des connaissances spécifiques » applicable au master « … » – parcours « … ». Si ces documents déterminent les modalités générales de déroulement des épreuves, de fonctionnement des jurys et de validation des unités d’enseignement, aucun ne vient préciser, pour la formation considérée, le nombre d’épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. ».
Ainsi, le tribunal confirme que, pour chaque formation, il appartient à la CFVU de fixer :
- Le nombre d’épreuves,
- Leur nature,
- Leur durée,
- Leur coefficient,
- La répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal,
- La place respective des épreuves écrites et orales.
Cette liste non exhaustive est tirée de la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation des examens dans les établissements publics de l’enseignement supérieur (NOR : MENS0000500C), qui rappelle que :
« Les modalités de contrôle des connaissances doivent comporter l'indication du nombre d'épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. L'ensemble de ce règlement doit être affiché dès son adoption, sur les lieux d'enseignement. ».
● Pratiquement, cela signifie que si ces modalités pratiques ne sont pas fixées par un document écrit et précis, adopté avant la fin du premier mois de l’année scolaire, ou si ce n’est pas la CFVU qui a adopté l’ensemble de ces règles, alors les examens se sont déroulés de manière irrégulière.
Dès lors, cette question n’est pas purement théorique et suppose une particulière attention des universités. Cela montre également l’importance de toutes les modalités de contrôle des connaissances puisque, comme le rappelle le tribunal dans ledit jugement, ces règles sont « édictées en vue d’assurer l’égalité entre les étudiants ».
La motivation des décisions de refus d’admission en master
Le 30/03/2022
Par un arrêt n° 20PA02625 du 26 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé que les décisions de refus d’admission en master n’avaient pas à comporter de motivation formelle.
Cet arrêt donne l’occasion de rappeler et de clarifier certains principes applicables en la matière.
● En premier lieu, il convient de souligner une distinction qui n’est pas nécessairement évidente pour les profanes : il existe une différence entre absence de motivation et absence de motifs.
En effet, la « motivation » est une exigence formelle : dans certaines décisions, il est impératif d’indiquer les raisons sur lesquelles l’administration fonde son raisonnement. Si cette motivation n’est pas inscrite dans la décision, elle est alors illégale, même si la décision de l’administration est, sur le fond, justifiée.
Concernant les décisions qui n’ont pas à être « motivées », et qui sont nombreuses, cela ne signifie pas que l’administration n’a pas avoir de raisons justifiées pour prendre sa décision mais seulement qu’elle n’a pas à les inscrire sur la décision. Si le juge est saisi de telles décisions, l’administration devra s’expliquer sur les « motifs » ayant justifié la décision, lesquels seront alors contrôlés par le juge.
Ainsi, il ne faut pas déduire de l’absence de nécessité de « motiver » une décision, que l’administration n’aura pas à en justifier devant le juge.
● En deuxième lieu, s’agissant des décisions de refus d’admission en master, il ne fait malheureusement pas de doute que ces décisions n’ont pas à être motivées.
En effet, l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation de l’éducation (voir sur ce point l’article : L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective) prévoit seulement que les étudiants peuvent demander, dans le délai d’un mois suivant la décision, les motifs de cette décision. Il implique donc que les décisions de refus d’admission en master n’ont pas à être formellement motivées (autrement dit qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire dans la décision de rejet le motif de cette décision).
C’est ce qu’a d’ailleurs confirmé le Conseil d’Etat. Il a relevé sur ce point :
« 3. Les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] » (CE. CHR. 21 janvier 2021, n° 442788, mentionnée aux tables).
Dans l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Paris reprend ce principe et rappelle que les décisions de refus d’admission en master 1 et master 2 n’ont pas à être motivées.
● En troisième lieu, cela ne concerne donc que la forme des décisions et non leur fond.
En effet, cela signifie simplement que les étudiants et leurs avocats, dans le cadre de leurs recours contre les refus d’admission en master opposés par les universités ne peuvent pas se prévaloir de ce que, dans la décision qui a été envoyée à l’étudiant, les motifs de cette décision ne sont pas exposés.
En revanche, il est possible aux étudiants et à leurs avocats de critiquer les « motifs » (de fond cette fois) des décisions de refus d’admission en master opposées par les universités.
En pratique, cela signifie que l’étudiant ou son avocat doit critiquer dans son recours les motifs de la décision de refus, soit parce que ces motifs ont été demandés sur le fondement de l’article D. 612-3-2 du code de l’éducation, soit directement (même s’il ignore ses motifs) par exemple en affirmant que le dossier de l’étudiant est bon et meilleur que celui d’autres étudiants.
Auquel cas l’université sera contrainte dans son recours de justifier des motifs de sa décision de refus d’admission en master, ce qui permettra de connaître ces motifs et de les critiquer.
Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel commenté, l’affaire donne un bon exemple :
- La décision de refus d’admission en master n’a pas à être formellement motivée,
- Mais la cour contrôle les motifs de cette décision et considère qu’ils sont suffisants pour justifier le refus opposé par l’université.
Ainsi, il ne faut pas confondre le contrôle de la « motivation » des décisions de refus d’admission en master, qui n’existe pas, et le contrôle des « motifs » des décisions de refus d’admission en master, qui existe.
Le 25/03/2022
De prime abord, il paraîtrait assez logique que la chambre régionale ou la chambre nationale de discipline des architectes soit limitée par les griefs présentés dans la plainte déposée par le conseil de l’ordre ou par une autre des autorités mentionnées aux articles 27 de la loi du 3 janvier 1977 et 43 du décret du 28 décembre 1977 (voir l’article : Comment fonctionne la discipline des architectes ?).
Cependant, telle n’est pas la position retenue par la chambre nationale de discipline des architectes.
● En effet, celle-ci considère que les chambres régionales de discipline des architectes peuvent « se fonder sur des griefs qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte » (ex : CNDA, 9 décembre 2016, M. H B c. CRIOA d’Ile-de-France, n° 2015-161).
Ainsi, la chambre nationale considère qu’il est possible de sanctionner l’architecte pour des griefs qui n’ont pas dénoncés dans la plainte.
Cette position se fonde sur la jurisprudence du Conseil d’Etat rendue en matière de discipline des médecins qui permet effectivement à la chambre compétente de sanctionner des griefs qui n’ont pas été soulevés dans la plainte (CE. SSJS 11 avril 2014, n° 352865 ; CE. SSR. 15 décembre 2010, n° 329246, mentionnée aux tables ; CE. SSR. 11 juillet 2001, n° 214063 ; CE. SSR. 11 juillet 2001, n° 214062 ; CE. SSR. 11 juillet 2001, n° 214061, publiée au Recueil ; CE. SSR. 12 mars 1999, n° 179548 ; CE. SSR. 15 décembre 1993, n° 126877, mentionnée aux tables ; CE. SSR. 7 décembre 1984, n° 41743, publiée au Recueil).
● Néanmoins, pour préserver les droits de la défense, la chambre nationale de discipline des architectes considère que cette possibilité de soulever des griefs qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte ne peut se faire qu’« à condition […] de se conformer au principe des droits de la défense en mettant le professionnel poursuivi à même de s’expliquer, dans le cadre de la procédure écrite, sur l’ensemble des griefs qu’elles envisagent de retenir à son encontre ».
Autrement dit, les chambres régionales de discipline des architectes et la chambre nationale de discipline des architectes doivent mettre l’architecte poursuivi à même de se défendre sur ce grief.
Là encore, il s’agit d’une reprise de la jurisprudence du Conseil d’Etat. En effet, dans les décisions précitées, le Conseil d’Etat rappelle que s’il est possible pour une chambre de discipline de soulever des griefs qui ne se trouvent pas dans la plainte par laquelle elle a été saisie, c’est à la condition de respecter les droits de la défense.
Il s’agit donc d’une obligation logique puisqu’à défaut, le professionnel accusé ne pourrait pas connaître les griefs qui lui sont reprochés.
● Cependant, la chambre nationale de discipline des architectes semble retenir une conception particulièrement souple du respect des droits de la défense.
En effet, dans la décision susmentionnée (CNDA, 9 décembre 2016, M. H B c. CRIOA d’Ile-de-France, n° 2015-161), la chambre nationale de discipline des architectes a considéré que la seule circonstance que la « personne intéressée » (voir sur la notion de « personne intéressée » l’article Comment fonctionne la discipline des architectes ?) ait, lors de son audition devant le rapporteur, adressé à l’architecte des reproches non visés par la plainte suffit à ce que les griefs retenus par la chambre régionale soient regardés comme ayant pu être discutés.
Cette conception est donc particulièrement souple et critiquable.
En effet, il faut rappeler sur ce point que le dossier devant la chambre de discipline des architectes est composé de nombreuses pièces dont les principales sont la plainte et le rapport du rapporteur.
Or, la chambre estime qu’au vu du procès-verbal d’audition d’une personne qui n’est même pas partie à l’affaire, l’architecte doit se douter que la juridiction va en tirer des griefs qu’elle n’a pas soumis elle-même au contradictoire.
L’architecte et son avocat doivent donc être particulièrement vigilants étant donné cette conception très souple du « contradictoire » et des « droits de la défense ».
Il leur incombe donc en pratique d’anticiper des griefs qui ne sont formulés ni dans la plainte, ni par le rapporteur, ni par la juridiction elle-même.
Cette conception des droits de la défense est donc particulièrement discutable puisqu’elle implique pour l’architecte de deviner au vu des propos de quelqu’un qui n’est même pas une partie, quels griefs pourraient être retenus par la chambre, alors que le principe même des droits de la défense supposer de connaître avec suffisamment de précision, ce dont la personne est accusée.
Le 15/03/2022
Par une décision n° 432718 du 24 janvier 2022, le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions quant au droit d’accès à l’éducation des mineurs étrangers isolés.
En effet, dans cette affaire était en cause le cas d’un mineur isolé étranger pour lequel se posait la question (récurrente dans ce type d’hypothèse) de son âge exact. Après avoir été soumis à des tests, il s’était vu refuser l’aide sociale à l’enfance en raison d’un doute sur son âge.
L’intéressé avait également demandé, ne parallèle, à être scolarisé et le rectorat de Paris n’avait jamais répondu à sa demande, faisant naître une décision implicite de rejet.
Cette décision a été contestée devant le tribunal administratif de Paris qui l’a annulée. En appel, cette annulation a été confirmée, la cour ayant estimé (CAA Paris, 14 mai 2019, n° 18PA02209) :
- D’une part, que le droit à l’éducation est distinct de l’obligation scolaire de sorte que le doute sur l’âge d’un mineur (moins ou plus de 16 ans) n’a aucun impact sur son droit à l’éducation. Plus précisément, la cour a retenu : « Comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, ce droit trouve à s’exercer même dans le cas où l’enfant, âgé de plus de seize ans, n’est plus soumis à l’instruction obligatoire. Dès lors la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, et susceptible de porter atteinte à son droit à l’instruction. ».
- D’autre part, qu’il appartient au recteur, même en présence d’un doute de l’aide sociale à l’enfance sur l’âge d’un individu, de procéder à l’affectation de l’intéressé dans un établissement scolaire adapté à son niveau.
Toutefois, l’Etat s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’Etat a donc eu à connaître des mêmes critiques et a essentiellement repris la même solution que la cour administrative d’appel de Paris.
En effet, le Conseil d’Etat considère de longue date que le droit à l’instruction est une liberté fondamentale (CE. Ord. 15 décembre 2010, Ministre de l’éducation nationale, n° 344729, publiée au Recueil).
De plus, le droit à l’instruction est rappelé par l’article L. 111-2 du code de l’éducation. Et ce droit est distinct de l’instruction obligatoire jusqu’à 16 ans (consacrée par l’article L. 131-1 du code de l’éducation).
Aussi, le Conseil d’Etat confirme ici que le droit à l’instruction est bien distinct de l’instruction obligatoire jusqu’à 16 ans :
« 4. En jugeant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un enfant ait dépassé l'âge de l'instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. ».
Par ailleurs, il confirme, comme la cour administrative d’appel l’avait retenu, que le rectorat n’est pas tenu par une décision du service de l’aide sociale à l’enfance qui estime qu’il existe un doute sur l’âge de la personne se présentant comme mineure.
En effet, il juge que ce « doute » n’impose pas au rectorat de refuser le bénéfice d’une formation adaptée :
« 6. En jugeant que la seule circonstance que le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris ait antérieurement estimé qu'il avait un doute sur l'âge de M. P... ne constituait pas, par elle-même, un motif imposant au recteur de Paris de refuser à l'intéressé le bénéfice d'une formation adaptée […] ».
En revanche, il adopte une formulation différente de la cour administrative d’appel de Paris quant aux conséquences à tirer de ce constat.
En effet, le Conseil d’Etat en déduit qu’il appartient alors au recteur « d'apprécier lui-même la situation de l'intéressé à la date de sa décision, au vu des éléments en sa possession, tels la décision du service de l'aide sociale à l'enfance et d'éventuels éléments postérieurs ».
Ainsi, il considère que le rectorat doit prendre une décision sur la scolarisation de l’individu en tenant compte de tous les éléments en sa possession et non uniquement sur la décision de l’aide sociale à l’enfance.
Il laisse donc une porte ouverte à la prise en compte de la décision de l’aide sociale à l’enfance émettant des doutes sur l’âge de l’intéressé.
Mais il demeure difficile de savoir quelles conséquences pratiques tirer de ce pouvoir d’appréciation du recteur dans la mesure où, dans cette affaire, le requérant avait été scolarisé en cours de procédure devant le tribunal administratif. C’est ce qui explique que le Conseil d’Etat n’examine pas les conséquences pratiques des principes qu’il pose.
Il est donc délicat de tirer des conséquences générales de cette décision du Conseil d’Etat.
Il n’en demeure pas moins qu’il est désormais certain que le rectorat ne peut se borner à se réfugier derrière le doute émis par le service de l’aide sociale à l’enfance quant à l’âge d’un individu pour refuser de le scolariser.