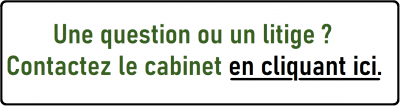- Accueil
- Blog
Blog
L’importance de la composition des jurys se prononçant sur le redoublement
Le 28/02/2022
La composition des jurys, même lorsqu’ils ne se prononcent pas sur les mérites respectifs des candidats à valider (leur semestre, année ou diplôme), mais sur une décision d’accorder ou de refuser un redoublement présente une importance primordiale.
C’est ce qu’a rappelé la cour administrative d’appel de Paris à l’occasion d’un arrêt du 9 juillet 2020 n° 18PA02953.
Dans cette affaire, était en cause le refus de redoublement opposé à un étudiant en master à l’université Paris-Dauphine.
Cette décision avait, en l’occurrence été prise par le jury de master.
Cependant, il convient de souligner qu’il n’est pas obligatoire qu’une décision d’accorder ou de refuser un redoublement soit prise, au sein d’une université, par le jury.
En effet, en principe, il s’agit d’une décision purement administrative puisqu’elle s’apparente à une inscription (en l’occurrence une réinscription) et relève donc de la compétence du président.
Néanmoins, il est loisible aux universités de confier la compétence en matière de redoublement aux jurys (lesquels sont généralement mieux à même d’apprécier l’intérêt d’un redoublement pour un étudiant).
Tel était le cas dans l’espèce jugée par la cour administrative d’appel de Paris.
Or, sur les 6 personnes composant le jury amené à se prononcer sur le redoublement, seules 5 d’entre elles étaient présentes lors de sa réunion.
L’université faisait valoir que cette incorrecte composition du jury trouvait sa source dans l’absence justifiée de l’une de ses membres, qui était convoquée au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).
En effet, l’absence d’un membre du jury peut, dans certaines hypothèses, être regardée comme justifiée.
La convocation auprès d’un autre organe administratif apparaît, de prime abord, comme pouvant être une justification sérieuse.
Cependant, dans l’arrêt commenté, la cour ne se borne pas à examiner si ce motif était justifié mais apprécie la temporalité entre l’annonce de cette absence et la délibération du jury.
Aussi, il considère qu’eu égard au délai d’un mois entre la convocation auprès du CNESER (qui fait effectivement obstacle à la présence de l’une des membres du jury) et la réunion de ce jury, cette absence ne peut être regardée comme « inopinée » de sorte que l’université aurait dû prendre « des mesures pour procéder à son remplacement ».
Ainsi, l’enseignement de cet arrêt est double :
- D’une part, il ne suffit pas, pour excuser le membre d’un jury absent, de fournir une justification appropriée, il faut également que l’université démontre, soit que cette absence était inopinée, soit qu’elle a cherché sans succès à remplacer le membre du jury absent.
- D’autre part, même lorsque le jury ne se prononce pas sur les mérites des candidats mais sur des questions annexes et administratives telles que le redoublement des étudiants, sa composition est susceptible d’emporter l’annulation des décisions prises.
Dans cette affaire, la cour estime donc que le refus de redoublement qui avait été opposé par l’université est entaché d’illégalité.
Le contrôle des décisions de refus de redoublement des universités
Le 10/06/2021
Par un jugement n° 1910503 du 5 février 2021, obtenu par le cabinet, le tribunal administratif de Melun rappelle que les refus de redoublement opposés par les universités sont contrôlés par les juridictions administratives et censure le refus opposé à l’étudiant pour erreur manifeste d’appréciation.
● En premier lieu, par ce jugement récent, le tribunal rappelle que la décision de redoublement ou non d’un étudiant prise par une université « procède d’une appréciation de l’ensemble de la situation de l’étudiant et non pas seulement des notes obtenues » et doit être contrôlée par les juridictions.
En effet, il est jugé constamment par les juridictions administratives que l’erreur manifeste d’appréciation des décisions de refus de redoublement est contrôlée (voir, par exemple : CAA Douai, 5 octobre 2006, IFSI du centre hospitalier de Roubaix, n° 03DA00876[1]) même lorsque cette décision est prise par un jury (voir, par exemple : CAA Lyon, 7 juillet 2015, M. A c. IEP de Lyon, n° 14LY01595[2]).
Il ressort de ces arrêts que pour prendre sa décision de refuser ou d’accorder un redoublement, une université ou une école doit tenir compte :
- Des notes de l’étudiant et de ses chances d’obtenir le diplôme en cas de redoublement,
- De son comportement.
C’est ce que rappelle dans son jugement du 5 février 2021 le tribunal administratif de Melun en rappelant de manière particulièrement explicite que le redoublement doit tenir compte « de l’ensemble de la situation de l’étudiant et non pas seulement des notes obtenues ».
Ainsi, l’étudiant n’est pas réduit à ses notes et à sa validation du diplôme, il est nécessaire de s’intéresser aux chances de l’élève de progresser, à son comportement, voire même à son état de santé.
● En second lieu, dans son jugement rendu le 5 février 2021, le tribunal administratif de Melun procède à cette analyse. Aussi, il étudie les notes de l’élève, les notes des étudiants autorisés à redoubler, l’absence de difficultés dans la progression de l’élève et l’absence de difficultés comportementales.
Ainsi, c’est bien une appréciation globale à laquelle il procède.
Plus précisément, il retient :
« 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé des notes et résultats de M. A et du procès-verbal des délibérations du jury, que la moyenne générale de M. A s’établit au final à …/20. A part dans la matière qui lui vaut son ajournement, toutes ses autres notes dans les disciplines académiques se situent au-dessus de la moyenne. Son stage en entreprise a été évalué à …/20, soit un résultat proche de la moyenne générale des étudiants du master cette année-là. Deux étudiants ont été admis avec une moyenne générale inférieure à la sienne. A l’inverse, trois autres étudiants ajournés ont été admis à redoubler alors que leurs résultats sont comparables voire inférieurs aux siens. Aucun élément du dossier ne fait ressortir de difficulté particulière quant à la progression de M. A au cours de son parcours, au sein de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée ou dans ses précédents établissements. De même, il n’est ni établi ni allégué que son comportement serait problématique. Dans ces conditions, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée a entaché la décision de refus de redoublement prise à l’encontre de M. A d’une erreur manifeste d’appréciation. ».
Dès lors, contrairement à ce que laissent généralement penser les universités et les écoles aux élèves, ces derniers ne sont pas démunis en cas de refus de redoublement.
De plus, les juridictions exercent un contrôle limité (mais néanmoins vigilant) sur les décisions de refus de redoublement prises par les universités et les écoles, qui doivent être en mesure de justifier leurs choix.
Et pour cause la décision opposée à un étudiant lui refusant un redoublement est lourde de conséquences. Lorsqu’elle est opposée au stade du master (université) ou du diplôme (école), elle met généralement un terme au cursus scolaire de l’étudiant qui se retrouve donc, après 5 ans d’études, sans diplôme final.
[1] « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le niveau général obtenu par Mlle X à l'issue de l'ensemble des épreuves de la première année de formation lui permettait sérieusement d'envisager une réussite l'année suivante ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les difficultés de comportement manifestées par l'intéressée, au sein de l'établissement et non en stage, étaient de nature à compromettre sérieusement le déroulement d'une nouvelle année de scolarité au sein du même établissement ; que, dès lors, en fondant le refus d'autoriser le redoublement sollicité par Mlle X sur l'insuffisance de ses résultats et des difficultés de comportement, la directrice de l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision attaquée prise par la directrice de cet institut ; » (CAA Douai, 5 octobre 2006, IFSI du centre hospitalier de Roubaix, n° 03DA00876).
[2] « 11. Considérant que le jury réuni les 8 juillet et 9 septembre 2011 a prononcé l'ajournement de M. A... et n'a pas autorisé son redoublement ; que compte tenu de l'ensemble de la situation de cet élève, notamment de son état de santé, qui avait été porté à la connaissance de l'établissement dès le début de l'année universitaire, et aux conditions de déroulement de sa scolarité, décrites au point 8 ci-dessus, le refus d'autoriser son redoublement procède, en l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ; » (CAA Lyon, 7 juillet 2015, M. A c. IEP de Lyon, n° 14LY01595).
Vers un renforcement de la possibilité d’user du droit souple
Le 10/04/2021
Par une décision n° 428683 du 21 septembre 2020 (éclairée par les conclusions de M. Laurent Cytermann), le Conseil d’Etat est venu renforcer la possibilité pour les ministres de faire usage du droit souple, et plus précisément, des « lignes directrices ».
● En effet, la notion de « lignes directrices » est désormais clairement définie par la décision M. Cortes Ortiz (CE. Sect. 4 février 2015, n° 383267, publiée au Recueil ; conclusions de Béatrice Bourgeois-Machureau).
Elle est issue de l’ancienne notion de « directive », créée par la décision Crédit foncier de France (CE. Sect. 11 décembre 1970, n° 78880, publiée au Recueil) que la décision M. Cortes Ortiz est venue préciser.
En vertu de ces différentes décisions, il faut distinguer :
- Les lignes directrices, qui permettent à l’administration, lorsqu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire (autrement lorsque l’administration est très libre, en vertu des textes, dans sa prise de décision), d’assurer la cohérence de son action en fixant des critères souples, auxquels elle peut déroger pour différents motifs (intérêt général ou particularité de la situation). Ces lignes directrices peuvent être invoquées par les particuliers même si elles n’ont pas de caractère réglementaire.
- Les orientations générales, qui ne peuvent exister qu’à une double condition : que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, et que ce pouvoir discrétionnaire intervienne en matière purement gracieuse (autrement dit, dans une hypothèse où les décisions individuelles sont prises dans un domaine où les demandeurs n’ont juridiquement aucun droit d’y prétendre ; l’exemple topique est celui de la régularisation des personnes sans-papiers). Ces orientations générales, à la différence des lignes directrices, n’ont aucune valeur et les particuliers ne peuvent pas en exiger l’application.
Les lignes directrices ainsi définies avaient, jusqu’ici, vocation à être édictées par des autorités qui ne disposaient pas d’un pouvoir réglementaire.
En effet, elles avaient été conçues dans la décision Crédit foncier de France comme un palliatif à l’absence de pouvoir réglementaire : sans pouvoir réglementaire, le ministre ou tout autre chef d’administration pouvait néanmoins orienter l’action de ses services dans un domaine discrétionnaire.
Dès lors, les lignes directrices avaient vocation à être édictées par des autorités dépourvues de pouvoir réglementaire dans le domaine en cause. C’est d’ailleurs ce que rappelait expressément la décision M. Cortes Ortiz susmentionnée :
« 4. Considérant que […] l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices » (CE. Sect. 4 février 2015, M. Cortes Ortiz, n° 383267, publiée au Recueil).
● Or, par la décision commentée, le Conseil d’Etat est venu étendre le champ d’utilisation des lignes directrices.
En effet, et désormais, une autorité administrative peut édicter des lignes directrices même dans un domaine où elle dispose d’un pouvoir réglementaire.
Le considérant de principe de la décision M. Cortes Ortiz a été enrichi de la manière suivante :
« 5. […] l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices ».
Jusqu’ici, l’utilisation de lignes directrices par une autorité disposant d’un pouvoir réglementaire n’était pas expressément interdite. Mais cette configuration ne s’était – semble-t-il – jamais présentée en jurisprudence.
En effet, une autorité disposant d’un pouvoir réglementaire préfère en général imposer une règle qui sera suivie par ses services, plutôt qu’un encadrement relativement souple. Elle n’a en principe recours à un encadrement souple que si elle n’a pas le pouvoir de réglementer ledit domaine.
Toutefois, dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat, le ministre de l’éducation nationale n’a pas fait usage de son pouvoir réglementaire pour encadrer les indemnités de départ volontaire créées par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008.
Plus précisément, le décret du 17 avril 2008 créait la possibilité d’octroyer des indemnités de départ volontaire aux agents mais fixait des critères assez généraux, qui laissaient une marge d’appréciation non-négligeable aux ministres pour les appliquer dans leurs administrations.
Le ministre de l’éducation nationale, plutôt que de faire usage de son pouvoir réglementaire en la matière, a préféré émettre des consignes générales quant à l’utilisation de ces indemnités de départ volontaire dans son administration.
Toute la question était pour le Conseil d’Etat de déterminer la valeur de ces consignes : étaient-ce des lignes directrices au sens de la jurisprudence M. Cortes Ortiz ou un acte d’une autre nature du fait de l’existence d’un pouvoir réglementaire du ministre ?
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat décide d’élargir le champ d’application des lignes directrices en jugeant que ces consignes, même prises par un ministre disposant du pouvoir réglementaire, sont des lignes directrices au sens de la jurisprudence.
Autrement dit, il est possible pour les demandeurs d’indemnités de départ volontaire de s’en prévaloir et le juge contrôlera leur application selon ses standards classiques.
De la sorte, il est désormais clair que les chefs d’administration pourront utiliser des lignes directrices même dans les domaines pour lesquels ils disposent d’un pouvoir réglementaire.
● Mais cela ne signifie pas que les ministres pourront à l’avenir utiliser en tous domaines les lignes directrices plutôt que leur pouvoir réglementaire.
En effet, une telle solution aurait pour effet de conduire à une insécurité juridique et des inégalités, que le Conseil d’Etat n’a nullement cherché à créer.
Dans les domaines dans lesquels un acte réglementaire est nécessaire en vertu des textes ou de la jurisprudence, les chefs d’administration devront continuer à adopter les règlements qui s’imposent, sauf à commettre une incompétence négative (CE. SSR. 22 novembre 1996, Société Home Vidéo Channel, n° 155767, publiée au Recueil ; CE. SSR. 26 janvier 2015, Société Bernheim Dreyfus et Co, n° 368847, mentionnée aux tables ; CE. SSR. 28 octobre 2002, Commune de Moisselles, n° 232060, mentionnée aux tables ; CE. SSR. 16 octobre 2013, Société Electricité de France, n° 358701, mentionnée aux tables).
Ainsi, la décision commentée du Conseil d’Etat ne signifie pas que le pouvoir réglementaire pourra substituer du droit souple, à savoir des lignes directrices, à des règlements lorsque ceux-ci sont nécessaires.
Cela signifie seulement que le pouvoir réglementaire pourra utiliser des lignes directrices dans les domaines dans lesquels il n’est pas obligé d’agir.
● Enfin, cette décision est également intéressante du point de vue de la procédure dans la mesure où elle rappelle le principe selon lequel il n’est pas possible de demander un « renvoi » devant le juge administratif.
En effet, le Conseil d’Etat rappelle que, sauf exception, le juge n’a aucune obligation d’accéder à la demande de l’une des parties tendant à ce que l’affaire soit entendue à une audience ultérieure en raison d’une impossibilité d’être présent. Il n’en va différemment que lorsque les « exigences du débat contradictoire » l’imposent. (CE. Sect. 16 juillet 2010, M. Pierre A, n° 294239, publiée au Recueil ; CE. SSR. 18 juin 2014, n° 367725, mentionnée aux tables).
Ainsi, le fait que l’avocat ne puisse être présent (par exemple parce qu’il assure une autre audience au même moment) n’est pas un motif valable pour demander un renvoi pour une procédure au fond devant les juridictions administratives.
L’instruction étant principalement écrite devant les juridictions administratives et la présentation de nouveaux moyens à l’oral étant impossible, cette solution n’est pas étonnante.
En revanche, dans le cadre des procédures orales traitées par les juridictions administratives, la présence d’un avocat apparaît davantage comme une exigence du contradictoire. Dans ces conditions, l’absence de l’absence de l’avocat devrait, plus aisément, conduire à un renvoi de l’audience.
Des prescriptions complémentaires à un PPRN peuvent permettre de respecter l'article R. 111-2 CU
Le 30/03/2021
Par une décision n° 426139 du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat vient rappeler que le principe est l’autorisation de construire et l’interdiction, l’exception.
En effet, dans cette affaire était en cause la construction d’un ensemble immobilier de 758 logements, de commerces, services et crèche dans une zone de risque « moyen » d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) inondations.
Ce projet avait été jugé conforme au PPRN et aux documents d’urbanisme, de sorte que le maire de la commune avait autorisé le projet.
Cependant, ce permis de construire avait été contesté par le préfet et soumis au tribunal administratif.
Le tribunal administratif avait alors annulé le permis de construire en estimant que si le projet était conforme au PPRN inondation, le risque de submersion existait et devait donc être sanctionné sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Cet article prévoir que :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ».
Ce jugement a cependant été contesté devant le Conseil d’Etat par le détenteur du permis de construire annulé.
Le Conseil d’Etat, dans la décision commentée, apporte plusieurs précisions.
● Tout d’abord, il rappelle que les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels n’ont pas à être reprises dans le permis de construire pour s’imposer.
Il ne fait, sur ce point, que reprendre la jurisprudence antérieure en ce domaine (CE. SSR. 4 mai 2011, Commune de Fondettes, n° 321357, mentionnée aux tables).
Ce rappel allait de soi dans la mesure où les documents et les servitudes d’urbanisme n’ont pas à être rappelés dans le permis de construire pour s’imposer au pétitionnaire.
● Ensuite, en examinant le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat consacre le fait que le PPRN ne se substitue pas à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En effet, il aurait pu considérer que si le PPRN était respecté par un projet, c’est que ce projet respectait nécessairement l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, puisque le PPRN est supposé protéger la sécurité et la salubrité publique.
Cependant, telle n’est pas la solution retenue. Le Conseil d’Etat considère de façon constante qu’un projet peut parfaitement respecter un PPRN (notamment inondation) mais être refusé du fait d’un risque (par exemple d’inondation) sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (CE. SSR. 4 mai 2011, Commune de Fondettes, n° 321357, mentionnée aux tables ; CE. SSR. 15 février 2016, M. A, n° 389103, mentionnée aux tables).
Ainsi, même si un terrain est classé dans une zone où aucun risque n’est identifié dans le PPRN ou même si les prescriptions du PPRN sont respectées, cela ne signifie pas que le projet ne pourra être refusé en raison du risque pourtant censé être traité par le PPRN.
Dans ses conclusions sur la décision commmentée, Olivier Fuchs, explique cette contradiction apparente par deux motifs : le premier, est tiré du caractère général du PPRN et le second, de pure opportunité, est lié à la possibilité d’une omission ou du caractère incomplet du PPRN.
● Enfin, le Conseil d’Etat rappelle également que le juge ne peut pas annuler un permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme si cette annulation peut être évitée par l’imposition de prescriptions (voir l’article : Que sont les prescriptions d'un permis de construire ?).
En effet, si cette solution a été dégagée il y a peu (CE. CHR. 26 juin 2019, M. Deville, n° 412429, publiée au Recueil) elle se fonde sur un principe ancien puisqu’il ne faut pas oublier qu’en matière d’urbanisme, le droit de construire est le principe et sa limitation l’exception.
Dans ces conditions, il est parfaitement logique, au vu de ce principe que si la construction peut être autorisée pour un motif, le juge doit analyser ce motif.
● Appliquant ces principes à l’espèce, le Conseil d’Etat censure le jugement du tribunal administratif.
En effet, il considère que le tribunal pouvait contrôler le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme par le permis de construire, même si le PPRN était respecté. En revanche, il estime que le tribunal ne pouvait annuler le permis de construire sans rechercher si des prescriptions, ajoutées au permis de construire, auraient permis de prévenir le risque qui était identifié.
Ce faisant, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel le droit de construire est la règle et sa limitation est l’exception.
Le 20/03/2021
Dans un arrêt n° 13NT02534 du 17 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Nantes juge une affaire atypique dans laquelle une postulante (A) demandant la naturalisation s’était vu refuser sa naturalisation au motif qu’elle aurait caché avoir un enfant, une autre demanderesse (B) ayant produit un acte de naissance indiquant que A était sa mère.
La situation pour A était donc particulièrement délicate. Elle avait déclaré n’avoir aucun enfant au moment de sa demande de naturalisation, mais B avait produit un acte de naissance la désignant comme sa mère et les services du consulat général de France au Congo avaient confirmé l’authenticité de ce certificat.
Les services de l’Etat avaient donc refusé sa naturalisation au motif que A avait fourni des informations dont la véracité n'était pas démontrée lors de sa demande. L’intéressée avait alors formé un recours contre le refus opposé à sa demande de naturalisation (voir l’article : Comment contester un refus de naturalisation ?).
Du fait de cette authenticité attestée par les services du consulat de l’acte d’état civil de B, il était particulièrement complexe pour A de démontrer que cet acte était un faux.
Elle avait donc déposé plainte pour faux contre B. Mais sa plainte avait finalement abouti à un non-lieu.
A était donc en position délicate pour faire reconnaître la véracité de ses propos tenus au moment de sa demande de naturalisation :
- L’acte de naissance produit par B était regardé comme authentique,
- Sa plainte avait abouti à un non-lieu.
Mais dans l’arrêt commenté, la cour donne malgré tout raison à A.
En effet, lors des interrogatoires, B avait reconnu avoir 41 ans et non 33 ans comme l’indiquait son acte de naissance. Elle avait également refusé de se soumettre à un teste biologique comme le demandait A.
De ces circonstances, et au vu de l’âge de A (47 ans) qui rendait matériellement impossible la filiation, la cour déduit qu’elle n’avait pas donné d’informations erronées lors de sa demande de naturalisation. Aussi, elle annule le refus opposé par les services de l’Etat à sa demande de naturalisation.
Cette affaire, au-delà de son caractère atypique, montre toute la difficulté qui peut exister pour faire authentifier les actes d’état civil étranger.
En effet, dans cette affaire, les services du consulat général de France au Congo avaient confirmé l’authenticité de l’acte de naissance. Or, au vu de l’arrêt de la cour, il est évident que :
- L’acte était un faux,
- Si l’acte était authentique, les autorités locales y avaient nécessairement apposé des mentions grossièrement mensongères.
Dès lors, cela démontre la difficulté inhérente à l’authentification des actes d’état civil étrangers.
Le 10/03/2021
Par deux décisions n° 433297 et n° 433296 du 15 juillet 2020, le Conseil d’Etat tire les conséquences de la décision n° 2020-834 QPC du Conseil constitutionnel en date du 3 avril 2020 (voir l’article « Les algorithmes de Parcousup ne pourront pas être demandés ») relative aux algorithmes de Parcoursup.
En effet, avec la réforme de l’accès à l’université, et sous couvert de faciliter l’accès des étudiants aux décisions des universités, le législateur est, en réalité, venu interdire l’accès aux algorithmes (les cordes sources) utilisés par les universités pour sélectionner les étudiants.
Cette situation, critiquée par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans un avis du 10 janvier 2019 (n° 20184400), a été confirmée par le Conseil d’Etat (CE. CHR. 12 juin 2019, UNEF c. Université des Antilles, n° 427916, mentionnée aux tables ; voir le commentaire : « Les syndicats étudiants n’ont pas le droit de demander la communication des algorithmes de Parcoursup »).
Dans ce cadre, une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 612-3 du code de l’éducation avait été posée (CE. CHR. 15 janvier 2020, UNEF c. Université de la Réunion, n° 433296 ; voir le commentaire : « La restriction du droit d’accès aux algorithmes de Parcoursup est soumise au Conseil Constitutionnel »).
Par sa décision du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions (et principalement l’interdiction de demander la communication des algorithmes utilisés par les universités) étaient constitutionnelles, sous réserve d’un très léger élargissement des informations fournies aux étudiants et à leurs organisations représentatives.
Dès lors, par la décision commentée, le Conseil d’Etat est venu en tirer les conséquences sur les demandées présentées par l’UNEF tendant à la communication des procédés algorithmiques utilisés par les universités de La Réunion et de Corse dans le cadre des admissions en première année ainsi que les codes sources correspondants.
Sa décision, sans surprise, est défavorable à l’organisation étudiante :
D’une part, et dans la mesure où les universités ont publié, postérieurement à la sélection, un rapport indiquant les critères utilisés dans le cadre du traitement des candidatures, le Conseil d’Etat considère qu’il a été satisfait aux demandes du syndicat tendant à la communication des procédés algorithmiques utilisés.
D’autre part, et comme les algorithmes en eux-mêmes peuvent rester secrets, il oppose un refus aux demandes d’accès aux codes sources présentés par les syndicats.
De la sorte, le Conseil d’Etat confirme que ni les organisations étudiantes, ni les étudiants eux-mêmes ne pourront avoir accès à ces codes sources de manière à vérifier que les informations fournies par les universités sont exactes.
Il ferme donc définitivement (au moins au regard du droit interne) à toute possibilité d’accès aux algorithmes utilisés par les universités pour sélectionner les étudiants.
Le 28/02/2021
Par une décision n° 424293 du 3 juillet 2020, le Conseil d’Etat estime que les règles spécifiques de recevabilité des recours en matière d’urbanisme (et plus particulièrement de permis de construire) sont légales. Il ajoute néanmoins une précision quant à la condition posée par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
En effet, plusieurs organismes avaient contesté un certain nombre de modifications apportées au code de justice administrative par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018. Ce décret avait pour objet évident de limiter l’accès au juge en complexifiant les règles de recevabilité des recours ou en facilitant leur rejet.
Par la décision commentée, le Conseil d’Etat rejette l’ensemble des moyens dirigés contre ces dispositions, qui ne concernaient pas uniquement l’urbanisme, mais ne seront traitées ici que les précisions apportées par le Conseil d’Etat en matière de contentieux de l’urbanisme (et notamment de recours contre les permis de construire).
● En premier lieu, le Conseil d’Etat considère que l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, qui fixe à 6 mois à compter de l’achèvement des travaux le délai de recours contre les permis de construire ou les autres autorisations d’urbanisme qui n’auraient pas fait l’objet d’un affichage, est légal.
Plus précisément, il convient de rappeler qu’en principe une autorisation d’urbanisme doit être affichée pendant 2 mois sur le terrain d’assiette du projet. Cet affichage fait courir le délai de recours et, au terme des 2 mois, il n’est plus possible de contester le permis de construire (sous certaines réserves, voir l’article : A quelle date un permis de construire est-il réellement définitif ?).
Mais que se passe-t-il si le permis de construire n’est jamais affiché ? En effet, il arrive que l’affichage ait été oublié ou volontairement omis.
Dans cette hypothèse, l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme pose une limite. Il prévoit que le permis de construire ne peut pas, pour autant, être contesté indéfiniment. Il ne peut l’être que dans un délai de 6 mois à compter de l’achèvement des travaux.
Ces dispositions étaient contestées dans la mesure où elles ferment la porte à tout recours alors qu’aucune mesure de publicité du permis de construire n’a été réalisée.
Le Conseil d’Etat écarte cependant cet argument en considérant que dès lors que cet article se borne à prévoir un délai de recours, il ne ferme pas l’accès au juge et poursuit un impératif de sécurité juridique en évitant que les permis de construire puissent être contestés indéfiniment.
Cette position, bien que stricte, est compréhensible dans la mesure où, 6 mois après le terme de la construction, les riverains qui peuvent être gênés par cette construction ont eu le temps de s’en rendre compte et donc de contester ledit permis de construire.
● En deuxième lieu, les organismes requérants contestaient également l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme qui prévoit que les recours doivent être accompagnés des pièces justifiant de l’intérêt à agir des personnes à l’origine du recours, à peine d’irrecevabilité.
Il convient de rappeler ce qu’est l’intérêt à agir. Il s’agit de la justification pour déposer recours. En effet, toute personne ne peut pas attaquer toute décision administrative. Il faut que l’annulation de la décision administrative présente un intérêt pour elle (même moral, même peu certain).
La jurisprudence générale se caractérise par son libéralisme (CE Sect. 14 février 1958, Sieur Abisset, Rec. 98).
Cependant, le droit de l’urbanisme fait exception au sein de position générale et se caractérise par deux spécificités (notamment à propos des permis de construire).
D’une part, les règles d’intérêt à agir sont plus strictes que dans le reste du contentieux administratif (voir : L'intérêt à agir contre un permis de construire doit être bien justifié par l'avocat).
D’autre part, les requérants doivent exposer leur intérêt à agir dès l’introduction de leur recours.
Dans les autres domaines, ce n’est que si l’intérêt à agir du requérant est contesté (par le juge ou par la partie adverse) qu’il doit le justifier. Mais en matière d’autorisations d’urbanisme, l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme qui était contesté devant le Conseil d’Etat, prévoit que les recours sont irrecevables si les requérant ne produisent pas dans leurs requêtes les pièces justifiant leur intérêt.
Autrement dit, pour contester un permis de construire, il faut notamment produire son bail d’habitation ou son acte de propriété pour justifier que l’on vit à proximité du projet et donc que l’on est susceptible d’être gêné par lui.
Ces dispositions sont donc très strictes (et d’ailleurs peu favorables aux requérants qui ne bénéficient pas d’un avocat).
Dans la décision commentée, si le Conseil d’Etat juge cet article légal, il apporte une précision assez importante.
En effet, il indique que les recours ne peuvent pas être rejetés sans que le juge ait invité au préalable le requérant à régulariser sa requête.
Autrement dit, si le bail ou l’acte de vente est manquant, le juge ne peut pas rejeter directement le recours pour irrecevabilité comme le laisse penser le texte. Il doit, avant cela, indiquer au requérant cet oubli et l’inviter à produire ces documents dans un délai qu’il fixe.
Cette précision est donc importante car elle évite un rejet trop systématique des recours face à un simple oubli.
Il convient néanmoins de souligner que ces dispositions restent critiquables dans la mesure où elles précisent que les requérants doivent justifier du « caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
En effet, même si cela apparaît logique de prime abord, cela signifie que les recours des ZADistes, occupants ou squatteurs sont en principe irrecevables, que ce soit contre les projets prévus sur les terrains qu’ils occupent ou sur les terrains alentours. Or, même si leur occupation est en principe illégale, cela n’a aucun lien avec la possibilité qui doit être ouverte de faire vérifier par le juge la légalité d’un permis de construire délivré.
● En troisième lieu, le Conseil d’Etat écarte également les moyens dirigés contre l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Il convient de rappeler que cet article limite la période pendant laquelle de nouveaux moyens peuvent être soulevés.
En effet, et en principe, il est toujours possible d’ajouter des moyens (autrement dit des arguments de droit et de fait) en cours de procédure, tant que l’instruction est ouverte, à condition qu’ils se rapportent à une cause juridique ouverte par cette instance (CE. Sect. 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772, publiée au Recueil).
Or, en matière d’urbanisme, il n’est plus possible d’ajouter de nouveaux moyens passé 2 mois après la notification du premier mémoire en défense (ou à une autre date fixée par le juge).
Le Conseil d’Etat juge que cette règle, pourtant très stricte, ne méconnaît pas les droits de la défense. Il considère qu’il n’y a aucune atteinte aux droits de la défense car le juge peut reporter à une date ultérieure cette « cristallisation » des moyens.
Cependant, l’on voit difficilement en quoi cette possibilité offerte au juge a un impact sur les droits de la défense. Dans tous les cas, s’il s’avère, après l’expiration de ce délai qu’un moyen nouveau conduisant à l’annulation du permis de construire aurait dû être soulevé, il n’est plus possible de s’en prévaloir, même si l’instruction n’est pas close.
Dès lors, et même si la solution retenue par le Conseil d’Etat est compréhensible, elle n’en demeure pas moins très stricte pour les requérants, sans réelle justification.
● En quatrième lieu, le Conseil d’Etat apporte une précision qui ne porte, cette fois, pas sur la recevabilité des recours contre les permis de construire, mais sur les délais de jugement de ces recours.
En effet, l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme prévoit que les jugements doivent être rendus dans un délai de 10 mois pour les recours formés contre les permis de construire portant sur plus de deux logements.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat considère que ces dispositions sont légales et ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif.
Pour ce faire, il relève que le délai de 10 mois n’est pas prescrit à peine de dessaisissement. Autrement dit, ce délai n’est pas impératif. C’est davantage une invitation pour les juridictions puisqu’il n’y a aucune conséquence si le délai de jugement est finalement plus long.
Il ajoute que ces dispositions ne portent pas atteinte à l’égalité des justiciables. Toutefois, cette affirmation est plus discutable.
En effet, un litige en matière de permis de construire plus de deux logements n’a pas plus d’importance que les autres litiges (par exemple portant sur permis de construire un logement, sur un licenciement ou révocation, etc.). Dès lors, la justification de cette différence de traitement (si ce n’est un motif économique) ne saute pas aux yeux. D’ailleurs, le raisonnement du Conseil d’Etat sur ce point est particulièrement bref.
Il résulte, en tout cas, de cette décision que la dernière réforme intervenue en contentieux de l’urbanisme pour fermer le prétoire et accélérer le jugement des litiges en matière de permis de construire est validée dans son ensemble.
Le 19/02/2021
Par un arrêt n° 19NT01012 du 3 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Nantes estime que la circonstance que l’ex-compagne du demandeur à la naturalisation ne dispose pas de titre de séjour – même si elle est en situation régulière – crée une « incertitude sur le caractère durable » de la présence de leur enfant sur le territoire français et donc de la situation du centre de ses « intérêts familiaux ».
Dans cette affaire, était en cause un demandeur à la naturalisation âgé de 43 ans, ayant vécu en France depuis l’âge de ses 7 ans, qui a eu un enfant avec une compatriote de laquelle il s’était séparé depuis lors.
La compatriote en question était en situation irrégulière au moment du dépôt de la demande de naturalisation mais était en situation régulièrement au moment de la décision du ministre (une demande de titre de séjour ayant été déposée).
Un refus de naturalisation avait été opposé par l’Etat au motif tiré de la situation irrégulière de son ex-compagne. Un recours avait alors été formé par le postulant contre son refus de naturalisation (voir l’article : Comment contester un refus de naturalisation ?).
Au vu de ces éléments, la cour a estimé que le ministre pouvait refuser la naturalisation du postulant.
Cette solution apparaît sévère au regard de la jurisprudence en la matière.
En effet, Il convient de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence, le demandeur à la naturalisation doit vivre en France, mais il faut que le « centre [de ses] intérêts » se situe également en France (CE. Sect. 28 février 1986, n° 57464, publiée au Recueil).
L’idée derrière cette affirmation de principe est que pour être regardé comme résidant réellement en France, il faut y vivre au sens matériel mais il faut surtout que ses intérêts s’y trouvent.
Or, s’agissant des enfants du demandeur à la naturalisation, il ressort de la jurisprudence qu’en principe, même si les enfants du demandeur à la naturalisation résident à l’étranger, cela ne peut pas lui être opposé s’il a déposé une demande de regroupement familial (voir, par exemple, en ce sens : CAA Nantes, 28 mai 2018, n° 17NT01947 ; CAA Nantes, 29 décembre 2017, n° 16NT02288 ; CAA Nantes, 16 septembre 2016, n° 15NT03356).
Au cas présent, la situation du demandeur à la naturalisation était donc beaucoup plus favorable puisque son fils résidait en France, tout comme la mère de ce dernier, et aucun projet de déménagement à l’étranger n’était prévu.
Pourtant, le doute sur la pérennité de la régularité de la situation de la mère de l’enfant justifie un refus de naturalisation.
Ainsi, par cette solution qui paraît peu cohérente, le demandeur à la naturalisation, dont le fils réside en France est regardé comme ayant un « centre [des] intérêts » incertain tandis qu’un postulant dont l’enfant réside à l’étranger (mais pour lequel une demande de regroupement familial a été faite) a un « centre [des] intérêts » certain.
Cette décision, est donc sévère au regard de la jurisprudence pourtant déjà très restrictive.
Et ce, d’autant, que le raisonnement de la cour fait abstraction des règles du droit de la famille qui permettent à un parent vivant en France d’empêcher l’autre parent de son enfant de partir vivre à l’étranger avec celui-ci.
Dès lors, cette solution défavorable au demandeur à la naturalisation est critiquable.