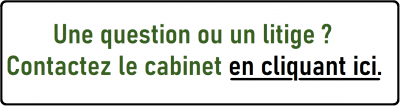- Accueil
- Blog
Blog
Un agent, muté d’office dans l’intérêt du service, n’a pas à connaître le lieu de cette affectation
Le 08/12/2017
Par une décision n° 402103 du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat considère qu’un agent muté dans l’intérêt du service, s’il doit être mis à même de présenter ses observations avant l’émission de la décision, n’a pas à être informé du lieu sur lequel sa mutation est envisagée.
Dans cette affaire, était en cause un agent qui, à l’issue d’une exclusion temporaire disciplinaire, n’avait pas été réintégré, dans l’intérêt du service, sur son poste mais dans un autre établissement de son administration. En effet, le déplacement d’office de l’agent ne présentait pas – en l’espèce – un caractère disciplinaire, le déplacement visant, non pas à sanctionner l’agent, mais à prévenir les éventuels troubles que pourrait susciter son retour à l’issue de son exclusion.
Dans ce type d’hypothèse, l’agent doit être mis à même, avant l’émission de la décision, de demander son dossier et de présenter ses éventuelles observations sur la décision à intervenir. En effet, même si le changement d’affectation ne présente pas un caractère disciplinaire, l’agent dispose de ces garanties anciennes, fixées par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Il convient de souligner que l’agent doit être « mis à même » d’exercer ces garanties. Autrement dit, il n’a pas à être invité à le faire mais doit cependant disposer d’un délai entre l’annonce de ce que la décision de mutation va être prise et l’intervention effective de cette décision (CE. Sect. 23 juin 1967, M. Mirambeau, n° 55068, publiée au Recueil ; CE. SSR. 14 mai 1986, Syndicat national des cadres hospitaliers CGT-FO, 60852, mentionnée aux tables ; ou plus récemment : CAA Lyon, 28 juin 2011, Mme Virginie X, n° 10LY01394). Ce délai le met donc à même – selon la jurisprudence – de demander son dossier et de faire valoir ses observations, bien qu’il n’y ait pas été invité.
Au cas présent, la cour administrative d’appel de Marseille avait considéré (CAA Marseille, 24 mai 2016, n° 14MA04315) que ces garanties n’avaient pas été respectées dans la mesure où l’agent n’avait pas été informé de l’établissement dans lequel il allait être déplacé, de sorte qu’il n’avait pas été mis à même de présenter ses observations.
Cette position, empreinte de logique, consiste à considérer que si l’agent ne connaît pas le site sur lequel il sera muté (à un kilomètre de son lieu de travail initial ou à l’autre bout de la France), alors il n’est pas à même de présenter utilement ses observations.
Toutefois, telle n’est pas la solution retenue par le Conseil d’Etat dans la décision commentée, rendue à la suite du pourvoi formé par La Poste contre l’arrêt de la cour annulant la mutation qu’elle avait décidée.
En effet, la Haute juridiction considère que la cour a commis une erreur de droit et que l’agent n’avait pas à être informé du lieu précis de son changement d’affectation pour faire valoir utilement ses observations.
Cette solution est regrettable car si, juridiquement, une mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service est la même quel que soit le nouveau lieu d’affectation, de sorte que l’agent peut présenter des observations sur le principe de la mutation, il n’en demeure pas moins que, pratiquement, la mutation dans un établissement situé dans la même ville ou à des centaines de kilomètres du lieu initial de travail n’est pas la même chose.
Aussi, pour donner un effet utile aux observations de l’agent, il aurait été préférable d’imposer à l’administration d’indiquer le lieu d’affectation envisagé.
Le vol de 200 ouvrages justifie l’exclusion définitive d’un étudiant du système universitaire
Le 01/12/2017
Par une décision n° 393269 du 6 novembre 2017, le Conseil d’Etat considère que le vol de plus de 200 ouvrages par un étudiant dans une bibliothèque universitaire justifie son exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur.
Dans cette affaire, soumise en cassation au Conseil d’Etat à la suite d’une décision du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, était en cause un étudiant, accusé par son université d’avoir fait disparaître sur une période de 5 mois plus de 200 ouvrages de la bibliothèque universitaire.
En effet, pour justifier ces accusations, l’université se basait sur un faisceau d’indices :
- Que l’étudiant était le dernier emprunteur des ouvrages ayant disparu,
- Que les quelques ouvrages rapportés par l’intéressé à la suite de relances étaient endommagés, leur puce électronique ayant été arrachée puis recollée.
Ces éléments faisaient présumer que l’étudiant avait dérobé les ouvrages en procédant à des restitutions fictives par le passage des puces, décollées des ouvrages, devant les dispositifs de retour.
Aussi, la section disciplinaire de l’université avait sanctionné cet étudiant par une exclusion définitive de tout établissement universitaire. Saisi en appel de cette décision, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche avait toutefois estimé que ces éléments n’établissaient pas la réalité des accusations.
Un pourvoi a alors été formé par l’université devant le Conseil d’Etat.
Ce dernier, exerçant son contrôle de cassation, juge que le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche a dénaturé les pièces dossier en annulant la sanction.
Réglant l’affaire au fond comme juge du plein contentieux (CE. Ass. 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000, publiée au Recueil) la Haute juridiction estime que les éléments étaient suffisants, en l’absence d’explications de l’étudiant, pour regarder les faits comme établis et pour le sanctionner.
Dès lors, et implicitement, le Conseil d’Etat considère que cette sanction (la plus grave de toutes les sanctions prévues par les articles L. 811-6 et R. 811-11 du code de l’éducation) était justifiée.
En effet, l’article R. 811-11 dresse une liste des sanctions dans un ordre croissant de gravité allant de la plus légère (l’avertissement) à la plus lourde (l’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur).
L’exclusion définitive du système universitaire est donc rarement appliquée puisqu’elle concerne uniquement les faits les plus graves. Le cas soumis au Conseil d’Etat donne donc un exemple d’application de cette sanction.
Entrée à l’université : les contours encore flous de la réforme
Le 03/11/2017
Lors d’une conférence de presse du 30 novembre dernier, le Premier ministre et la ministre de l’enseignement supérieur ont présenté les contours de la future réforme de l’accès à l’université.
Plusieurs axes ont été présentés conduisant – en principe – à la disparition de l’algorithme APB.
En effet, plusieurs changements d’importances ont été décidés pour l’accès aux filières « non sélectives » de l’université :
- Un avis du conseil de classe de terminale sera donné sur les choix de formation effectués par le lycéen, qui devra donc les annoncer dès le début de l’année de terminale.
- La nouvelle application d’affectation sera créée en permettant de déposer moins de candidatures qu’actuellement (limitées à 10 au lieu de 24) qui ne feront l’objet d’aucun classement entre elles et qui seront toutes examinées par les universités.
- Les universités ne seront plus limitées à un choix binaire entre acceptation et refus mais pourront également accepter sous condition les futurs étudiants (proposition d’un parcours personnalisé, préparation intégrée, etc.) ou les mettre sur liste d’attente.
- Une commission sera créée en faisant participer le rectorat, les universités et les lycées pour trouver des propositions d’affectation aux étudiants ne disposant pas de réponses positives, à l’instar de ce qui a été créé récemment pour l’accès en master 1.
Néanmoins, ces axes demeurent flous dans la mesure où la portée de l’avis du conseil de classe n’est pas encore fixée avec précision et où, surtout, les critères de décision des universités quant à la réponse à donner au futur étudiant sont également à déterminer, notamment l’importance des « prérequis » qui a animé les débats de la consultation sur la réforme de l’accès à l’université.
Il est cependant certain que la philosophie du système actuel va être profondément modifiée puisque les futurs étudiants seront encadrés et contrôlés dans leurs choix par le lycée et l’université (même si le degré de cet encadrement est encore à déterminer) alors que jusqu’ici, les élèves étaient parfaitement libres de leurs choix pour les filières universitaires non sélectives. Il en découlera nécessairement une forme de sélection pour les filières pourtant qualifiées de « non sélectives » avec les avantages et inconvénients qui vont avec.
Restera donc à voir quelles seront les solutions finalement retenues par les textes qui seront adoptés dans les prochains mois, lesquels permettront seuls de déterminer l’ampleur des changements à attendre et de la sélection à partir de l’an prochain.
La suspension d’un fonctionnaire, même légale, peut engager la responsabilité de l’administration
Le 16/10/2017
Par une décision n° 390424 du 8 juin 2017, le Conseil d’Etat considère que la suspension d’un chirurgien, pendant huit ans, engage la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’égalité devant les charges publiques.
Il est désormais établi de longue date qu’un acte administratif, même légal, peut engager la responsabilité des personnes publiques au titre de l’égalité devant les charges publiques si cet acte légal crée un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme incombant normalement au requérant (CE, 30 novembre 1923, Couitéas, Rec. 789). Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat applique ce principe ancien au cas de la suspension d’un agent public pendant une durée extrêmement longue eu égard aux conséquences de cette décision.
En effet, dans cette affaire, était en cause la suspension conservatoire d’un fonctionnaire de l’administration hospitalière, et plus précisément un chirurgien, pendant une durée de huit ans.
Ce médecin, ayant été accusé d’homicide involontaire dans le cadre d’un rapport de l’agence régionale d’hospitalisation, a fait l’objet d’une procédure pénale et d’une suspension administrative. La procédure pénale ayant duré huit ans (entre la mise en examen et l’arrêt de relaxe), la suspension a été maintenue dans l’intervalle.
Cette suspension était parfaitement légale comme l’a jugé la cour administrative d’appel dans la mesure où un agent peut être suspendu, à titre conservatoire, s’il est gravement soupçonné d’avoir commis une faute disciplinaire. Si cette faute est liée à une infraction pénale, il est possible de maintenir la suspension pendant toute la durée de la procédure pénale.
Voir, sur le régime de la suspension : La suspension dans la fonction publique, La suspension dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie.
Néanmoins, le Conseil d’Etat considère que la responsabilité sans faute de l’Etat (donc sans illégalité) est engagée dans la mesure où ce praticien n’a pas exercé pendant huit ans, de sorte qu’il a subi « une diminution difficilement remédiable de ses compétences chirurgicales, compromettant ainsi la possibilité pour lui de reprendre un exercice professionnel en qualité de chirurgien ».
En effet, depuis le terme de sa suspension en 2009, l’agent n’a pas retrouvé de poste, l’absence de pratique pendant huit ans étant manifestement un frein à sa reprise d’activité dans un domaine aussi délicat que la chirurgie.
La Haute juridiction considère que ce préjudice grave ne peut être regardé comme « normal[…] » dans la mesure où le praticien n’a été sanctionné ni pénalement, ni disciplinairement.
Le Conseil d’Etat censure donc l’arrêt de la cour administrative d’appel en tant qu’il ne s’est pas prononcé sur le préjudice moral subi du fait de cette rupture dans l’égalité devant les charges publiques.
Pour le tribunal administratif de Bordeaux, la circulaire APB ne règle rien
Le 09/10/2017
Par trois ordonnances (n° 1703771, 1703768, 1703763) du 21 septembre 2017, le juge de référés du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la circulaire APB ajoutait illégalement un critère d’affectation au texte de l’article L. 612-3 du code de l’éducation.
Cette nouvelle ordonnance, qui s’inscrit dans la saga judiciaire qui entoure l’inscription à l’université et, notamment, le tirage au sort effectué via l’application APB, peut donner de l’espoir aux étudiants ne disposant d’aucune affectation à ce jour.
En effet, par une circulaire du 24 avril 2017, le gouvernement a tenté de donner une assise « textuelle » au tirage au sort qui avait été jugé illégal à plusieurs reprises.
Un recours en référé avait été formé contre cette circulaire, lequel avait donné lieu à une décision de rejet par le Conseil d’Etat (voir le billet : Le Conseil d'Etat se prononce sur le référé contre la ciruclaire APB). La Haute juridiction avait considéré qu’il n’y avait pas urgence à ce qu’elle se prononce sur la légalité de cette circulaire et avait renvoyé à la formation de jugement au fond le soin de se prononcer sur la légalité de la circulaire.
Néanmoins, comme cela était probable, le moyen tiré de l’illégalité de la circulaire du 24 avril 2017 (circulaire APB) a été soulevé dans le cadre de référés relatifs à des refus d’admission en première année.
Or, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le moyen tiré de ce que la circulaire avait illégalement ajouté un nouveau critère (le tirage au sort) aux critères posés par l’article L. 612-3 du code de l’éducation (à savoir le domicile, la situation de famille et les préférences du candidat) était sérieux.
Aussi, il suspend l’exécution de la décision du recteur refusant d’inscrire les requérants et enjoint à l’administration de faire procéder à l’inscription provisoire de ces derniers.
Ainsi, le tribunal estime en substance qu’il est douteux que la circulaire ait pu introduire un critère tiré du tirage au sort dans le cadre de l’affectation à l’université.
Si ce raisonnement n’est pas entièrement partagé par l’auteur de ces lignes (voir l'article : Quel effet pour la circulaire « APB » ?) il n’en demeure pas moins que le système APB est, avant comme après la circulaire, entaché de différentes illégalités, la question de l’assise textuelle du tirage au sort n’étant que l’une des nombreuses questions que pose l’affectation en première année.
Le Conseil d’Etat devrait être amené à se prononcer sur ces ordonnances du tribunal administratif de Bordeaux dans la mesure où la ministre de l’éducation nationale a indiqué qu’un pourvoi serait formé contre ces ordonnances. Cependant, eu égard au délai de jugement devant le Conseil d’Etat, la décision ne devrait pas être rendue avant la rentrée prochaine (sauf à ce que la Haute juridiction décide de se saisir de l’affaire plus tôt).
Le Conseil d'Etat précise les hypothèses de péremption du permis de construire
Le 26/09/2017
Par une décision SCI La Bruyère n° 399405 du 10 mai 2017, les chambres réunies du Conseil d’Etat viennent clarifier l’articulation entre, d’une part, les différents délais de péremption des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme (notamment les non-opposition à déclarations préalables) et, d’autre part, les dispositions successives intervenues dans ce domaine.
Concernant l’articulation entre les différents cas de péremption
En effet, l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, qui traite de la péremption des permis de construire a été réécrit par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007.
Plus précisément, l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme (issu de l’ancienne numérotation) indiquait avant cela :
« Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. […] ».
Depuis l’intervention du décret du 5 janvier 2007, ces dispositions (désormais codifiées à l’article R. 424-17) indiquent :
« Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans [trois ans, désormais] à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. […] ».
Ainsi, dans les nouvelles dispositions, les termes « passé ce délai » ont été introduits.
C’est donc principalement sur ce point que le Conseil d’Etat se prononce dans la décision du 10 mai 2017.
Sous l’empire des anciennes dispositions, il avait jugé que les délais de péremption pour absence de commencement des travaux et de péremption pour cessation des travaux pendant plus d’un an n’étaient pas exclusifs l’un de l’autre (CE. SSR. 8 novembre 2000, EURL Les maisons traditionnelles, n° 197505, publiée au Recueil). Autrement dit, le permis de construire pouvait être périmé dans trois hypothèses :
- Si au bout de deux ans à compter de sa délivrance, les travaux n’avaient pas commencé,
- Si dans ce délai de deux ans, les travaux étaient interrompus pendant plus d’un an,
- Si passé ce délai de deux ans, les travaux étaient interrompus pendant plus d’un an.
L’apport de la décision susmentionnée est d’indiquer qu’au vu des dispositions précitées dans leur nouvelle rédaction, la deuxième occurrence de la péremption disparaît.
Plus simplement, cela signifie que désormais, il n’est pas tenu compte des éventuelles interruptions intervenues dans le délai de validité du permis de construire. Dès lors, à titre d’exemple, si les travaux démarrent dès l’octroi de l’autorisation, ils peuvent être interrompus quelques mois plus tard pendant plus d’un an et jusqu’au terme du délai de deux ans (devenu trois ans), sans que cela n’ait d’incidence sur la validité du permis de construire.
Le Conseil d’Etat précise dans la décision SCI La Bruyère que ce n’est que dans l’hypothèse où l’interruption se poursuit pendant plus d’un an à l’expiration du délai de deux ans (devenu trois ans) que le permis de construire est alors périmé.
Ainsi, le Conseil d’Etat effectue une lecture littérale des nouvelles dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, assez favorable au détenteur du permis de construire.
Concernant l’articulation entre les dispositions successives
Dans la décision du 10 mai 2017, le Conseil d’Etat répond à une seconde question, relative à l’articulation entre les différentes dispositions applicables à la péremption des permis de construire.
Il rappelle en effet que l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dans nouvelle rédaction (plus favorable) s’applique aux permis de construire en vigueur à la date du 1er octobre 2007 (article 26 dudit décret).
Cela signifie donc que ces dispositions nouvelles relatives à la péremption sont applicables aux permis de construire et autres autorisations d’urbanisme qui n’étaient pas périmées en vertu de l’ancienne réglementation à la date du 1er octobre 2007. Ainsi, ces dispositions trouvent à s’appliquer aux permis de construire délivrés à compter du 1er octobre 2005 et dont l’exécution n’avait pas été interrompue depuis plus d’un an dans l’intervalle.
De même, le Conseil d’Etat rappelle que le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 venant prolonger d’un an la durée de validité des permis de construire s’applique aux permis de construire qui étaient en vigueur au jour de sa publication (article 2 du décret).
C’est donc au vu de ces principes clarifiés qu’il convient désormais d’appréhender la péremption ou non des autorisations d’urbanisme.
Le tirage au sort APB disparaîtra l'an prochain
Le 05/09/2017
Dans une interview parue ce dimanche dans le JDD, la ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a indiqué que « la plateforme APB, ce sera terminé l’an prochain ».
Il y a déjà quelques mois, la ministre de l’enseignement supérieur avait déclaré que la disparition du tirage au sort était son « objectif » (Le Parisien, 15 juin 2017, voir sur ce point : Le tirage au sort pour l’entrée à l’université disparaitra-t-il en 2018 ?). Elle va désormais plus loin en s’engageant, cette fois, à faire disparaître le tirage au sort réalisé dans les filières les plus demandées. Elle affirme sur ce point : « Le "tirage au sort", à l'aveugle, dans les filières les plus demandées, sera supprimé en 2018 ».
Les solutions pour faire face à l’accroissement des demandes ne sont toutefois pas exposées avec clarté. En effet, le tirage au sort APB permettait à l’administration de limiter le nombre d’inscrits, le nombre de demandes étant supérieur aux places disponibles.
Il sera donc nécessaire qu’une autre solution soit trouvée.
Or, la ministre laisse entendre qu’une sélection (sans utiliser ce terme) sera instituée en lieu et place du tirage au sort. Cette sélection, qui concernera notamment les élèves des baccalauréats professionnel et technologique, implique un changement profond de la philosophie actuelle de l’université, qui prévoit un libre accès à la première année (article L. 612-3 du code de l’éducation).
Concernant l’année universitaire qui va commencer, la ministre affirme que les rectorats travaillent pour donner une place aux 6.000 étudiants à la recherche d’une université. Il convient de rappeler sur ce point que les rectorats sont en principe tenus d’inscrire les étudiants lorsque les demandes excèdent les capacités d’accueil (article L. 612-3 du code de l’éducation). Aussi, cette recherche n’est donc que l’application de leurs obligations.
La ministre estime qu’ainsi, au 25 septembre, tous les bacheliers devraient avoir une place. Reste donc à voir si ces mesures seront suffisantes pour cette année.
Le 04/09/2017
Par une décision n° 411227 du 8 juin 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat estime que l'interdiction adressée à titre conservatoire à un élève de troisième de se présenter à l'établissement dans l'attente de la réunion du conseil de discipline devant se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation.
Plus précisément, le juge des référés du Conseil d'Etat retient, d'une part, que cette décision, par nature conservatoire, ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence. En effet, dans la mesure où la décision d'interdiction ne se prononce pas sur la culpabilité de l'élève mais se contente de l'éloigner dans l'attente de la décision du conseil de discipline, il est logique qu'elle soit regardée comme étant sans incidence sur la présomption d'innocence.
Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de ce que jugent les juridictions administratives à propos des procédures disciplinaires diligentées contre les agents publics. Ainsi, il a pu être jugé que des décisions affectant provisoirement des agents sur d'autres fonctions (CAA Lyon, 18 mars 2014, M. D c. France Télécom, n° 13LY00275), leur demandant de ne plus se rendre sur leur lieu de travail (CAA Paris, 26 juin 2007, Mme Froidurot, n° 05PA01294), leur interdisant de pénétrer dans certains locaux (CAA Versailles, 14 mars 2006, M. Toure, n° 03VE02879) ou leur retirant certaines fonctions (CAA Paris, 28 décembre 2005, Mme Gonnet, n° 02PA02984) étaient légales dès lors qu'elles présentaient un caractère conservatoire.
De même, toujours en matière de fonction publique, il est également prévu par les textes qu'un agent peut être suspendu de ses fonctions dans l'attente d'une sanction (article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Au cas présent, le texte en cause est rédigé de manière similaire dans la mesure où l'article D. 511-33 du code de l'éducation prévoit que le chef d'établissement peut interdire l'accès à un élève en attendant la réunion du conseil de discipline.
Dès lors, les solutions retenues en droit de la fonction publique sont parfaitement transposables dans la mesure où le raisonnement va bien au-delà des relations agents/administration : une mesure provisoire ne se prononce pas sur la culpabilité de la personne concernée et vise uniquement à protéger la sérénité du service public en attendant qu'une décision soit prise.
Aussi, que la personne concernée soit un agent ou un usager du service public (un élève en l'occurrence), le raisonnement doit être le même.
C'est pourquoi, le juge des référés du Conseil d'Etat estime en l'espèce que la décision provisoire ne méconnaît « d'aucune manière » la présomption d'innocence.
D'autre part, le Conseil d'Etat se prononce sur l'éventuelle atteinte portée par cette mesure au droit à l'éducation mais rejette ce moyen.
En effet, il aurait été concevable que le droit à l'éducation, lequel est un droit fondamental, fasse obstacle à tout éloignement de l'élève afin que ce dernier ne soit pas privé de ses enseignements.
Cependant, cette solution n'est pas celle retenue par le Conseil d'Etat. Le juge des référés paraît considérer de manière générale que ce type de mesure ne constitue pas une atteinte manifestement illégale au droit à l'éducation.
Toutefois, cette solution n'est peut-être pas aussi générale qu'il y paraît dans la mesure où le juge relève qu'en l'espèce, des mesures ont été prises que ses cours soient transmis à l'élève sous forme dématérialisée. Dès lors, même si ce dernier n'a pu assister aux cours, il n'a pas été privé de son droit à l'éducation. En outre, le juge mentionne que les cours se sont terminés le 10 juin 2017, soit quinze jours après la mesure litigieuse. De la sorte, la mesure a porté sur une période relativement brève et n'a pas empêché l'élève se suivre les cours.
Ainsi, le juge des référés du Conseil d'Etat considère que la décision provisoire d'éloignement prise par la proviseure du collège ne fait pas obstacle à l'exercice du droit à l'éducation.