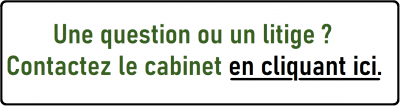- Accueil
- Blog
Blog
Le 21/08/2017
Par un arrêt du 15 mai 2017 (n° 16MA03636), la cour administrative d’appel de Marseille rappelle le principe de l’absence de sélection en première année de licence et indique que ce principe s’applique également aux étudiants titulaires de diplômes étrangers.
En effet, la cour rappelle que les articles L. 111-1, L. 111-5, L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’éducation posent le principe d’un accès à la première année de licence sans condition autre que l’obtention du baccalauréat (ou bien son équivalent ou sa dispense).
Appliquant ce principe à l’espèce, elle censure la décision de l’université d’Aix-Marseille de refuser l’accès à la première année de licence à un étudiant disposant d’un diplôme du baccalauréat marocain, cette décision étant motivée par les notes insuffisantes obtenues à ce diplôme.
Plus précisément, dans la mesure où l’étudiant disposait du diplôme d’accès aux études universitaires françaises, il remplissait la seule condition posée par les textes et ne pouvait donc se voir opposer de refus. C’est la raison pour laquelle le refus d’admission, fondé sur les notes insuffisantes de l’étudiant, est jugé illégal.
La cour relève sur ce point :
« 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'accès à la première année de licence n'est subordonnée à aucune autre condition que celle d'être titulaire du baccalauréat, et est ouvert à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade ; que M. E..., admis en juillet 2010 aux examens du baccalauréat au Maroc, et titulaire du diplôme d'accès aux études universitaires françaises, remplissait les conditions d'accès précitées ; que, par suite, le président de l'université d'Aix-Marseille ne pouvait légalement fonder la décision de refus d'inscription en litige sur le motif tiré de l'insuffisance des résultats de l'intéressé ; que si l'université d'Aix-Marseille fait valoir que la demande d'inscription de M. E... était tardive, il ressort des pièces du dossier que la demande d'inscription en double cursus, datée du 29 septembre 2013, n'était tardive qu'à l'égard de sa demande d'inscription en licence en droit, qui a été autorisée par l'université ».
Dès lors, le principe du libre accès en première année de licence s’applique bien à tout étudiant disposant du diplôme nécessaire, qu’il soit français ou étranger.
Le 16/08/2017
Par un arrêt du 13 juillet 2017 (n° 15MA02914), la cour administrative d’appel de Marseille se prononce sur la répartition des compétences entre un président d’université et un directeur d’IUT (institut universitaire de technologie) relevant de cette université pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle.
En effet, dans cette affaire, une agent travaillant au sein d’un IUT de l’université de Nice Sophia-Antipolis avait demandé la protection fonctionnelle de son administration à la suite d’agissements au sein de l’IUT. Aussi, se posait la question de la compétence pour se prononcer sur cette demande : le directeur d’IUT ou le président d’université.
La rédaction de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la protection fonctionnelle des agents publics est, sur ce point, peu claire. Le texte dispose que la protection des agents publics est « organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause », étant rappelé qu’antérieurement à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, le texte prévoyait de façon quelque peu évasive que la protection était « organisée par la collectivité publique dont [les agents] dépendent ».
Au cas présent, il était donc nécessaire de déterminer quelle administration « emplo[yait] » l’agent en question.
Plus précisément, les IUT disposent, en vertu de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, de l’autonomie financière et ont leur administration propre (conseil élu et directeur). Ces instituts sont donc distincts des universités auxquels ils sont rattachés.
Néanmoins, malgré cette autonomie, les IUT ne disposent pas en principe de la personnalité morale de sorte qu’ils ne constituent pas réellement une administration distincte de celle de l’université.
C’est la raison pour laquelle la cour estime que le président de l’université était bien compétent pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle (même si la cour n’explique pas son raisonnement).
Elle juge en effet :
« 4. Considérant que les faits pour lesquels Mme F..., maître de conférence à l'université de Nice Sophia-Antipolis, a sollicité le bénéfice des dispositions précitées, se sont produits à l'occasion de l'exercice de ses fonctions à l'IUT de Nice qui dépend de cette université ; que, par suite, Mme F... relève, pour l'application de ces dispositions, de l'université de Nice Sophia-Antipolis, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'elle est affectée à l'IUT rattaché à cette université et que le directeur de l'IUT ait eu la qualité d'ordonnateur ; qu'ainsi, il appartenait bien au président de l'université, auquel les dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation confèrent autorité sur l'ensemble des personnels de l'université et auquel elle s'était spontanément adressée, de statuer sur la demande de protection fonctionnelle formulée par l'intéressée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ».
Il convient donc de retenir qu’un agent d’un IUT relève, pour la protection fonctionnelle comme pour le reste, du président de l’université.
Le rapport du médiateur de l’éducation rendu public le 29 juin 2017 s’intéresse à l’application APB
Le 16/07/2017
Dans son ![]() rapport rendu public le 29 juin 2017 au titre de l’année 2016, le médiateur de l’éducation consacre l’une de ses deux parties à l’orientation post-bac et à l’application APB. Plus précisément, il fait état des saisines qu’il a reçus, effectue un bilan de l’application APB et énumère un certain nombre de recommandations pour améliorer le fonctionnement du système.
rapport rendu public le 29 juin 2017 au titre de l’année 2016, le médiateur de l’éducation consacre l’une de ses deux parties à l’orientation post-bac et à l’application APB. Plus précisément, il fait état des saisines qu’il a reçus, effectue un bilan de l’application APB et énumère un certain nombre de recommandations pour améliorer le fonctionnement du système.
Ainsi, il invite notamment l’administration à améliorer la transparence de l’application et souligne les incompréhensions des élèves et parents face à ce système complexe.
Néanmoins, le médiateur impute l’essentiel des dysfonctionnements à la compréhension du système par les élèves sans relever l’étrangeté de certaines des règles de l’application APB.
En effet, s’il mentionne l’existence d’un tirage au sort, il n’en remet en cause ni le principe ni les modalités, alors que cette méthode est unanimement décriée par les universités et les bacheliers, pourtant principaux intéressés par l’admission à l’université.
En outre, et surtout, il n’aborde pas les règles spécifiques d’APB en Ile-de-France, lesquelles imposent aux candidats de solliciter 6 formations en tension pour ne pas être exclus du tirage au sort prioritaire sur les filières à capacité d’accueil limitée qu’ils demandent, règle dont l'existence pourtant attestée par le rapport de l’inspection générale de l’administration de janvier 2016 (voir sur ce point : La présélection par l’application APB est illégale).
Aussi, et malgré le travail certain effectué par le médiateur de l’éducation, il est dommageable que ces thèmes n’aient pas été abordés. En effet, le sentiment ressortant de son rapport est, in fine, que le système fonctionne bien mais que l’information entourant APB doit être améliorée ainsi que certains paramètres de l’application.
Dès lors, le rapport apparaît, par son silence, décevant.
Le 05/07/2017
Jusqu’ici, si les limites et dérives du système APB d’admission à l’université ont été à de nombreuses reprises dénoncées par les étudiants et les universités, le lycée paraissait épargné par les dysfonctionnements rencontrés à l’université. Rappelons que ces dysfonctionnements conduisent dans la pratique à ce que de nombreux bacheliers ne puissent pas s’inscrire à l’université.
Néanmoins, cette année, le système « Affelnet » qui centralise les demandes d’admission des collégiens vers le lycée et affecte ces élèves montre lui aussi ses faiblesses.
En effet, sur l’académie de Paris, plusieurs centaines de collégiens seraient actuellement sans affectation après l’étude des trois choix de ces derniers.
Restera donc à voir si, à la différence de ce qui se passe chaque année pour APB, les dysfonctionnements d’Affelnet seront rapidement traités afin d’éviter la même situation de blocage.
Les filières à « pastille verte » apparemment concernées par le tirage au sort
Le 27/06/2017
Alors que la deuxième phase d’admission APB vient de commencer, de nombreux étudiants, suivis par leurs chefs d’établissement, constatent que des filières à « pastille verte » font l’objet d’un tirage au sort.
En effet, les filières sont réparties sur l’application APB entre les « pastilles vertes » et les « pastilles oranges ». Ce code couleur recouvre donc en principe le partage entre filières à capacité d’accueil limitée (oranges) dont le nombre de places disponibles est fixé à l’avance par l’université et les filières ouvertes (vertes) pour lesquelles il n’existe pas de nombre limite de places disponibles.
Toutefois, les élèves et leurs chefs d’établissements ont pu constater qu’en réalité, des filières à « pastilles vertes » étaient affectées d’un nombre de places limitées et qu’un tirage au sort était réalisé.
Cet élément a été confirmé par le ministère de l’enseignement supérieur, lequel a en minimisé l’impact en indiquant que seules 55 filières à « pastilles vertes » étaient concernées par le tirage au sort.
Il n’en demeure pas moins que cette pratique est étonnante puisqu’en principe le tirage au sort n’est réalisé que dans l’hypothèse où la filière dispose de capacités d’accueil limitées. Or, les capacités d’accueil, si elles sont limitées, sont fixées avant la réception des candidatures.
En effet, les capacités d’accueil sont proposées par les conseils d’UFR, soumises à l’avis du conseil académique et arrêtées par le président de l’université ou son conseil d’administration.
Ce processus long a donc lieu avant les inscriptions et les résultats APB.
Dans ces conditions, le constat effectué par les futurs bacheliers et leurs enseignants ne peut avoir que deux sens :
- Soit l’application indique, à tort, en « pastilles vertes » des filières à capacités d’accueil limitée.
- Soit les universités ont, au cours des inscriptions, fixé des limites aux capacités d’accueil sans que le processus prévu soit respecté.
Dans tous les cas, cela signifie que les futurs étudiants, déjà perturbés par le système APB particulièrement obscure (voir notamment sur ce point : La présélection par l’application APB est illégale), ont été induits en erreur, ceux-ci pensant être assurés d’obtenir une affectation en sélectionnant une filière à « pastille verte » alors que, de toute évidence, tel n’était pas le cas.
Le tirage au sort pour l’entrée à l’université disparaitra-t-il en 2018 ?
Le 22/06/2017
Lors de sa première interview, la ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a évoqué longuement la question du tirage au sort pour l’entrée à l’université et, plus généralement, les difficultés rencontrées par les universités (manque de moyens et augmentation des effectifs).
En effet, ce tirage au sort est à l’origine de nombreux refus d’admission, jugés injuste par les étudiants.
Interrogée plus spécifiquement sur la question du tirage au sort effectué par l’application APB, la ministre a affirmé que sa disparition était son « objectif », avant d’ajouter : « c’est aussi le but que nous nous sommes fixé avec les représentants des étudiants et des présidents d’université. Il y a un consensus autour de cette question. Le tirage au sort est un système dont on ne peut se satisfaire, c’est le plus injuste qui soit » (Le Parisien, 15 juin 2017).
Ainsi, la disparition du tirage au sort est un objectif sans que la ministre ait pris d’engagements précis sur ce point.
Restera donc à demeurer attentifs à l’issue qui sera donnée aux discussions entre le ministère, les universités et les représentants des étudiants pour la rentrée 2018-2019.
Pour aller plus loin :
Les recours contre les autorisations d'urbanisme en Nouvelle-Calédonie doivent être notifiés
Le 21/06/2017
L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est applicable en Nouvelle-Calédonie
CE. Avis. ch. réu. 22 février 2017, Mme Garcia, n°404007, publiée au Recueil
En vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme métropolitain, les recours contentieux dirigés contre un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir, doivent être notifiés à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation dans les 15 jours de l’introduction du recours.
A défaut de respecter cette obligation de notification, le recours contre l’autorisation d’urbanisme est jugé irrecevable.
Or, jusqu’ici, il avait été jugé sous l’empire de la loi organique du 19 mars 1999, que ces dispositions n’étaient pas applicables en Nouvelle-Calédonie (CE. SSR. 27 avril 2011, SARL Attitude, n° 312093, mentionnée aux tables).
En effet, le Conseil d’Etat avait rappelé que les textes « cités en les reproduisant » du code de justice administrative n’étaient applicables en Nouvelle-Calédonie qu’à condition que les textes reproduits soient eux-mêmes applicables. Le code de l’urbanisme n’étant pas applicable en Nouvelle-Calédonie, l’obligation de notification n’était pas non plus applicable, quand bien-même cette règle était reproduite dans le code de justice administrative.
Toutefois, dans l’avis Mme Garcia du 22 février 2017, la haute juridiction revient à double titre sur cette position.
D’une part, elle rappelle que depuis la loi organique du 3 août 2009, il est expressément prévu que les dispositions relatives à la procédure administrative contentieux sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L’obligation de notification étant une règle de procédure administrative contentieuse, elle est donc applicable depuis 2009 en Nouvelle-Calédonie.
D’autre part, dans cet avis, le Conseil d’Etat revient sur la position adoptée avant l’entrée en vigueur de la loi organique du 3 août 2009. Toutefois, les raisons de ce revirement de jurisprudence ne sautent pas aux yeux à la lecture de l’avis. Elles sont, en revanche, explicitées par les conclusions Crépey.
En effet, le Conseil d’Etat considère que, même avant 2009, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme étaient applicables dans la mesure où le décret du 4 mai 2000, outre l’adoption de la partie réglementaire du code de justice administrative, modifiait l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Or, le décret du 4 mai 2000 prévoyait en son article 6 qu’il était lui-même applicable en Nouvelle-Calédonie. Dès lors, l’article 4 du décret étant relatif à l’obligation de notification, le Conseil d’Etat en déduit que cet article 4 était applicable en Nouvelle-Calédonie.
Quelles que soient les critiques que l’on peut adresser à cette dernière partie du raisonnement, il n’en demeure pas moins que, depuis l’intervention de la loi organique du 3 août 2009, l’obligation de notification touche tous les recours contre des autorisations d’urbanisme en Nouvelle-Calédonie.
Par conséquent, les recours pendant devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ou la cour administrative d’appel de Paris contre des autorisations d’urbanisme sont irrecevables en l’absence de notification.
Désormais, et pour l’avenir, il conviendra donc de procéder à la notification des recours dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme métropolitain.
Le CSA sanctionne C8 et "Touche pas à mon poste"
Le 12/06/2017
Par deux décisions du 7 juin 2017, le CSA a sanctionné la chaine C8 pour des séquences diffusées dans l’émission « Touche pas à mon poste » par deux interdictions de diffuser des publicités pendant respectivement 15 jours et une semaine pendant l’émission en question et dans les 15 minutes précédant et suivant cette émission.
Ces deux sanctions ne sont pas relatives, comme l’on pourrait le croire, à la séquence diffusée il y a quelques semaines au cours de laquelle un jeune homme a été piégé sur un site de rencontres homosexuelles, laquelle a donné lieu à une certaine émotion. En effet, ces sanctions sont relatives à des faits plus anciens, qui avaient également attiré l’attention du public et des médias.
Il s’agit de deux séquences :
- La première diffusée le 3 novembre 2016 au cours de laquelle l’un des chroniqueurs a été contraint (en caméra caché) d’endosser des violences (simulées) par l’animateur (Cyril Hanouna) avant d’apprendre lors de l’émission qu’il ne s’agissait que d’une mise en scène, révélation qui a placé le chroniqueur dans une situation de détresse pendant toute l’émission.
- La seconde diffusée le 7 décembre 2016 au cours de laquelle Cyril Hanouna a pris la main d’une de ses chroniqueuses en lui demandant de deviner les yeux fermés, sur quelle partie de son corps se trouvait sa main (cette main finissant, bien entendu, sur son sexe).
Ce délai entre les événements et leur sanction peut paraître long. Néanmoins, il s’explique par la nécessité pour le CSA de respecter une procédure contradictoire avant de prononcer les sanctions.
En effet, la loi du 30 septembre 1986 prévoit le respect d’une procédure contradictoire semblable à celle d’une procédure pénale (article 42-7 de ladite loi). En effet, le CSA disposant d’un pouvoir de sanction quasi-pénal, il doit respecter le procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, comme toutes les autorités administratives indépendantes.
Dans ces deux décisions, le CSA retient le manquement de la chaine C8 à ses obligations et la sanctionne de ce fait. Plus précisément, il rappelle :
- Les mises en demeure des 30 mars 2010 et 1er juillet 2015,
- Le manquement grave aux obligations de la chaine, celle-ci ayant permis la diffusion d’images « susceptibles d’humilier les personnes », le chroniqueur, régulièrement moqué, ayant été montré pendant tout l’émission dans une situation de détresse et de vulnérabilité manifestes,
- Le manquement grave à l’obligation de veiller à l’image des femmes, la chroniqueuse ayant été placée dans une situation « dégradante » et véhiculant une « image stéréotypée des femmes », cette scène donnant en outre l’impression qu’en telle situation le consentement n’était pas nécessaire, alors que l’émission rencontre un écho particulier auprès du jeune public et que la séquence n’a pas eu lieu en direct de sorte que sa diffusion résulte d’un choix délibéré.
Au vu de ces éléments, le CSA inflige une sanction à la chaine C8.
Toutefois, la sanction prise est relativement légère dans l’échelle de sanction prévue par l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986. En effet, ce texte prévoit l’échelle suivante (par ordre croissant de sévérité) :
- Suspension de la diffusion du service, d’une catégorie de programmes, d’une partie d’un programme ou de séquences publicitaires pendant maximum un mois (qui est la sanction appliquée),
- Réduction de la durée de l’autorisation de diffuser d’un an maximum,
- Sanction pécuniaire assortie, le cas échéant, d’une suspension de la diffusion du service ou d’une partie des programmes,
- Retrait de l’autorisation de diffuser.
Il doit également être indiqué que la chaine C8 peut former un recours contre ces sanctions devant le Conseil d’Etat (article 42-8 de la loi du 30 septembre 1986).
Restera donc à voir si la chaine fera usage de cette possibilité.