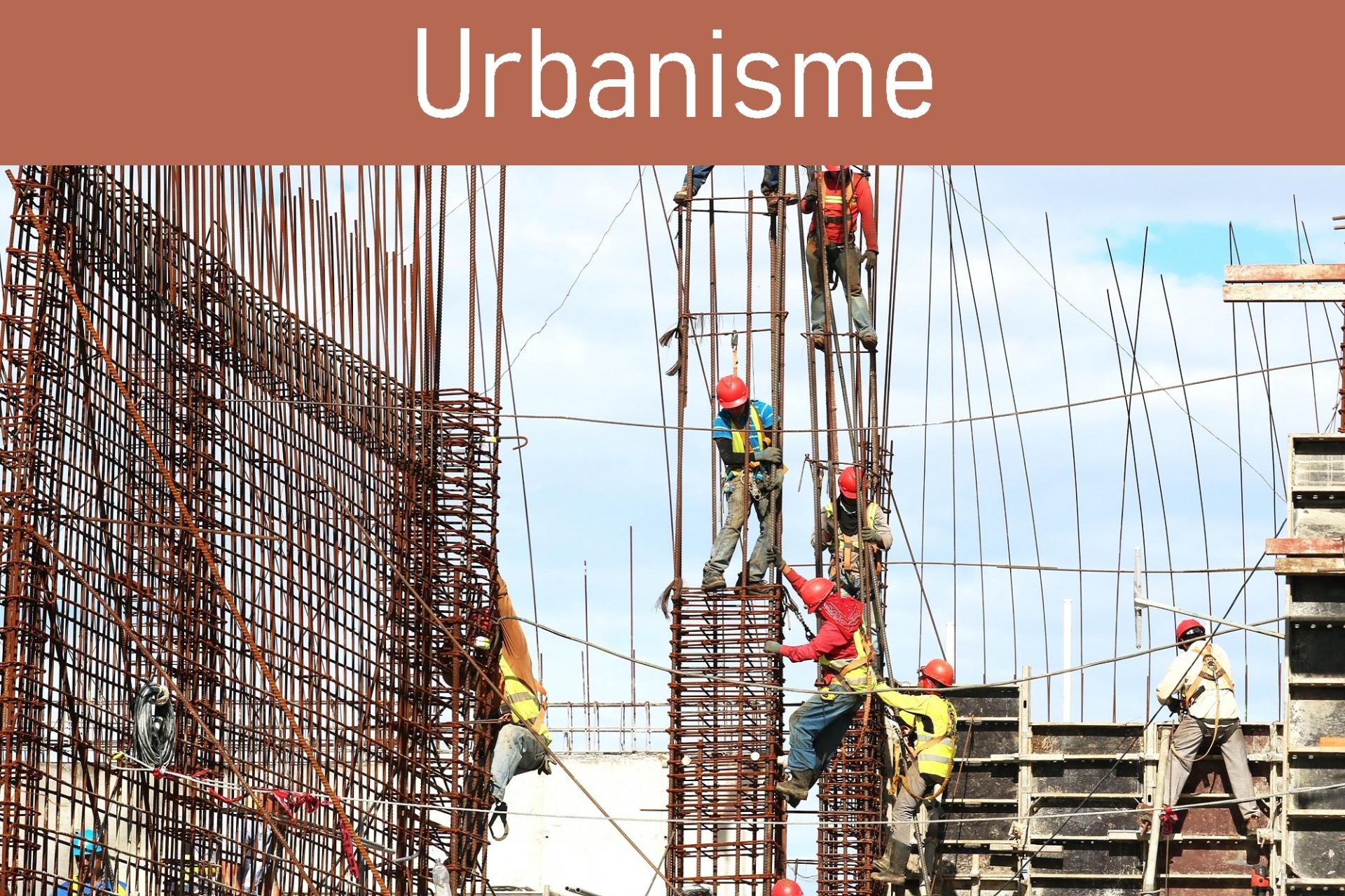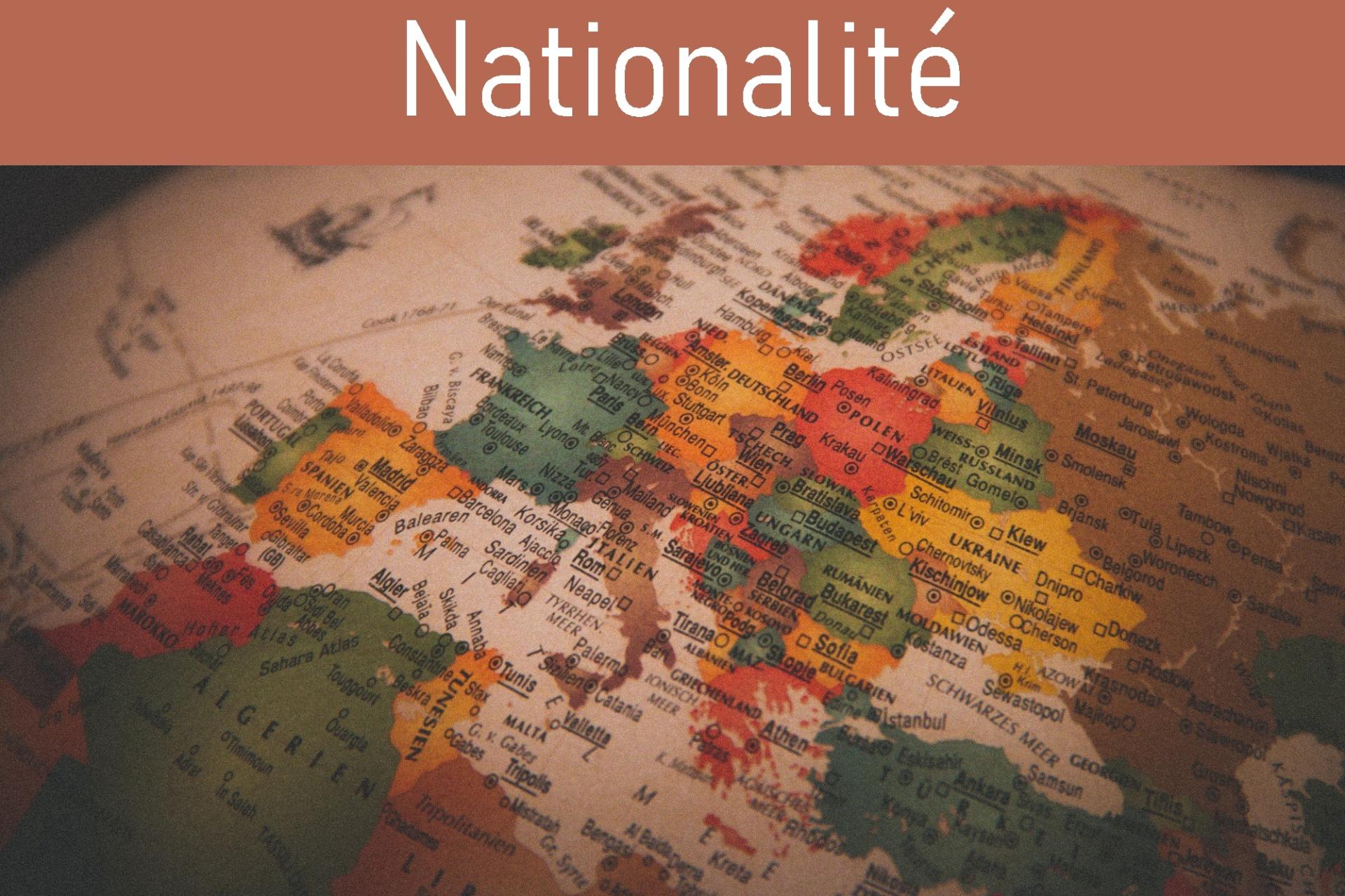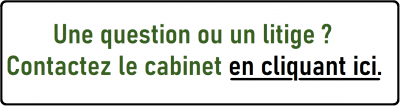Melian Avocats AARPI
Actualités
L'interêt à agir contre un permis de construire doit être bien justifié par l'avocat
Le 03/04/2019
Par une décision n° 422460 du 18 mars 2019, le Conseil d'Etat vient faire application des règles (désormais plus restrictives) en matière d'intérêt à agir contre un permis de construire en estimant qu'un voisin, qui était séparé du terrain d'assiette du projet par une parcelle boisée de 67 mètres de large, et dont l'habitation était éloignée de 200 mètres de la future construction, n'avait pas intérêt à agir contre le permis de construire délivré au demandeur.
En effet, pour pouvoir contester un permis de construire, il est nécessaire d'avoir un « intérêt à agir » contre cette décision administrative. C'est-à-dire d'être lésé ou susceptible d'être lésé de manière plus ou moins directe par cette décision.
1. De manière générale en contentieux administratif, le Conseil d'Etat entend assez largement l'intérêt à agir afin de faire respecter la légalité. Il n'est donc pas extrêmement exigent quant aux intérêts que les requérants mettent en avant pour justifier la recevabilité de leur recours.
En revanche, en matière de contentieux de l'urbanisme et notamment de permis de construire, la haute juridiction a toujours eu une appréciation un plus restrictive de cet intérêt. Ainsi, traditionnellement, le Conseil d'Etat et les juridictions administratives se fondaient sur trois éléments (voir, par exemple, en ce sens : CE. SSR. 27 octobre 2006, n° 286569, mentionnée aux tables) pour apprécier l'existence ou non d'un intérêt à agir :
- la distance entre le projet et l'habitation du requérant,
- la nature et l'importance du projet,
- la configuration des lieux.
Bien que plus restrictifs que les critères habituels prévalant pour le recours contre les autres décisions administratives, ces critères restaient relativement larges et permettaient assez facilement aux personnes du voisinage, sauf configuration très particulière, de contester un permis de construire.
Toutefois, avec la réforme du 18 juillet 2013 (ordonnance n° 2013-638), la notion d'intérêt à agir a été définie avec davantage de rigueur.
En vertu de ces dispositions nouvelles, l'intérêt à agir contre un permis de construire n'est désormais reconnu que si le projet est de « nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu[e le requérant] détient ou occupe ». L'objectif de cette réforme était, de manière claire, de limiter les recours formés par les voisins et leurs avocats contre les projets d'urbanisme.
Au vu de la rédaction retenue, il était difficile en 2013 d'apprécier si les exigences des juridictions seraient drastiques ou non.
En effet, il aurait été envisageable que cette affectation directe des conditions d'occupation se résume, par exemple, à une perte d'ensoleillement ou une gêne directe et démontrée (bruit, vue, etc.). Auquel cas seuls les voisins directs (et encore) auraient été regardés comme disposant éventuellement d'un tel intérêt.
Cependant, par deux décisions (CE. SSR. 10 juin 2015, n° 386121, publiée au Recueil ; CE. SSR. 13 avril 2016, n° 389798, publiée au Recueil), le Conseil d'Etat est venu préciser la portée qu'il fallait donner à ces dispositions.
Il a ainsi défini la méthode qui doit être suivie pour apprécier l'existence ou non d'un intérêt à agir :
- Tout d'abord, le requérant ou son avocat, doit avancer les éléments précis qui démontrent selon lui que les conditions d'occupation ou de jouissance du bien qu'il occupe sont affectées (nuisances principalement),
- Ensuite, le défendeur ou son avocat doit au contraire apporter tous les éléments démontrant le contraire,
- Enfin, en conclusion – et c'est là que l'apport du Conseil d'Etat est le plus important – le juge doit écarter les arguments insuffisamment étayés mais ne doit pas exiger « la preuve du caractère certain des atteintes » invoquées par le requérant ou son avocat.
Autrement dit, si le requérant et son avocat soutiennent que des nuisances vont être subies, elles doivent seulement être crédibles, il n'est pas nécessaires qu'elles soient démontrées.
C'est la raison pour laquelle dans la décision du 10 juin 2015, le Conseil d’Etat a jugé que le recours contre le permis de construire autorisant une station de conversion électrique à 700 mètres du domicile des requérants était recevable même si les requérants et leurs avocats ne démontraient pas la nuisance sonore émanant de cette station.
En effet, il n'était pas contesté qu'une station existante, située à 1,6 km, causait des nuisances sonores pour les requérants.
L'entreprise défenderesse faisait valoir que la nouvelle station utiliserait des technologies différentes et empêcherait ainsi les nuisances. Toutefois, le Conseil d'Etat constate que cette société n'apporte par la preuve de cette absence de nuisances concernant la future station et se contente de l'affirmer. C'est pourquoi il conclut à la recevabilité du recours.
Ainsi, cela montre que contrairement à ce que l'on pouvait penser initialement, toute la charge de la preuve de l'intérêt à agir ne pèse pas sur le requérant et sur son avocat mais se trouve partagée entre les parties.
De plus, par la décision du 13 avril 2016, il a créé une présomption d'intérêt à agir du voisin direct s'il fait état de la nature, de l'importance et de la localisation du projet. Autrement dit, il ne dispense pas le requérant et son avocat de se prévaloir de nuisances mais facilite leur preuve.
Dès lors, et dans tous les cas désormais, il appartient aux avocats de prendre bien soin, dans chaque recours contre un permis de construire – et dès le stade de la requête – de se prévaloir des nuisances subies par les requérants.
2. C'est donc au vu de ce contexte juridique qu'a été rendue la décision du 18 mars 2019 ici commentée dans laquelle le Conseil d'Etat vient faire application des principes exposés dans ses précédentes décisions.
Dans cette affaire, était en cause la construction d'une habitation dans une zone relativement inhabitée et principalement boisée. Le permis de construire avait été attaqué par un voisin dont la propriété était séparée du terrain d'assiette de la nouvelle construction par une parcelle de 67 mètres de large, apparemment boisée. La construction nouvelle devait se trouver à 200 mètres environs de la construction existante.
Pour justifier son intérêt à agir, le requérant et son avocat se prévalaient de ce que les boisements présents ne suffisaient pas à « occulter toute vue et tout bruit ». Le juge du référé avait considéré que cet argument était suffisant pour que le recours soit jugé recevable.
Toutefois, le Conseil d'Etat considère que ces éléments n'étaient pas suffisants. En effet, il estime qu'il n'est pas possible de se fonder sur la seule circonstance que les boisements séparant le terrain d'assiette n'occulteraient pas « toute vue et tout bruit » pour juger le recours recevable. Il annule donc l'ordonnance rendue par le juge des référés.
Cette décision permet donc, une nouvelle fois, au Conseil d'Etat de préciser sa jurisprudence en la matière au vu des principes qu'il a antérieurement posés.
D'une part, l'on en déduit qu'un voisin, dont la propriété est séparée par une parcelle (même non construite) du terrain d'assiette du projet n'est pas un voisin direct. En effet, le Conseil d'Etat ne fait pas mention dans sa décision de la présomption qu'il avait posée au bénéfice des voisins directs.
Cette solution paraît logique dans la mesure où même s'il n'y a aucune habitation entre les deux terrains d'assiette, le voisinage n'est matériellement pas direct.
Toutefois, il faut conserver à l'esprit que cette solution a été rendue au vu de la situation géographique de cette affaire. En effet, dans une hypothèse plus délicate où les deux terrains seraient séparés par une parcelle de petite taille, il n'est pas certain que le Conseil d'Etat n'aurait pas fait jouer la présomption. Si les deux terrains n'avaient été séparés que par une parcelle de quelques mètres, il n'aurait sans doute pas vu cette parcelle comme un obstacle au jeu de la présomption. Mais dans la présente espèce où les deux terrains étaient séparés par une parcelle de 67 mètres de long, la logique voulait que la présomption ne joue pas. Et ce, d'autant que la construction autorisée par le permis de construire devait être érigée à 200 mètres de la construction existante.
D'autre part, cette décision montre que si le Conseil d'Etat n'exige pas la « preuve du caractère certain des atteintes » invoquées par le requérant et son avocat pour justifier l'intérêt à agir, il demeure néanmoins nécessaire que ces atteintes présentent une certaine crédibilité.
En effet, le simple fait qu'il n'existe pas un bois d'une importance suffisante permettant d'occulter toute vue et tout bruit ne suffit pas à caractériser l'affectation des conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance du bien.
Cette solution apparaît, ici encore, logique au vu des exigences des nouveaux textes. Sauf à vider de leur substance les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, il n'est pas possible de considérer que la construction d’une habitation située à 200 mètres et séparée par des terrains boisés constitue une « atteinte » aux conditions de jouissance du bien si le requérant et son avocat ne se prévalent pas d'arguments précis.
En effet, il convient de conserver à l’esprit que la solution retenue par le Conseil d’Etat n'est pas une position de principe. Il prend bien soin de préciser que ces éléments ne suffisent pas « à eux seuls » à caractériser une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien.
Autrement dit, si le requérant et son avocat s'étaient prévalus de cette circonstance et d'autres arguments (par exemple une augmentation du trafic routier, une vue directe sur leur jardin, etc.), le recours aurait pu être jugé recevable. Mais, le seul élément – relativement abstrait – tiré de ce que les arbres n'occulteraient pas toute vue et tout bruit n'est pas suffisant.
3. En conclusion, à la lecture de cette décision et des précédentes, il est certain que les requérants et leurs avocats doivent être particulièrement attentifs aux arguments avancés pour justifier l'intérêt à agir contre un permis de construire.
En effet, il ne suffit pas d'avancer des arguments abstraits tels que l'existence d'une vue, ou la possibilité éventuelle d'entendre le bruit. Il est nécessaire d'avancer des arguments crédibles et étayés par la situation très concrète des lieux.
De plus, et par sécurité, cette démonstration devrait désormais être réalisée a priori dès le dépôt de la requête par l'avocat, sans attendre que le mémoire en défense soulève cette irrecevabilité. En effet, si cette démonstration n'est pas réalisée et étayée d'emblée, il existe un risque non négligeable que le juge se saisisse immédiatement du moyen. Pour éviter cet écueil et limiter au maximum le débat sur cette question, il est donc préférable de justifier dès l'origine la recevabilité du recours.
Le 30/03/2019
Par une décision n° 409872 du 9 novembre 2018, le Conseil d'Etat vient appliquer la jurisprudence M. Czabaj (CE. Ass. 13 juillet 2016, n° 387763, publiée au Recueil) au contentieux du permis de construire et limite, en principe, à un an le recours contre les permis de construire qui ont été affichés sans mentionner le délai de recours.
1. En effet, s'agissant des autorisations d'urbanisme (permis de construire, non-opposition à déclaration préalable, etc.), les délais de recours ne commencent pas à courir à compter de la publication de la décision par l'autorité publique.
Le délai de recours commence à courir pour les tiers à compter de l'affichage du permis de construire sur le terrain (article R. 600-2 du code de l'urbanisme). Cet affichage, pour faire courir le délai de recours, doit comporter un certain nombre de mentions prévues aux articles R. 424-15 et A. 424-15 et suivants du code de l'urbanisme (l'absence de certaines mentions est cependant sans incidence sur le départ du délai de recours).
Toutefois, le code de l'urbanisme prévoit lui-même une limite en l'absence d'affichage du permis de construire (ou en cas d'affichage défectueux). En effet, il n'est plus possible, même en l'absence d'affichage, de contester un permis de construire au terme d'un délai de six mois à compter de l'achèvement des travaux (article R. 600-3 du code de l'urbanisme).
L'idée derrière ces dispositions est que les tiers ont parfaitement eu le temps, en constatant la réalisation des travaux, de s'interroger sur la consistance du projet et d'aller consulter le permis de construire en mairie. S'ils n'ont pas cru bon de contester le permis de construire pendant la construction et dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux, alors leur inertie s'oppose à ce qu'ils puissent contester indéfiniment le projet.
2. En matière de contentieux administratif général, les règles de base sont différentes. Le principe qui prévalait jusqu'ici était que la notification d'une décision ne faisait pas courir les délais de recours si cette notification ne comportait pas les voies et délais de recours (R. 421-5 du code de justice administrative). Or, ce principe a connu il y a quelques années une atténuation jurisprudentielle importante.
Avant cela, et par application stricte de ces dispositions, le Conseil d'Etat considérait que si la notification d'une décision ne comportait pas les voies et délais de recours, la décision pouvait être contestée indéfiniment par celui qui l'avait reçue.
Néanmoins, par la jurisprudence M. Czabaj, le juge de cassation a mis un terme à cette interprétation littérale du texte en estimant que même en l'absence de notification comportant les voies et délais de recours, l'intéressé devait contester dans un délai raisonnable la décision en cause s'il l'avait bien reçue. Ce délai raisonnable était fixé à un an, sauf circonstances particulières.
3. Par la décision commentée, le Conseil d'Etat vient appliquer ce principe général au contentieux de l'urbanisme dans lequel il existait déjà une limite temporelle textuelle en l'absence d'affichage du permis de construire.
Transposant son raisonnement, il considère que si un permis de construire (ou une autre autorisation d'urbanisme) a été affiché et si cet affichage comporte les mentions exigées par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme mais n'indique pas le délai de recours, alors le permis de construire ne pourra plus être contesté au-delà d'un délai raisonnable d'en principe un an.
Ainsi, il limite la portée de la décision de principe M. Czabaj en contentieux de l'urbanisme pour tenir compte de sa spécificité.
Autrement dit, il y aura désormais 4 cas à distinguer :
- Le permis de construire a été affiché et comporte les toutes les mentions exigées par l'article R. 424-15 et les articles A. 424-15 et suivants du code : le délai de recours de deux mois commence à courir à compter de l'affichage.
- Le permis de construire n'a pas été affiché : il peut être contesté jusqu'au terme d'un délai de six mois à compter de l'achèvement des travaux.
- Le permis de construire a été affiché mais cet affichage ne contient pas certaines des mentions exigées par l'article R. 424-15 et les articles A. 424-15 ou A. 424-16 du code : la question de l'opposabilité n'est pas réglée par la décision commentée. Il faut donc considérer que la jurisprudence antérieure continue à s'appliquer, c'est-à-dire qu'il faudra apprécier la nature des omissions pour déterminer si elles permettent de regarder le délai de deux mois comme opposable ou non. S'il n'est pas opposable, le permis de construire peut être contesté jusqu'au terme du délai de six mois à compter de l'achèvement des travaux.
- Le permis de construire a été affiché et contient toutes les informations exigées par les articles R. 424-15, A. 424-15 et A. 424-16 du code mais pas celles relatives au délai de recours de deux mois (article A. 424-17 du code) : il peut être contesté à l'expiration du premier de ces deux délais :
- 1 an à compter du début de l'affichage,
- 6 mois à compter de l'achèvement des travaux.
Ainsi, loin de simplifier les choses, l'application partielle de la jurisprudence M. Czabaj vient complexifier la détermination du délai de recours applicable.
Voir, sur la question du caractère définitif du permis de construire l'article : A quelle date un permis de construire est-il définitif ?
Le 20/03/2019
Par une décision n° 412542 du 25 octobre 2018, le Conseil d'Etat a indiqué que le juge administratif n'avait pas à contrôler le contenu des études exigées par les plans de prévention des risques à l'occasion des demandes de permis de construire, mais devait se borner à vérifier la présence au dossier de l'attestation de l'architecte indiquant que ces études existaient bien.
Il est nécessaire de rappeler d'emblée que l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier de demande de permis de construire doit comporter une attestation de l'architecte confirmant la réalisation des études exigées par les plans de prévention des risques (naturels, miniers ou technologiques).
En effet, les plans de préventions des risques prévoient, dans certaines zones qu'il déterminent, l'obligation pour un constructeur d'effectuer une étude assurant la prise en compte des exigences de ce plan à l'occasion des demandes de permis de construire. L'article R. 431-16 du code de l'urbanisme indique que, dans cette hypothèse, le dossier doit comporter une attestation de l'architecte ou d'un expert, certifiant que cette étude a été réalisée et que le projet en tient compte.
Cette obligation apparaît logique dans la mesure où elle vise à assurer la prise en compte et l'effectivité de ces plans de prévention des risques.
C'est la raison pour laquelle le tribunal administratif de Montreuil avait considéré, à la demande du requérant, qu'il lui incombait également de vérifier le contenu de cette étude et en avait déduit que la seule attestation produite n'assurait pas la prise en compte de cette étude par le projet dès sa conception.
Dans la décision commentée, le Conseil d'Etat censure ce raisonnement en estimant que le juge doit se borner à vérifier l'existence de l'attestation au dossier.
Cette solution est conforme à la lettre du texte de l'article R. 431-16 du code de l’urbanisme qui exige seulement la présence au dossier de l'attestation.
Il convient néanmoins d'en tempérer la portée puisqu'une lecture rapide peut laisser penser que cette décision fait obstacle au contrôle par le juge administratif du respect des plans de prévention des risques lors de l'instruction des permis de construire. Or, une telle lecture est erronée.
En effet, les dispositions des plans de prévention des risques doivent être respectées par les dossiers de permis de construire. Comme l'a déjà jugé le Conseil d'Etat, les plans de prévention des risques sont des servitudes d'urbanisme qui s'imposent directement aux permis de construire. De la sorte, il appartient à l'administration de les appliquer et de refuser, le cas échéant, un permis de construire qui y serait contraire (CE SSR. 4 mai 2011, Commune de Fondettes, n° 321357, mentionnée aux tables).
Ainsi, les plans de prévention des risques doivent bien être respectés.
La décision commentée porte en réalité sur des zones assez précises où les plans de prévention des risques ne prévoient pas d'interdiction ou de restriction à la construction mais imposent la réalisation d'études.
Autrement dit, au vu des décisions précités :
- Le maire doit contrôler le respect des dispositions des plans de prévention des risques lors de l'instruction des permis de construire (interdictions, conditions, etc.),
- Mais le maire n'a pas à contrôler le contenu des études que peuvent exiger par les plans de prévention des risques, mais seulement se borner à vérifier que l'attestation exigée par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est au dossier. Tel est donc l'apport de la décision commentée.
Précisions sur le délai de recours du préfet (déféré) contre un permis de construire tacite
Le 10/03/2019
Par une décision n° 400779 du 22 octobre 2018, le Conseil d'Etat est venu préciser les délais dans lesquels le préfet peut contester un permis de construire tacite lorsqu'il n'a reçu qu'un dossier incomplet.
Le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion de régler la question du départ du délai de recours dont dispose le préfet à l'égard des permis de construire explicites et tacites. En effet, le permis de construire fait partie des actes que les collectivités territoriales ont l'obligation de transmettre au préfet pour qu'il exerce son contrôle de légalité. S'il estime le permis illégal, il peut le déférer au juge administratif dans un délai de deux mois.
Se pose donc nécessairement la question de savoir quand ce délai de deux mois commence à courir.
Lorsque le permis de construire est explicite, la réponse est assez simple. Le délai commence à courir à compter de la transmission de la décision de permis de construire est transmise au préfet. Concernant les permis tacites (qui naissent du silence de l'administration), la question est nécessairement plus compliquée.
Il a déjà été jugé que la transmission de l'entier dossier de demande (qui est en principe obligatoire) valait information du préfet, de sorte que le délai de recours de ce dernier commençait à courir à compter de la date à laquelle le permis de construire tacite était acquis (CE. SSR. 17 décembre 2014, n° 373681, mentionnée aux tables).
Dans la décision qui nous intéresse, le Conseil d'Etat vient préciser ce principe en indiquant, assez logiquement, que si le dossier de demande de permis de construire transmis au préfet est incomplet, alors le délai de recours ne commence pas à courir pour ce dernier.
Dès lors, si la commune demande au pétitionnaire des pièces complémentaires au cours de l'instruction du permis de construire (et même si elle n'en informe par le préfet en parallèle), le dossier qu'elle a transmis est regardé comme incomplet et le délai de recours du préfet ne commence pas à courir, sauf à ce qu'elle transmette les pièces complémentaires au préfet.
Voir, sur la question du caractère définitif du permis de construire l'article : A quelle date un permis de construire est-il définitif ?
Le 28/02/2019
Par une décision n° 412104 du 12 octobre 2018 le Conseil d'Etat rappelle qu'il n'est pas possible, après annulation d'un refus de permis de construire de manière définitive, de refuser ce permis pour l'un des motifs censurés par le juge, sauf évolution ultérieure des circonstances de fait.
En effet, dans l'affaire étudiée par le Conseil d'Etat, la société requérante avait sollicité, en 2007, l'octroi d'un permis de construire un parc éolien. Elle s'était vu opposer un refus par le préfet au motif que, par son impact visuel, le parc éolien portait atteinte à l'intérêt d'un château classé monument historique situé dans son champ de visibilité.
Toutefois, les juridictions administratives avaient annulé ce refus en estimant que l'impact visuel sur le monument historique était faible et n'y portait donc pas atteinte.
Exécutant cette décision, le préfet avait donc accordé ce permis de construire en 2011.
Un nouveau recours avait été formé contre ce permis de construire et le tribunal administratif, puis la cour, avaient annulé ledit permis en estimant cette fois que des éléments nouveaux faisaient apparaître une forte covisibilité entre le projet et un autre monument historique, et que de nouveaux photomontages montraient la forte prégnance visuelle du projet sur un site classé également proche.
Dans la décision commentée, le Conseil d'Etat censure ce raisonnement par application du principe de l'autorité de la chose jugée.
En effet, l'autorité de la chose jugée s'attache à l'ensemble des décisions de justice devenues définitives. Elle concerne non seulement le dispositif (le sens de la décision : annulation ou rejet) mais également les motifs de cette décision (les raisons pour lesquels le juge est parvenu à cette conclusion : CE. Sect. 28 novembre 1949, Société des automobiles Berliet, publiée au Recueil p. 579).
Au cas présent, les juges avaient finalement retenu le même motif que celui qu'ils avaient censuré quelques années auparavant par une décision devenue définitive (le jugement annulant le refus initial de permis de construire n'ayant pas été contesté).
Le Conseil d'Etat censure, assez logiquement ce raisonnement.
Même si les raisons retenues pour censurer le permis de construire délivré étaient quelques peu différentes de celles qui avait été initialement avancées pour refuser le permis de construire quelques années plus tôt, elles relevaient du même motif : l'impact visuel du projet.
Or, le Conseil d'Etat estime que « sans relever aucun changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait », la cour ne pouvait pas annuler le permis de construire pour ce motif, l'autorité de la chose y faisant obstacle.
Autrement dit, les juges auraient pu censurer le permis de construire du fait de son impact visuel (malgré le jugement contraire antérieur) si l'environnement avait évolué. Par exemple si un obstacle à la covisibilité entre deux bâtiments avaient disparu. En effet, si un immeuble qui était placé entre un monument historique et le parc éolien avait disparu, rendant celui-ci visible depuis un monument historique, alors la situation de fait aurait été nouvelle. Assez logiquement, le juge aurait alors été libre d'apprécier l'impact de cet élément nouveau sur la légalité du nouveau permis qui lui était soumis.
Cependant, en l'espèce, la situation de fait était restée la même. Seule l'argumentation avait été différente et apparemment fondée sur des photomontages plus parlants. Ces faits n'étant pas nouveau, le Conseil d'Etat considère que l'autorité de la chose jugée s'oppose à une annulation du permis de construire délivré.
Ainsi, à situation de droit et de fait constante, il n'est pas possible d'utiliser un motif qui a été censuré par le juge. Cette solution classique est à rapprocher de celle adoptée s'agissant des injonctions que le juge administratif peut prononcer en cas d'annulation d'un permis de construire (CE. CHR. Avis. 25 mai 2018, Préfet des Yvelines, n° 417350, publié au Recueil).
Le 20/02/2019
Par une décision n° 406222 du 3 octobre 2018, le Conseil d'Etat est venu préciser les conséquences qu'il convenait de donner à un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) jugeant qu'un ressortissant étranger courrait, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
● En effet, il convient de conserver à l'esprit que la CEDH n'est pas une juridiction d'appel ou de cassation placée au sommet de l'ordre juridique interne. Aussi, ses décisions ne font pas disparaître les jugements ou arrêts rendus par les juridictions internes qui lui seraient contraires.
C'est là une grande différence avec les juridictions de cassation internes (Cour de Cassation et Conseil d'Etat) qui font disparaître les arrêts et jugements rendus antérieurement s'ils les annulent.
La CEDH n'a pas de pouvoir d'annulation des jugements et arrêts internes.
En revanche, les arrêts de la Cour ont un caractère obligatoire pour les Etats, qui doivent les exécuter en vertu de l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Se pose donc régulièrement la question de la manière dont il convient de tenir compte de ces arrêts lorsque des décisions définitives contraires ont été rendues par les juridictions internes et ne peuvent donc plus être rapportées au moment où intervient l'arrêt de la Cour.
● En l'espèce, l'intéressé, qui s'était vu opposer un refus à la demande d'asile qu'il avait formée par l'OFPRA, avait contesté ce refus devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans succès.
A la suite de ces échecs et de l'obligation qui lui avait été imposée de quitter le territoire français, il avait saisi la CEDH en persistant à affirmer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il était exposé à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la Convention. La Cour lui avait donné raison par un arrêt devenu définitif.
Fort de cet arrêt positif, il avait demandé le réexamen de sa demande d'asile à l'OFPRA, mais cette demande avait été rejetée et la CNDA saisie par lui avait confirmé ce refus en estimant que les risques dont il se prévalait n'étaient pas établis.
Le requérant s'est alors pourvu devant le Conseil d'Etat.
Ce dernier considère, dans la décision commentée, que la CNDA a commis une erreur de droit.
En effet, il rappelle qu'il appartient aux Etats parties à la Convention d'exécuter les arrêts de la Cour. Or, il juge que la complète exécution de l'arrêt de la CEDH impliquait en l'espèce que les autorités françaises octroient la protection subsidiaire au demandeur.
Le Conseil d'Etat indique néanmoins une limite, à savoir qu'il appartient à l'OFPRA et à la CNDA de vérifier que l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouve pas à s'appliquer (CESEDA).
Cet article permet en effet de s'opposer à l'octroi de la protection subsidiaire dans différentes hypothèses (lorsque la personne a commis un crime grave ou un crime contre la paix, la guerre ou l'humanité, ou d'autres circonstances du même ordre listées par cet article).
En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que la CNDA ne pouvait refuser la protection subsidiaire que si l'article L. 712-2 du CESEDA s'y opposait. N'ayant pas relevé que ledit article s'opposait à l'octroi de la protection subsidiaire à l'intéressé, la CNDA a commis une erreur de droit.
● Ainsi, pour donner un plein effet à l'arrêt de la CEDH, l'OFPRA et la CNDA ne peuvent plus considérer que l'individu n'établit pas être soumis à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et doivent donc accorder la protection subsidiaire à celui qui la demande.
Ils peuvent seulement s'opposer à l'octroi de cette protection si un des motifs énumérés à l'article L. 712-2 du CESEDA s'y oppose.
Dès lors, par cet arrêt, le Conseil d'Etat donne une force qui s'approche de l'autorité de la chose jugée aux arrêts rendus par la CEDH.
Cette solution est d'ailleurs à comparer avec celle que la haute juridiction avait adoptée il y a quelques années à propos d'une décision de la CEDH demandant au gouvernement français de ne pas renvoyer un requérant dans son pays d'origine le temps qu'elle traite son recours (CE. CHR. 9 novembre 2016, n° 392593, mentionnée aux tables).
En effet, le Conseil d'Etat avait jugé que cette décision de la Cour s'opposait seulement au renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine mais n'obligeait pas la CNDA à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la CEDH.
Cette différence d'autorité accordée à ces deux décisions de la Cour s'explique dans la mesure où dans l'affaire de 2014, la CEDH ne s'était pas prononcée sur le recours du requérant mais avait simplement demandé aux autorités françaises de ne pas le renvoyer dans son pays d'origine dans l'attente de son arrêt. Il était donc logique que cette décision, qui ne se prononçait pas sur le litige de l'intéressé ne fasse pas obstacle à la poursuite de la procédure devant la CNDA et, éventuellement, au rejet de sa demande.
La seule obligation de la France était alors d'attendre l'arrêt de la Cour qui devait se prononcer sur le recours de l'intéressé.
Dans l'affaire ici commentée, la décision de la CEDH en cause est à un stade ultérieur puisqu'il s'agit de son arrêt définitif se prononçant sur le risque encouru par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. Elle n'a donc pas le même objet que dans l'affaire de 2014.
C'est ce qui explique la différence d'autorité accordée à ces deux décisions.
Le 07/02/2019
Par une décision n° 412897 du 1er octobre 2018, le Conseil d'Etat rappelle qu'il peut être mis fin, pour l'avenir, à la protection fonctionnelle octroyée à un agent lorsqu'il apparaît que cette protection n'est pas plus due (ou ne l'a jamais été). Il précise qu'en matière de protection accordée en raison d'un harcèlement moral, l'intervention d'un jugement non-définitif des juridictions judiciaires ne retenant pas le harcèlement ne suffit pas à justifier qu'il soit mis fin à la protection. En revanche, les éléments révélés à cette occasion peuvent justifier l'arrêt de cette protection.
Il est désormais bien établi que la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 doit être octroyée à un agent public qui subi un harcèlement moral (voir sur ce point l'article : Harcèlement moral, protection fonctionnelle et droit de retrait).
Sur le fondement de ces dispositions, il arrive que la protection soit accordée à un agent qui s'estime harcelé. C'est ce qui s'était passé dans l'espèce jugée par le Conseil d'Etat.
Dans cette affaire, l'agent en question avait attaqué civilement et pénalement les auteurs présumés de ce harcèlement devant les juridictions judiciaires.
Or, ces dernières avaient considéré que le harcèlement n'était pas établi mais ce jugement avait été frappé d'appel.
Face à cette situation, l'administration avait considéré que la protection fonctionnelle n'était plus due. L'agent ayant contesté le terme mis pour l'avenir à sa protection fonctionnelle, la cour administrative d'appel saisie du litige avait considéré que, du fait du jugement rendu par les juridictions judiciaires, l'administration avait à bon droit mis un terme à la protection de son agent.
Saisi de ce litige, le Conseil d'Etat censure ce raisonnement en estimant : d'une part, que le jugement non-définitif rendu par les juridictions judiciaires ne pouvait justifier à lui seul la fin de la protection fonctionnelle et, d'autre part, qu'en revanche, les éléments nouveaux mis en lumière à l'occasion de cette procédure pouvaient justifier qu'il soit mis un terme à la protection.
Les précisions du Conseil d'Etat sur les possibilités de mettre un terme à la protection fonctionnelle d'un agent public octroyée en raison d'un harcèlement moral sont donc doubles.
En effet, il était d'ores et déjà établi que l'administration pouvait mettre un terme pour l'avenir à la protection fonctionnelle d'un agent lorsqu'il apparaissait qu'elle n'était plus justifiée ou ne l'avait jamais été (voir, sur ce point : CE. Sect. 14 mars 2008, M. André A, n° 283943, publiée au Recueil). En cela, la décision commentée n'apporte rien de nouveau, ce principe étant déjà établi. En revanche, elle apporte des précisions utiles en matière de protection fonctionnelle pour harcèlement.
● En premier lieu, le Conseil d'Etat indique que l'intervention d'une décision du juge judiciaire ne retenant pas la qualification de harcèlement moral ne justifie pas à elle seule le terme mis à la protection si cette décision du juge judiciaire n'est pas devenue définitive.
Cette solution apparaît logique dans la mesure où si le juge judiciaire est encore saisi en appel de la situation, alors elle n'est pas tranchée de manière définitive.
Cela signifie, a contrario, que si la décision du juge judiciaire qui ne retient pas la qualification de harcèlement moral est définitive, l'administration peut se borner à faire mention de cette décision pour justifier l'abrogation de la décision de protection.
● En second lieu, et dans la mesure où l'administration peut mettre un terme à la protection si elle n'apparaît pas ou plus justifiée, l'administration peut en revanche tenir compte des éléments qui auraient pu apparaître à l'occasion du procès devant le juge judiciaire.
En effet, si au cours des débats, des éléments dont elle n'avait pas connaissance apparaissent et lui permettent de considérer que sa protection n'était pas justifiée, alors elle peut les utiliser pour mettre un terme à sa protection. Mais elle doit alors justifier sa décision par ces éléments nouveaux et on par l'intervention du jugement en lui-même.
Le refus de naturalisation, le centre des intérêts et la résidence
Le 15/12/2018
Par une décision n° 416358 du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat rappelle que pour être naturalisé, un postulant doit avoir, en France, le « centre de ses intérêts ».
A la lecture des dispositions du code civil, une telle condition ne va pas de soi. En effet, le code civil se borne à exiger à son article 21-16, que le postulant réside en France à la date de sa naturalisation.
Toutefois, dans la pratique, l’administration et la jurisprudence sont allées plus loin en exigeant que le postulant ait le « centre de ses intérêts » en France (voir, par exemple, en ce sens : CE. Sect. 28 février 1986, n° 57464, publiée au Recueil) pour être naturalisé.
Dès lors, et en réalité, une condition supplémentaire à celle exigée par le texte (la résidence) a été ajoutée (le centre des intérêts).
Ainsi, à titre d’exemple, un étudiant, qui reçoit pour vivre de l’agent de l’étranger venant de sa famille n’est pas considéré comme ayant en France le centre de ses intérêts (CE. Sect. 28 février 1986, n° 50277, publiée au Recueil). De même pour un postulant dont les enfants mineurs vivent à l’étranger (CE. Sect. 26 février 1988, n° 70584, publiée au Recueil).
Les conditions pour que le « centre des intérêts » du postulant soit regardé comme étant situé en France sont donc assez strictes.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat rappelle ces principes et la possibilité de tenir compte de la situation familiale du postulant pour apprécier où se trouve le « centre de ses intérêts ».
Appliquant ces principes à l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la présence de l’épouse du postulant à l'étranger s’oppose à ce que le centre de ses intérêts soit regardé comme étant en France. Aussi, il confirme le refus de naturalisation.
A quel état d'un monument historique les travaux effectués sur celui-ci doivent-ils être conformes ?
Le 03/12/2018
Par une décision n° 410590 du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat vient apporter des précisions sur les travaux effectués sur les monuments historiques.
En effet, en vertu du code du patrimoine, il n’est pas possible de faire de quelconques travaux de restauration, modification ou démolition d’un immeuble classé monument historique sans autorisation de l’administration (article L. 621-9 du code). A cette occasion, l’administration vérifie (article R. 621-18 du même code) que les travaux :
Sont compatibles avec le statut d’immeuble classé,
- Ne portent pas atteinte à l’intérêt ayant justifié le classement,
- Ne compromettent pas la bonne conservation du bâtiment.
- Ces principes sont appliqués avec attention par l’administration.
A l’occasion de l’affaire jugée par le Conseil d’Etat dans la décision du 5 octobre 2018, ce dernier précise que pour analyser le projet de modification ou de restauration de l’immeuble classé monument historique, l’administration ne doit pas se référer à l’état ou à la configuration de cet immeuble à la date de son classement.
Elle doit prendre en compte l’intérêt qui a justifié la mesure de conservation.
Autrement dit, si, par exemple, le classement d’un immeuble a pour objet de préserver cet immeuble tel qu’il était lors de sa création et non lors de son classement, alors c’est à l’immeuble tel qu’il était lors de sa création qu’il faut se référer sans tenir compte des modifications postérieures.
Dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat, était en cause la modification de l’un des immeubles de la place Vendôme.
Or, le requérant (qui s’était vu opposer un refus au projet de modification qu’il avait préparé et avait formé un recours contre ce refus) reprochait à la cour administrative d’appel de Paris d’avoir apprécié son projet au regard de la configuration initiale de la place Vendôme lors de sa création et non au regard de la configuration de la place à la date de son classement.
Le Conseil d’Etat confirme cependant le raisonnement de la cour et apporte d’utiles précisions quant aux motifs de classement de la place Vendôme :
- Il relève d’une part que le classement avait pour objet de préserver l’ordonnancement initial de la place (et non son ordonnancement à la date du classement en 1862).
- D’autre part, il estime que cet ordonnancement initial de la place pouvait s’apprécier à la lumière des gravures de Jean-François Blondel lesquelles « donnaient, en l'état des connaissances, la description la plus précise, complète et certaine de la place Vendôme à la date de son achèvement ».
Il en déduit donc que le projet pouvait et devait être apprécié à la lumière de l’état initial de la place et non au vu de son état à la date de son classement.
Cet exemple montre donc l’importance des motifs retenus pour le classement d’un monument historique et impose donc de se pencher de manière assez précise sur ces motifs au moment d’éventuels travaux sur l’immeuble classé.
Déroulement des examens universitaire et juge du référé-liberté
Le 15/11/2018
Par une ordonnance n° 423727 du 20 septembre 2018 le juge des référés du Conseil d’Etat apporte d’intéressantes précisions quant à la qualification de « liberté fondamentale » au sens du référé-liberté à propos du droit à l’instruction et de ses corollaires pour les personnes atteintes d’un handicap.
En effet, dans cette affaire, une étudiante de master 2, atteinte d’un grave handicap et d’un cancer, avait saisi le juge du référé-liberté pour qu’il soit enjoint à son université : de limiter ses épreuves à 3 heures par jour et de l’autoriser à stocker un concentrateur d’oxygène dans les locaux de l’université.
Cette demande ayant été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, elle avait interjeté appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d’Etat.
A l’occasion de cette affaire, le conseil d’Etat apporte des précisions quant à la possibilité, pour des étudiants, de se prévaloir de leur droit d’accès à l’instruction devant le juge du référé-liberté.
Néanmoins, avant d’exposer la position prise par le Conseil d’Etat, il est nécessaire de rappeler brièvement l’objet du référé-liberté.
1. La liberté fondamentale au sens du référé-liberté ne doit pas être confondue avec l’ensemble des principes ou objectifs de valeur constitutionnels protégés par la Constitution (malgré leur caractère fondamental).
En effet, un principe peut parfaitement être un principe constitutionnel fondamental sans pour autant pouvoir être mobilisé devant le juge du référé liberté. Il en va, par exemple, ainsi du principe d’égalité qui est l’un des principes sur lesquels est assise la Constitution alors que ce principe ne constitue pas une « liberté fondamentale » au sens du référé-liberté (CE. Ord. 1er septembre 2017, Commune de Dannemarie, n° 413607, mentionnée aux tables). De même pour le droit au logement, qui est pourtant un objectif de valeur constitutionnelle (CE. Ord. 3 mai 2002, Association de réinsertion sociale du Limousin et a., n° 245697, publiée au Recueil).
De même, tout droit conféré par la loi ou le règlement n’est pas un droit ou une liberté fondamentale dont on peut se prévaloir devant le juge du référé-liberté (voir, par exemple, le droit au congé-formation : CE. SSR. 28 mai 2001, M. Raut, n° 230888, mentionnée aux tables).
Ainsi, la liberté fondamentale au sens du référé-liberté est une catégorie à part qui permet seulement au juge de mettre en œuvre des pouvoirs particulièrement coercitifs à l’égard de l’administration. En effet, en référé-liberté, non-seulement le juge se prononce en 48h, mais il peut adresser des injonctions présentant un caractère définitif à l’administration.
Dès lors, ce n’est pas parce qu’un droit ou une liberté n’est pas qualifié de fondamental au sens du référé-liberté que ce droit ou cette liberté ne pourra pas conduire à l’annulation au fond d’une décision par le juge administratif. Cela signifie seulement qu’il ne sera pas possible de mettre en œuvre un référé-liberté.
Aussi, le Conseil d’Etat a une vision assez restrictive de ce qui relève de la liberté fondamentale, comme le montre le cas jugé en l’espèce.
2. En effet, dans l’ordonnance commentée, le juge des référés du Conseil d’Etat considère que les conditions de déroulement d’épreuves de master ne peuvent porter atteinte à aucune liberté fondamentale.
Bien que le juge ne précise pas, cela signifie que ces conditions ne portent pas atteinte au droit à l’instruction. C’est ce que soulevait la requérante, qui indiquait qu’était en cause l’égal accès à l’instruction.
Le Conseil d’Etat estime qu’il n’y a pas de liberté fondamentale en l’espèce, même dans l’hypothèse où sont en cause des conditions de déroulement des épreuves portant atteinte au principe d’égalité. Cette précision est logique au vu de la jurisprudence du Conseil d’Etat mentionnée ci-dessus qui considère que le principe d’égalité n’est pas une liberté fondamentale (CE. Ord. 1er septembre 2017, Commune de Dannemarie, n° 413607, mentionnée aux tables).
Concernant le droit d’accès à l’instruction en lui-même, le Conseil d’Etat ne précise pas pourquoi cette liberté fondamentale qu’il a reconnue par le passé (CE. Ord. 15 décembre 2010, Ministre de l’éducation nationale, n° 344729, publiée au Recueil) ne peut pas être mobilisée en l’espèce.
Il y a deux interprétations possibles de ce refus :
- D’une part, que la question des examens de master 2 n’est pas relative à l’« accès » à l’instruction mais à son déroulement, le Conseil d’Etat ayant simplement consacré comme liberté fondamentale la « privation » de « toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ». Autrement dit, la liberté fondamentale ne semble protéger que l’accès à l’instruction et non pas son déroulement.
- D’autre part, que le master, grade universitaire de haut niveau ne relève plus du droit à l’instruction, ce droit étant limité à la scolarisation (à l’apprentissage des fondamentaux). En effet, dans l’ordonnance du 15 décembre 2010 consacrant le droit à l’instruction, le Conseil d’Etat cite différents texte pour justifier l’existence de la liberté fondamentale, lesquels se rapportent à la scolarisation des enfants. De plus, par le passé, le Conseil d’Etat avait considéré que l’ « accès » à une formation de troisième cycle (un doctorat) ne relevait pas d’une liberté fondamentale (CE. Ord. 24 janvier 2001, Université Paris VIII-Vincennes Saint-Denis, n° 229501, publiée au Recueil).
Il est probable que ces deux éléments ont joué dans la position prise par le Conseil d’Etat, ce dernier considérant que n’était en cause, ni l’« accès » à une formation, ni le droit à l’instruction au sens stricte.
Cela signifie donc que les conditions de déroulement des examens de master (et sans doute de toute formation universitaire) ne peuvent faire l’objet d’un référé-liberté.
3. En revanche, le Conseil d’Etat ouvre une brèche pour les étudiants atteints d’un handicap ou d’un « trouble de santé invalidant ».
En effet, à l’égard de ces étudiants, un référé-liberté est envisageable s’il existe une « carence caractérisée » de l’administration dans la mise en œuvre des obligations d’aménagement qui pèsent sur elle. Pour apprécier l’existence de cette carence caractérisée, le Conseil d’Etat indique qu’il faut se référer :
- A l’état de santé de l’étudiant,
- Aux pouvoirs et moyens dont dispose d’administration.
L’on en déduit donc que plus la personne sera atteinte d’un handicap ou d’une pathologie grave, plus l’administration devra être diligente.
Mais l’on constate également que si l’administration a peu de moyens, cela pourra être opposé à l’étudiant puisque le constat de la carence dépend des moyens de l’établissement. Cette vision que l’on pourrait qualifier de réaliste, est toutefois problématique dans la mesure où les moyens des personnes publiques en charge de l’enseignement supérieur étant de plus en plus limités, cette carence dans le financement du service public de l’éducation pourra un jour servir à justifier le refus d’aménagement des conditions de passation d’une épreuve pas une personne handicapée.
Appliquant ces principes nouveaux à l’espèce, le juge des référés du Conseil d’Etat constate en l’espèce qu’en cours d’instance, l’administration s’est engagée à prendre un prestataire pour fournir des bouteilles d’oxygène à l’étudiante pendant ses épreuves et à fractionner l’épreuve de 7 heures mais pas celles de 4 heures 20. Il relève en outre que l’université devra faire preuve de « bienveillance » à propos de la question des horaires des examens.
Il en déduit qu’il n’y a pas de carence caractérisée de l’université à ses obligations de sorte que le référé est rejeté.
C’est donc à la lumière de ces précisions nouvelles que les étudiants handicapés pourront, en cas de besoin, tenter un référé-liberté dans la petite fenêtre ouverte par le Conseil d’Etat.
Le juge peut entendre toute "personne intéressée" pendant l'audience
Le 02/11/2018
Par une décision n° 408825 du 24 septembre 2018, le Conseil d’Etat vient préciser les conditions dans lesquelles une personne qui n’est pas partie à l’instance peut être autorisée à prendre la parole lors de l’audience.
En effet, il convient de conserver à l’esprit que la procédure devant les juridictions administratives est principalement écrite. C’est la raison pour laquelle les observations que peuvent faire les parties lors de l’audience ne leur permettent pas de soulever des moyens nouveaux et ne constituent pas, à proprement parler, des plaidoiries.
Le code de justice administrative prévoit en son article R. 732-1 que :
- Les parties peuvent présenter leurs observations,
- Le tribunal ou la cour peut entendre les agents de l’administration pour obtenir des explications,
- Le tribunal peut demander des éclaircissements à une personne présente dont l’une des parties souhaite l’audition.
Sur le fondement de ces dispositions (et du caractère écrit de la procédure devant les juridictions administratives) le Conseil d’Etat avait initialement une interprétation stricte de ces dispositions.
En effet, il estimait que le fait de donner la parole à une personne qui n’était pas partie à l’instance lors de l’audience entachait le jugement ou l’arrêt d’irrégularité. C’est ce qu’il avait jugé à propos de l’intervention d’un syndicat lors d’une audience à propos d’un recours formé par un autre syndicat contre la recevabilité d’une liste présentée à des élections professionnelles par un troisième syndicat (CE. SSR. 16 janvier 2002, SNPT, n° 196637, mentionnée aux tables), de même pour les observations présentées par l’époux de la requérante puisque celui-ci n’était pas lui-même requérant (CE. Sect. 6 octobre 1972, Ville de Bourges, n° 80837, publiée au Recueil).
Dès lors, le principe paraissait presque absolu.
Néanmoins, par la décision commentée, le Conseil d’Etat assouplit très largement cette position. En effet, il estime que le tribunal ou la cour peut autoriser « une autre personne intéressée », qui n’est pas partie à l’instance, à prendre la parole au cours de l’audience.
Le Conseil d’Etat ne définit pas ce qu’il faut entendre par « personne intéressée » mais l’espèce qu’il avait à juger lui donne l’occasion de fournir un exemple : une personne qui était partie à la première instance mais n’était plus partie en appel est une personne intéressée qui peut donc être autorisée à prendre la parole à l’audience.
L’on ne peut donc savoir en l’état quelle sera la définition exacte de la « personne intéressée » et donc l’étendue des possibilités offertes aux juges du fond pour entendre une autre personne que les parties. Il s’agit en tout cas d’une évolution importante, le Conseil d’Etat passant d’une vision très stricte à une vision plus ouverte des personnes susceptibles d’être entendues lors de l’audience.
L'Etat est responsable de l'absence de place adaptée pour un enfant handicapé
Le 15/10/2018
Par un arrêt n° 17PA01993 du 10 juillet 2018, la cour administrative d’appel de Paris indemnise une enfant atteinte d’un trouble autistique et sa famille du fait de l’absence de place donnée à celle-ci en institut médico-éducatif (IME) malgré les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prises en ce sens.
1. En effet, il est désormais jugé de longue date qu’il appartient à l’Etat d’assurer le caractère effectif du droit à l’éducation et de l’obligation scolaire, notamment pour les enfants handicapés. Il a été précisé que les difficultés rencontrées par ces enfants ne sauraient faire obstacle à l’application de ces principes et qu’il appartient à l’Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer de manière effective le droit à l’éducation et l’obligation scolaire.
Ces principes ont été posés par le Conseil d’Etat (CE. SSR. 8 avril 2009, n° 311434, publiée au Recueil) à l’occasion d’une affaire où la cour administrative d’appel de Versailles avait estimé que l’obligation de l’Etat n’était qu’une obligation de moyen et non de résultat. Autrement dit, la cour avait jugé que l’absence de places disponibles pouvait être valablement opposée à l’enfant.
En censurant cette solution, le Conseil d’Etat reprenait en réalité la position adoptée quelques temps plus tôt par la cour administrative d’appel de Paris (CAA de Paris, 11 juillet 2007, Ministre de la santé c. Epoux Haemmerlin, n°s 06PA01579-06PA02793, mentionné aux tables), qui avait jugé que la carence de l’Etat ne pouvait être justifiée par l’insuffisance de moyens budgétaires.
Par la suite, le Conseil d’Etat avait également eu l’occasion de préciser que l’absence de scolarisation d’un enfant, en raison d’une absence de décision d’orientation de cet enfant par la CDAPH, engageait la responsabilité de l’Etat, la position de la CDAPH étant fondé sur l’insuffisance des structures d’accueil et non au manque de diligence des parents.
2. Néanmoins, dans la pratique les cas de condamnations de l’Etat sur ce fondement sont relativement rares.
Dans l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Paris (qui avait été pionnière dans ce domaine) donne un exemple d’application positive de cette jurisprudence en revenant sur un jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la demande des parents d’une enfant atteinte de troubles autistiques.
Cette enfant avait bénéficié de décisions de la CDAPH l’orientant vers un établissement médico-social. Toutefois, elle n’avait, en pratique, pas bénéficié d’un tel suivi au sein des établissements désignés par la CDAPH et avait été prise en charge par un hôpital de jour de la Croix-Rouge. Néanmoins, cet établissement ne pouvait faire bénéficier l’enfant d’une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à ses troubles comme l’aurait fait un institut médico-éducatif (IME) et comme l’exigent les textes.
En première instance, le tribunal avait considéré que la carence de l’Etat n’était pas établie, les parents ne démontrant pas – selon le tribunal – avoir pris contact avec l’ensemble des établissements désignés par les décisions successives de la CDAPH. C’est la raison pour laquelle il avait rejeté leur recours.
En appel, la cour relève que les parents ne démontrent pas avoir saisi, par écrit, l’ensemble des établissements mais constate qu’une grande majorité des établissements contactés par écrit avaient refusé l’enfant du fait de l’absence de places disponibles. Pour les autres établissements, les parents affirmaient avoir fait des démarches par téléphone, ce qui était confirmé par les réponses écrites négatives reçues postérieurement au jugement. La cour ajoute que l’Etat ne démontrait pas qu’une seule place ait été disponible dans les établissements désignés par la CDAPH. Elle en conclut que le fait que les parents ne puissent pas prouver avoir sollicité l’ensemble des établissements par écrit n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité, pour sa carence fautive. C’est la raison pour laquelle elle condamne l’Etat.
Cette solution, et l’analyse détaillée des démarches effectuées par les parents de l’enfant à laquelle procède la cour, montrent que l’exigence des juridictions administratives envers les parents est, en pratique, assez élevée.
En effet, la plupart des parents ne songent pas forcément à présenter leurs demandes par écrit (et encore moins en courrier recommandé avec accusé de réception). Or, force est de constater que cela peut leur être reproché par la suite. Même si cela se comprend au vu de l’impératif de preuve devant toute juridiction, il n’en demeure pas moins que la position est sévère.
Au cas présent, les établissements ayant refusé par téléphone de prendre l’enfant faute de places disponibles ayant également confirmé ces refus par écrit (postérieurement au jugement du tribunal mais antérieurement à l’arrêt de la cour), la difficulté a été surmontée.
Cependant, cela démontre la vigilance que les parents doivent apporter à leurs démarches. En effet, ces derniers doivent déjà se préparer à l’hypothèse d’un éventuel contentieux quand ils cherchent une place à leur enfant.
En l’espèce en tout cas, la cour considère que les parents apportent la preuve de leurs démarches et condamne l’Etat.
Cependant, la condamnation paraît symbolique pour une prise en charge inadaptée pendant 7 ans. En effet, l’enfant se voit allouer la somme de 5.000 euros. Or, pour une enfant de cet âge, atteinte de troubles de cette nature, le retard pris dans sa prise en charge peut, potentiellement, ne jamais être rattrapé. Les parents se voient quant à eux allouer, pour leurs démarches et la mise en place d’une prise en charge pendant cette période, une somme de 10.000 euros.
Même si une telle indemnisation paraît limitée dans son montant, le principe de la responsabilité est, lui, reconnu. Ce type de décision, rendu dans le cadre d’un recours indemnitaire, peut en tout cas ouvrir la voie à d’autres types de procédures, plus efficaces, devant le juge administratif.
Le 01/10/2018
Par un avis n° 419204 du 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat vient préciser les délais de recours contre une décision créatrice de droit, retirée par l’administration puis rétablie par le juge à la suite de l’annulation du retrait.
En effet, une décision créatrice de droit (c’est-à-dire une décision dont le bénéficiaire peut légitimement considérer qu’elle lui est acquise) peut être retirée par l’autorité qui l’a édictée, en vertu de la jurisprudence Ternon, dans un délai de quatre mois à compter de son édiction si elle est illégale.
Toutefois, il est fréquent que le bénéficiaire de la décision créatrice de droit (une autorisation par exemple) saisisse le juge administratif pour faire annuler ce retrait.
Si le juge fait droit à cette demande d’annulation, la décision de retrait disparaît de l’ordonnancement juridique et la décision créatrice de droit reprend automatiquement vigueur. Se pose alors (comme toujours en droit public) la question du délai de recours contre cette décision créatrice de droit qui (en quelque sorte) revient à la vie : un nouveau délai de recours recommence-t-il à courir ? Si oui, à partir de quand ?
Le Conseil d’Etat avait d’ores et déjà en partie répondu à ces questions (CE. SSR. 6 avril 2007, M. Bernard A. et autres, n° 296493, mentionnée aux tables) en estimant, à propos d’un permis de construire, qu’il reprenait vigueur à compter de la notification du jugement et qu’un nouveau délai de recours commençait à courir à compter des mesures de publication et d’affichage prévues par le code de l’urbanisme.
Dans l’avis commenté, le Conseil d’Etat apporte, cette fois, un mode d’emploi complet à la computation des délais de recours contre une décision créatrice de droit retirée pour remise en vigueur par un jugement d’annulation de la décision de retrait.
▪ En premier lieu, le Conseil d’Etat précise que la décision remise en vigueur ne peut plus être retirée par l’autorité qui l’a émise. Cette précision n’allait pas de soi (principalement si le retrait est annulé pour une question de procédure) mais dans l’intérêt d’une bonne administration il est effectivement préférable que le débat cesse afin d’éviter un jeu de retrait / annulation indéfini.
▪ En deuxième lieu, il rappelle que l’annulation de la décision de retrait rétablit la décision initiale et qu’un nouveau délai de recours contentieux court contre cette décision. Mais il précise, en sus de qu’il avait déjà jugé, que ce nouveau délai commence à courir :
- Dès la notification du jugement si la décision en cause n’a besoin de faire l’objet d’aucune mesure de publicité particulière (une décision individuelle classique).
- A compter des mesures de publicité particulières si elles sont prévues par les textes (comme c’est le cas pour les permis de construire).
▪ En troisième lieu, le Conseil d’Etat précise les modalités d’application de ces principes vis-à-vis d’un tiers particulier pour les collectivités territoriales, à savoir le préfet. En effet, il indique que pour les décisions qui doivent faire l’objet d’une transmission au préfet afin qu’il puisse exercer son contrôle de légalité, cette nouvelle transmission doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la notification du jugement (ce délai étant le délai classique prévu par l’article L. 2131-1 du CGCT). Cette notification au préfet fait alors courir le délai dont dispose ce dernier pour éventuellement déférer la décision au tribunal administratif.
Ces précisions, certes relatives à des hypothèses bien particulières, viennent en tout cas clarifier les règles de computation du délai de recours contre les décisions créatrices de droit remises en vigueur par une annulation.
Un agent suspendu peut demander qu'il soit mis fin à sa suspension à la lumière d'éléments nouveaux
Le 18/09/2018
Par une décision n° 418844 du 18 juillet 2018 le Conseil d’Etat vient préciser les conditions dans lesquelles les professeurs d’universités (et plus généralement les personnels de l’enseignement supérieur) peuvent faire l’objet d’une suspension et, surtout, les hypothèses dans lesquelles cette suspension ne peut être maintenue.
En effet, en vertu des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, les personnels de l’enseignement supérieur peuvent être suspendus pour une durée d’un an tout en conservant leur traitement. Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger que ces dispositions spécifiques étaient les seules à s’appliquer à ces personnels, l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui traite de la suspension pour l’ensemble des fonctionnaires ne leur étant pas applicable (CE. SSR. 5 novembre 2001, Société des agrégés de l'université, n° 224380, publiée au Recueil).
L’article du code de l’éducation est toutefois muet sur les conditions de fond d’application de cette suspension. Aussi, par différentes décisions, le Conseil d’Etat est venu pallier ce silence en posant deux conditions de fond à la suspension d’un personnel de l’enseignement supérieur :
- Que les faits imputés à l’agent aient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité (CE. SSR. 10 décembre 2014, n° 363202, mentionnée aux tables). Il s’agit là simplement de la condition posée par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, que le Conseil d’Etat transpose dans le silence des textes.
- Que la poursuite des activités de cet agent au sein de l’établissement présente des inconvénients « suffisamment sérieux » pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours (CE. CHR. 30 mai 2018, n° 418844).
Ces deux conditions sont donc cumulatives, ce qui signifie qu’en principe le caractère vraisemblable et grave des faits imputés au professeur ne suffit pas pour justifier légalement une suspension, encore faut-il que la poursuite de ses activités présente des inconvénients suffisamment sérieux.
Toutefois, en pratique, lorsque les faits imputés à l’agent sont liés au service et présentent une gravité et une vraisemblance suffisante, son maintien dans l’université présentera généralement des inconvénients suffisamment sérieux pour la sérénité du service.
Au-delà du rappel de ces deux conditions et de l’absence d’obligation pour l’université d’entendre le professeur avant de le suspendre (CE. SSR. 26 octobre 2005, M. Bruno X, n° 279189, publiée au Recueil) le Conseil d’Etat précise, dans la décision attaquée, comment le juge et l’administration doivent tenir compte de faits nouveaux ayant une incidence sur le caractère grave ou vraisemblable des faits imputés à l’agent.
D’une part, s’agissant du juge, le Conseil d’Etat considère – assez classiquement – que les faits nouveaux ou les faits antérieurs qui n’étaient pas à la connaissance de l’administration n’ont pas d’incidence sur la légalité de la décision de suspension. En effet, en principe, la légalité d’un acte s’apprécie à la date de son édiction. Autrement dit, si au vu des faits découverts ultérieurement, les accusations sont finalement écartées, cela n’a pas nécessaire d’incidence sur la légalité de la décision de suspension. Si le juge considère qu’au moment où la décision a été prise, les accusations étaient suffisamment graves et vraisemblables, alors la décision sera regardée comme légale.
D’autre part, et en revanche, le Conseil d’Etat indique, à propos de l’administration, qu’elle ne peut pas ignorer les éléments nouveaux portés à sa connaissance postérieurement à la décision. En effet, si de tels éléments font perdre leur sérieux aux accusations portées contre le professeur, l’administration est tenue d’abroger la décision de suspension.
En pratique, cela signifie qu’en présence d’éléments nouveaux remettant en cause les accusations, le fonctionnaire suspendu devra solliciter auprès de son administration l’abrogation de sa suspension (si l’administration ne le fait pas spontanément) et, en cas de refus d’abrogation, pourra saisir le tribunal administratif.
A cet égard, il convient de souligner que cette précision, apportée à propos de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, devrait en toute logique s’appliquer également à la suspension prononcée sur le fondement de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. En effet, dans la mesure où la condition de fond de la suspension est, dans ces deux hypothèses, la même, sa disparition doit dans tous les cas mener à l’abrogation de la décision de suspension.
Toutefois, pour que le professeur, ou plus généralement le fonctionnaire, puisse se prévaloir d’éléments nouveaux, encore faut-il qu’il connaissance les motifs de sa suspension. Or, il est fréquent que l’administration reste muette sur les motifs de la suspension et laisse l’agent dans le flou quant aux accusations qui sont portées contre lui.
Le 15/08/2018
Par une décision n° 392949 du 13 avril 2018, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les hypothèses dans lesquelles le rectorat peut prendre une décision à la demande de l’un des parents (en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale) sans solliciter l’accord de l’autre.
Cette question est centrale en pratique dans les hypothèses de séparation ou de divorce des parents.
Le code civil prévoit sur ce point que les tiers de bonne foi n’ont pas à solliciter l’accord des deux parents pour les « actes usuels », chacun des parents étant réputé avoir l’accord de l’autre. Cet article envisage donc en réalité trois hypothèses :
- Les actes non usuels pour lesquels l’accord des deux parents est toujours nécessaire,
- Les actes usuels lorsque le tiers n’a pas connaissance d’un litige entre les parents, pour lesquels l’accord d’un seul parent suffit,
- Les actes usuels lorsque le tiers a connaissance d’un litige entre les parents, pour lesquels l’accord des deux parents est nécessaire.
Ces dispositions s’appliquent au rectorat comme à tous les tiers. Il est donc régulièrement confronté à la question de savoir s’il se trouve face à un acte usuel ou non lorsqu’un parent fait une demande (généralement une demande de changement d’établissement).
Or, le code civil ne définit pas ce qu’il faut entendre par « acte usuel » ce qui ne simplifie pas la tâche des tiers (et des parents).
Certaines décisions de justice civile ont tenté de dégager une définition. Celle qui est généralement retenue définit les actes usuels comme des actes de la vie « quotidienne, sans gravité, qui n'engagent pas l'avenir de l'enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque, grave apparent pour l'enfant, ou encore, même s'ils revêtent un caractère important, des actes s'inscrivant dans une pratique antérieure non contestée » et les actes non usuels comme « les décisions qui supposeraient en l'absence de mesure de garde, l'accord des deux parents, ou qui encore, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur incidence particulière dans l'éducation et la santé de l'enfant, supposent une réflexion préalable sur leur bien-fondé ». (CA Aix-en-Provence, 28 octobre 2011, RG n° 11/00127). Cette définition, bien qu’éclairante, ne permet de savoir systématiquement comme classer un acte particulier, par exemple, une demande de changement d’établissement.
Dans sa décision du 13 avril 2018, le Conseil d’Etat précise la conduite à tenir pour le rectorat face aux demandes émanant d’un seul parent (notamment les changements d’établissement).
Il indique que le rectorat doit tenir compte de deux éléments pour déterminer si l’accord des deux parents est nécessaire :
La nature de la demande,
L’ensemble des circonstances dont il a connaissance.
Cette affirmation paraît logique mais n’aide pas énormément, en pratique, le rectorat dans sa prise de décision.
En effet, à l’inverse de ce qu’il avait pu juger à propos de l’inscription d’enfants sur un passeport pour laquelle il avait considéré que cet acte était usuel (CE. SSR. 8 février 1999, Mme Claudine X, n° 173126, publiée au Recueil), le Conseil d’Etat ne tranche pas ici, par principe, le point de savoir si un changement d’établissement est un acte usuel ou non.
Néanmoins, en tenant compte des indices donnés par la jurisprudence civile et administrative, l’on peut considérer que dans la plupart des cas, un changement d’établissement n’est pas un acte usuel. En effet, s’il ne s’agit pas d’un acte grave, il s’agit d’un acte important qui a un impact non négligeable sur la vie quotidienne de l’enfant (et donc son équilibre).
Cependant, la nature d’une demande de changement d’établissement peut être contrebalancée par les circonstances de l’espèce (d’où la solution retenue par le Conseil d’Etat). En effet, si, par exemple, le changement de résidence de l’enfant est décidé par le juge aux affaires familiales, qui précise que l’enfant sera scolarisé dans sa nouvelle ville, et si le rectorat a connaissance de cette décision, alors la demande de changement d’établissement proprement dite devient un acte usuel (voir, par exemple : CAA Douai, 10 novembre 2011, M. Eric A, n° 10DA01666 ; CAA Lyon, 28 février 2013, n° 12LY01224).
De même, l’on pourrait imaginer qu’un changement d’établissement, sur le territoire de la même commune et dans le même quartier, soit considéré comme un acte usuel si le rectorat n’a pas connaissance de litiges persistants entre les parents.
In fine, cette décision, si elle donne des clefs de lecture aux rectorats pour déterminer si l’accord des deux parents est nécessaire, reste assez peu opérationnelle pour les parents et les rectorats confrontés à cette question.
L’enseignement en langues régionales et l’absence des professeurs
Le 31/07/2018
Dans un arrêt n° 16BX01356 du 25 avril 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de se prononcer sur une action en responsabilité intentée par les parents d’enfants scolarisés dans des classes bilingues à parité horaire français-basque. Ces derniers se plaignaient qu’à la suite d’absences d’une professeure en langue basque, certains de ses cours avaient été remplacés par des cours en français, de sorte que la parité horaire n’était pas respectée.
Ce litige donne donc l’occasion à la cour de clarifier les obligations incombant au rectorat en matière d’enseignement en langue régionale.
En effet, l’arrêté du 12 mai 2003 donne la possibilité au rectorat de mettre en place un enseignement bilingue en langue régionale à parité horaire dans les établissements scolaires publics. L’article 2 de cet arrêté précise bien que l’enseignement est alors dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français.
La question qu’avait à trancher la cour était de savoir quelle portée donner à cet article imposant une parité horaire d’enseignement en cas d’absence de professeurs.
Sa réponse de principe est que cet article n’impose pas davantage que les obligations générales qui s’appliquent à tous les enseignements primaires et élémentaires, à savoir qu’en cas d’absence imprévisible du professeur et d’impossibilité de le remplacer, les élèves doivent bénéficier d’un service d’accueil gratuit (article L. 133-1 du code de l’éducation).
Autrement dit, en première lecture, l’on pourrait déduire de cet arrêt que le principe de parité horaire n’est pas une obligation pour le rectorat.
Mais une telle position paraîtrait excessive dans la mesure où elle reviendrait à refuser à l’article 2 de l’arrêté du 12 mai 2003 tout caractère obligatoire alors que sa rédaction – au présent de l’indicatif – ne laisse pas de doute sur sa portée obligatoire.
La solution retenue par la cour (au demeurant prudente dans la rédaction de son considérant de principe) s’explique sans doute davantage par les circonstances de l’espèce.
En effet, la cour commence par rappeler que le rectorat à l’obligation d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires. Cette obligation, qui découle de la mission d’enseignement dévolue au ministre, a été posée anciennement par le Conseil d’Etat (CE. SSR. 27 janvier 1988, Ministre de l’éducation nationale c. M. X, n° 64076, publiée au Recueil). La haute juridiction en a déduit que la méconnaissance de cette obligatoire (autrement dit, la carence dans l’enseignement), qui consistait dans la décision du Conseil d’Etat à avoir omis 7 heures de cours par semaine pendant toute une année scolaire, engageait la responsabilité de l’Etat.
C’est donc à la lumière de cette obligation d’assurer les enseignements obligatoires que la cour administrative d’appel de Bordeaux étudie le cas qui lui était soumis.
Or, dans cette affaire, le comportement du rectorat paraissait peu critiquable. En effet, la cour relève qu’à la suite de l’absence prolongée pour raisons de santé d’une professeure en langue basque qui avait été immédiatement remplacée, sa remplaçante avait elle-même été ponctuellement absente pour raisons de santé mais remplacée systématiquement (mais, sur les 29 demi-journées de remplacement, 16 l’avaient été en français).
La cour tient compte de plusieurs éléments pour considérer que le rectorat n’a pas engagé sa responsabilité en l’espèce :
- Le caractère imprévisible des absences de la remplaçante,
- La diligence du rectorat (qui a assuré tous les enseignements),
- Le nombre limité d’heures dispensées en français (48 heures).
Ce raisonnement développé par la cour, qui se fonde sur le nombre limité d’heures dispensées en français, permet de douter de la portée à donner à cet arrêt.
La prudence de la cour et la mise en avant du nombre d’heures limité de cours dispensés en français (en effet, 48 heures sur une parité d’enseignement annuelle n’apparaissent effectivement pas déterminantes) laissent supposer que les si les circonstances avaient été différentes, la cour aurait peut-être fait produire ses effets à l’article 2 de l’arrêté du 12 mai 2003 qui prévoit la parité horaire.
L’on imagine que la solution n'aurait pas été la même si, par exemple, le rectorat avait fait preuve d’une moindre diligence et si les enseignements avaient finalement été dispensés aux trois quarts, ou davantage, en français.
Cette décision est donc intéressante et montre en tout cas que le juge ne souhaite pas imposer d’obligations trop précises au rectorat en matière de parité d’enseignement bilingue. En effet, la cour indique seulement qu'en cas d'absence ponctuelle et impromptue d'un professeur enseignant en langue régionale, il peut être remplacé par un professeur enseignant en français. Néanmoins, elle ne paraît pas clore définitivement le débat en excluant par principe toute faute de l’administration en ce domaine.
Le maintien irrégulier pendant 31 ans sur un statut de "vacataire" donne droit à une indemnisation
Le 06/06/2018
Par un arrêt n° 17MA00081 du 27 avril 2018, la cour administrative d’appel de Marseille condamne l’administration pour avoir engagé, pendant 31 ans un agent en qualité de « vacataire ».
Plus précisément, était en cause dans cette affaire un médecin de prévention, engagé par l’université de Nice-Sophia Antipolis en 1979 en qualité de vacataire. Les contrats successifs mensuels ou annuels de l’intéressé se sont poursuivis sans discontinuité jusqu’en 2011 (moment où l’administration a finalement proposé un CDD à l’agent).
Rappelons, à ce stade, quelle est la différence entre agent « vacataire » et agent « contractuel » (en CDD ou CDI) de la fonction publique.
Les vacataires sont engagés pour exécuter une tâche déterminée et non pour assurer un emploi permanent. Leur position s’apparente davantage à celle d’un prestataire de service qu’à celle d’un agent public.
Ils ne bénéficient donc pas des droits qui s’attachent à la qualité de contractuel de la fonction publique : pas de droit à congés (même de droit à congé maladie), pas de droit à la formation, pas de droit à certaines indemnités.
Néanmoins, il arrive régulièrement dans la pratique que des agents publics soient recrutés en qualité de « vacataires » alors que leur situation ne relève pas de l’exécution d’un acte déterminé.
C’est notamment le cas dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Marseille.
En effet, la cour relève que l’emploi de l’intéressé correspondait à un besoin permanent (ce qui allait de soi puisque le médecin de prévention avait été engagé pendant près de 31 ans). Aussi, elle considère que son statut aurait dû être requalifié en CDD.
La juridiction en déduit donc que l’administration a commis une faute en maintenant illégalement l’agent dans un statut de vacataire pendant 31 ans.
Toutefois, l’indemnité qu’elle accorde à l’agent est très limitée. En effet, dans la mesure où l’agent avait, en pratique, bénéficié de congés payés, la cour considère qu’il n’a subi aucune perte de revenus. Elle indemnise donc seulement son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence liés à la précarité de sa position.
Elle lui alloue 6.000 euros à ce titre, ce qui paraît peu eu égard à la durée de l’illégalité de la situation du demandeur.
Cet arrêt est néanmoins intéressant sur un plan procédural puisqu’il précise que le délai de prescription (qui est de 4 ans en droit public) de l’action indemnitaire de l’agent relative au retard mis à régulariser sa situation commence à courir à compter de la régularisation.
Ainsi, si l’agent ne voit jamais sa situation régularisée par l’attribution d’un CDD ou d’un CDI, et demeure soumis à un statut de vacataire, il ne pas se voir opposer aucune prescription tant qu’il est en poste.
C'est à l'Etat de prendre en charge les AVS / AESH pendant les temps d'activités périscolaires
Le 25/05/2018
Par un arrêt n° 16NT02951 du 15 mai 2018, la cour administrative d’appel de Nantes juge que l’Etat doit prendre en charge l’AVS / AESH d’un enfant handicapé pendant les temps périscolaires (TAP) lorsque la CDAPH a estimé que l’enfant devait en bénéficier.
Plus précisément, était en cause dans cette affaire la décision du rectorat, refusant de prendre en charge (via le paiement d’un AVS/AESH) un enfant handicapé pendant les temps d’activités périscolaires (TAP), alors que la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) avait accordé à l’enfant un AVS sur les temps scolaires et périscolaires.
Pour justifier son refus de prendre en charge l’AVS / AESH de l’enfant pendant les temps périscolaires (TAP), l’Etat avait considéré que ces temps périscolaires étant un service facultatif communal, c’était à la commune de prendre en charge, le cas échéant, cet AVS / AESH.
Face à ce refus, le père de l’enfant avait saisi le tribunal administratif pour faire annuler cette décision de refus de prise en charge de l’AVS / AESH. Le tribunal lui avait donné raison et l’Etat avait interjeté appel du jugement.
C’est à cette occasion que la cour administrative d’appel de Nantes vient confirmer l’annulation du refus de prise en charge et préciser pourquoi l’Etat est bien tenu de rémunérer l’AVS / ARSH.
Il convient en effet de souligner que cette question n’est réglée expressément par aucune des dispositions du code de l’éducation ou par d’autres textes.
La cour est donc contrainte de se placer sur le plan des principes pour déterminer qui est tenu d’assurer le financement de l’AVS / AESH pendant les temps périscolaires.
Pour commencer, la cour rappelle que les CDAPH peuvent accorder des aides via l’attribution d’un AESH (article L. 351-3 du code de l’éducation) et que ces AESH peuvent intervenir pour aider à l’inclusion scolaire, même en dehors du temps scolaire (article L. 917-1 du code).
Elle confirme donc que les AESH peuvent bien intervenir en dehors du temps scolaire. Par conséquent, ils peuvent exercer leurs missions pendant les temps d’activités périscolaires (TAP) organisés par les communes.
Concernant la prise en charge des AESH pendant ces temps périscolaires (qui sont un service public que les mairies ne sont pas tenues de mettre en place), l’Etat affirmait que cela ne lui incombait pas puisqu’il n’est tenu de prendre financière en charge que ce qui relève de sa compétence (article L. 112-1 du code), ce qui n’est pas le cas des temps périscolaires (TAP).
Il est effectivement vrai que les temps périscolaires ne relèvent pas de la compétence de l’Etat et n’ont pas à être financés par lui.
Néanmoins, la cour estime que c’est bien à l’Etat de prendre financièrement en charge les AESH pendant ces temps périscolaires.
Pour ce faire, elle se fonde non pas sur une compétence spécifique de l’Etat mais sur sa mission générale d’organisation du service public de l’éducation. En effet, elle estime que cette mission implique de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire des enfants handicapés soient assurés (ce que confirme l’article L. 112-1 du code).
La cour en déduit donc que si la CDAPH a préconisé ces activités périscolaires, lesquelles sont une composante nécessaire à la scolarisation, il appartient à l’Etat d’assurer le financement au titre de sa mission générale.
Autrement dit, dans la mesure où les textes n’attribuent la prise en charge des AVS / AESH pour les temps périscolaires (TAP) à aucune collectivité, c’est à l’Etat d’en assurer le paiement puisqu’il lui incombe de veiller à la scolarisation des enfants handicapés au titre de sa mission générale.
Cependant, la cour précise bien que cette prise en charge n’a lieu d’être que si la CDAPH a préconisé la présence d’un AVS/AESH.
Elle confirme donc l’annulation du refus de prise en charge par l’Etat et enjoint au ministre de l’éducation de permettre à l’enfant d’être accompagné par un AESH pendant les périodes périscolaires.
Cet arrêt est donc important pour les enfants handicapées, leurs familles et les communes. En effet, dans la mesure où les temps d’activités périscolaires sont aujourd’hui généralisés, il était nécessaire de confirmer que les enfants peuvent être accompagnés par des AVS / AESH pendant ces temps périscolaires et de préciser que l’Etat est tenu de prendre en charge ces AVS / AESH lorsque c’est la CDAPH qui l’a préconisé.
Le 25/04/2018
Par une décision n° 410411 du 13 avril 2018, le Conseil d’Etat a jugé qu’un fonctionnaire pouvait être licencié pour insuffisance professionnelle en tenant compte de son travail sur des fonctions pour lesquelles il a été irrégulièrement nommé.
Plus précisément, le Conseil d’Etat avait à se prononcer sur une affaire dans laquelle un agent avait été licencié pour insuffisance professionnelle. Ce licenciement avait toutefois été annulé par la cour administrative d’appel de Versailles au motif que l’administration ne pouvait pas apprécier l’aptitude professionnelle de l’agent puisqu’il avait été irrégulièrement nommé sur ses fonctions.
Avant de se trancher la point qui nous intéresse, le Conseil d’Etat rappelle que :
- D’une part, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être fondé que sur des éléments manifestant l’inaptitude de l’agent à exercer ses fonctions. Autrement dit, les éventuelles fautes disciplinaires commises par l’agent ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour apprécier son inaptitude. En effet, sanction et insuffisance professionnelle sont des mesures bien distinctes de sorte qu’un agent inapte ne peut être sanctionné pour cette inaptitude (CE. SSJS. 25 mars 1988, Mme Rymdzianek, n° 84889 ; CAA Paris, 15 mars 2005, n° 02PA01400) et inversement, il ne peut être tenu compte des fautes d’un agent pour le déclarer inapte (CE. ch. réu. 1er juin 2016, n° 392621, mentionnée aux tables).
- D’autre part, l’insuffisance professionnelle n’a pas besoin d’être constatée à plusieurs reprises par différents rapports et il n’est pas nécessaire que l’agent ait été invité à remédier à ses insuffisances avant son licenciement. En effet, une seule évaluation de son aptitude professionnelle peut suffire si elle porte sur une période suffisante et révèle son inaptitude à exercer normalement ses fonctions (CE. ch. réu. 1er juin 2016, n° 392621, mentionnée aux tables, précitée).
Après ces rappels de droit, le Conseil d’Etat aborde le sujet qu’il avait à traiter, à savoir : un agent peut-il être regardé comme inapte s’il a été irrégulièrement nommé sur les fonctions sur lesquelles il exerce ?
La cour administrative d’appel de Versailles avait jugé que cela n’était pas possible, l’administration ne pouvant pas apprécier l’aptitude de l’agent à exercer des fonctions sur lesquelles il a été irrégulièrement nommé.
Cependant, le Conseil d’Etat considère que ce raisonnement est entaché d’erreur de droit. Selon la haute juridiction, la circonstance que l’agent a été irrégulièrement nommé n’a pas d’incidence sur la possibilité d’apprécier l’aptitude professionnelle de l’agent.
En effet, le Conseil d’Etat rappelle qu’un agent est regardé comme légalement investi de ses fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée (CE. Ass. 2 décembre 1983, M. Charbonnel et a., n° 43541, publiée au Recueil ; CE. Sect. 16 mai 2001, Préfet de police, n° 231717, publiée au Recueil), de sorte qu’il est possible d’apprécier son aptitude.
Il réserve néanmoins l’hypothèse dans laquelle la nomination est illégale parce qu’elle porte sur des fonctions autres que celles pour lesquelles l’agent a été engagé ou autres que celles de son grade.
La position adoptée par le Conseil d’Etat est donc assez pragmatique : si la décision de nomination est irrégulière pour une raison sans lien avec l’exercice des fonctions de l’agent (un vice de procédure ou de compétence du signataire de la décision de nomination par exemple), cette irrégularité n’a aucune incidence sur l’appréciation qui peut être portée sur l’aptitude de l’agent.
En revanche, si la nomination a été effectuée sur un poste ne correspondant pas au grade de l’agent ou à son contrat, il est logique qu’il ne soit pas possible d’en déduire qu’il est inapte. A titre d’exemple, si un agent n’est pas voué à assurer des fonctions d’encadrement mais est nommé sur un poste d’encadrement, il n’est pas possible de lui reprocher d’être inapte à l’encadrement.
La réserve du Conseil d’Etat est donc logique.
Le 18/04/2018
Par un arrêt n° 17NT02889 du 23 février 2018, la cour administrative d’appel de Nantes est venue rappeler que les personnes condamnées pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ne peuvent être employées par un établissement d’enseignement primaire ou secondaire.
La cour vient préciser que cette condition posée à l’emploi d’une personne doit pouvoir se vérifier tout au long de son activité au sein de l’établissement. Autrement dit, l’absence d’une telle condamnation n’est pas qu’une condition d’accès à la fonction. Si l’agent est condamné après son entrée au service d’un établissement scolaire, il doit être radié des cadres (si c’est un fonctionnaire) ou licencié (si c’est un agent contractuel).
Elle estime, comme d’autres juridictions avant elles que cette condition institue une « incapacité de plein droit » (CAA Versailles, 2 novembre 2006, n° 05VE00120 ; CAA Bordeaux, 8 mars 2011, n° 10BX01886). C’est la raison pour laquelle certaines juridictions précisent que l’administration se borne à « prendre acte » de l’impossibilité pour la personne de continuer à exercer (CAA Paris, 3 avril 2014, n° 13PA00415).
Ainsi, l’agent condamné pour un crime ou un délit contraire à la probité et aux mœurs sera automatiquement exclu du service.
La cour précise que l’administration n’a donc pas à mettre préalablement fin à ses fonctions avant de le radier des cadres.
Elle rappelle également que cette décision n’est pas une sanction mais une mesure à caractère préventif qui vise à protéger la sécurité des élèves (CE. SSR. 4 avril 2012, M. Serge A, n° 356637). Par conséquent, l’administration n’a pas à respecter la procédure applicable en matière disciplinaire.
La cour ajoute que ce type de décision n’étant pas une sanction, le juge n’a pas à contrôler le caractère proportionné de la mesure.
En effet, les sanctions infligées aux agents doivent être proportionnées aux fautes de ce dernier (CE. Ass. 13 novembre 2013, M. Dahan, n° 347704, publiée au Recueil). La radiation d’une personne ayant commis un crime ou un délit contraire à la probité ou aux mœurs n’étant pas une sanction – mais une obligation légale pour l’administration – le juge ne contrôle pas son caractère proportionné.
Se pose néanmoins la question des garanties accordées aux agents qui font l’objet d’une telle décision.
En effet, la circonstance que ce type de décision ne soit pas une sanction ne signifie pas pour autant que l’agent n’a aucune garantie.
Or, sur ce point, la jurisprudence paraît contradictoire. Certaines cours administratives d’appel avaient initialement jugé que l’administration était en situation de compétence liée pour radier l’agent de la fonction publique et en avaient déduit que tous les moyens de procédure dirigés contre ces décisions étaient inopérants (CAA Versailles, 2 novembre 2006, n° 05VE00120, précité ; CAA Bordeaux, 8 mars 2011, n° 10BX01886, précité). Cette position renvoie à la jurisprudence classique en vertu de laquelle lorsque l’administration est en situation de compétence liée pour agir (autrement dit qu’elle n’a aucun choix et aucune marge d’appréciation sur la conduite à tenir), les moyens de procédure et de forme dirigés contre cette décision sont inopérants (CE. Sect. 3 février 1999, M. Montaignac, n° 149722, publiée au Recueil).
Cependant, cette position a été remise en cause par d’autres arrêts plus récents dans lesquels il est considéré que si l’administration n’a effectivement aucun choix une fois qu’elle a considéré que l’agent a été condamné pour un crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, elle procède bien, en amont, à une appréciation des faits et à leur qualification. En effet, l’administration doit se pencher sur la condamnation pour déterminer si elle est contraire à la probité ou aux mœurs, toutes les condamnations n’étant pas forcément contraires à la probité ou aux mœurs (par exemple : un homicide involontaire dans le cadre d’un accident, etc.).
Dans ces conditions, selon la cour administrative d’appel de Paris, l’administration n’est pas en situation de compétence liée au sens de la jurisprudence M. Montaignac (puisqu’elle apprécie le caractère du crime ou du délit commis), de sorte que les vices de procédures sont opérants contre ces décisions.
La cour en a déduit, d’une part, que ces décisions – qui sont défavorables et sont prises en considération de la personne – doivent être motivées en droit et en fait (CAA Paris, 24 septembre 2013, n° 11PA05024) et, d’autre part, doivent être précédées de la possibilité pour l’agent de consulter son dossier (CAA Paris, 3 avril 2014, n° 13PA00415, précité).
Par conséquent, l’agent conserve – selon la cour administrative d’appel de Paris – un minimum de garanties même si la décision n’est pas une sanction.
Néanmoins, l’on ne peut être certain que cette position sera suivie à l’avenir par d’autres juridictions eu égard à la contradiction des cours entre elles et à l’absence de position prise par le Conseil d’Etat sur cette question.
L'ajournement ne peut se fonder que sur les règles de validation arrêtées par l'université
Le 04/04/2018
Par un arrêt n° 17PA00477 du 13 mars 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé qu’un ajournement ne pouvait être prononcé qu’au vu des règles de validation du diplôme adoptées conformément aux textes et non de « règles » orales ou même écrites communiquées aux étudiants.
Plus précisément, dans cette affaire était en cause l’ajournement d’une étudiante à sa licence du fait de l’application d’une « règle » selon laquelle tous les UE devaient être validés avec une moyenne de 10/20.
En effet, cette « règle », dont avait été informée l’étudiante, n’était pas prévue dans les règles de validation du diplôme, adoptées par la commission de la formation et de la vie universitaire (compétente en vertu de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation). Ces règles prévoyaient au contraire une compensation entre les notes des différents UE sur le semestre.
Par conséquent, la cour rappelle que le jury qui n’applique pas les règles arrêtés par la commission de la formation et de la vie universitaire commet une erreur de droit.
Aussi, elle annule la décision d’ajournement, à la suite du recours formé par l’étudiante, et enjoint à l’université de délivrer son diplôme à l’étudiante.
Cet arrêt est intéressant à un second titre dans la mesure où l’administration demandait au juge qu’il prononce une substitution de motifs de la décision d’ajournement (la substitution de motifs est un mécanisme qui permet à l’administration de demander au juge qu’il donne un nouveau fondement à sa décision à la place de son fondement initial jugé illégal – voir sur ce point : CE. Sect. 6 février 2004, Mme Hallal, n° 240560, publiée au Recueil). Plus précisément, l’université indiquait que l’étudiante s’était rendue coupable d’un plagiat et qu’ainsi une note éliminatoire devait lui être attribuée.
La cour refuse de prononcer cette substitution en estimant que même si le jury aurait pu, initialement, tenir compte de cet élément pour attribuer une note éliminatoire à l’étudiante, il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle d’un jury en modifiant les notes attribuées par ce dernier.
Autrement dit, le jury aurait pu mettre une note éliminatoire à l’étudiante mais le juge ne peut pas le faire, a posteriori, à sa place.
Ce raisonnement est vrai dans la mesure où, effectivement, le juge ne peut pas substituer son appréciation à celle d’un jury, ce dernier étant souverain (CE. SSR. 20 mars 1987, M. Gambus, n° 70993, publiée au Recueil ; CE. SSR. 12 mai 2017, n° 396335, mentionnée aux tables). Dans ces conditions, la cour ne pouvait pas modifier la note attribuée par le jury lui-même.
En revanche, un doute peut exister quant à la possibilité pour le jury d’attribuer une note éliminatoire à l’étudiante en raison du plagiat supposé. En effet, les notes doivent en principe porter sur la valeur de l’étudiant (CE. SSR. 1er juillet 1987, Mlle Vincent, n° 65324, mentionnée aux tables) de sorte qu’une fraude ou un plagiat qui n’a pas été établi par le conseil de discipline ne peut justifier une note éliminatoire (TA Paris, 30 octobre 1996, Lathière ; TA Paris 8 janvier 1997, Benyounes). En effet, si la fraude est reconnue, alors le bénéfice de l’examen est automatiquement perdu (article R. 811-11 du code de l’éducation), mais rien n’indique que le jury d’examen peut, avant cela, attribuer une note éliminatoire à l’étudiant pour sanctionner sa fraude. Dans ces conditions, la première partie de l’affirmation de la cour reste contestable puisque cette question n’a pas été expressément tranchée par la jurisprudence, ce qui méritait d’être souligné.
Le Conseil constitutionnel ouvre la voie au lancement de « Parcoursup »
Le 26/03/2018
Par une décision n° 2018-763 DC du 8 mars 2018, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours qui avait été formé contre la loi n° 2018-166 relative « à l’orientation et à la réussite des étudiants ».
Ce texte, qui introduit notamment le principe d’une sélection pour l’entrée en première année à l’université, est celui qu’a préparé le gouvernement pour donner une base légale à la plateforme « Parcoursup » lancée en début d’année. Il modifie en profondeur la philosophie de l’entrée à l’université en introduisant une sélection. Le recours contre ce texte ayant été rejeté, c’est une étape supplémentaire qui a été franchie dans le processus qui va mener – pour la première fois – à une sélection des bacheliers lors de leur entrée en première année universitaire.
En effet, dans cette décision, le Conseil constitutionnel écarte les différents arguments qui étaient soulevés contre ce texte.
Parmi les arguments principaux, il était notamment reproché au texte de prévoir que l’inscription d’un étudiant peut être subordonnée à l’acceptation par ce dernier d’un « accompagnement pédagogique et de parcours de formation personnalisés » pour les candidats dont les acquis et les compétences ne correspondent pas entièrement aux caractéristiques de la formation.
Ces dispositions, qui visent principalement les élèves issus de filières techniques et du bas général STG, doivent en principe permettre à ces étudiants de se mettre à niveau. Néanmoins, le contenu de ces « parcours de formation personnalisés » étant pour l’instant encore flou, il est difficile de savoir quel sera, en réalité, l’objet et l’effet pratique de ces formations.
Les auteurs de la saisine critiquaient ce dispositif en se fondant, d’une part, sur le principe d’égal accès à l’enseignement supérieur en affirmant que ces dispositions constituaient un obstacle à l’entrée pour les étudiants issus de certaines filières. D’autre part, un argument tiré de l’absence de définition suffisante des critères de désignation de ces étudiants dont les acquis et compétences ne correspondent pas entièrement aux caractéristiques de la formation.
Cependant, le Conseil constitutionnel estime de manière lapidaire que les critères sont suffisamment définis, objectifs et rationnels pour permettre de respecter le principe d’égal accès à l’instruction. Pour mémoire, ces critères sont les suivants :
- Caractéristiques de la formation (les « attendus » de Parcoursup),
- Appréciation sur les acquis de la formation antérieure,
- Compétences du candidat.
Ces critères sont donc assez larges (de sorte que l’on ne peut savoir en l’état ce qu’ils vont recouvrir) mais le Conseil constitutionnel estime qu’ils sont suffisamment définis.
En dehors de ce point important, il se penche également sur le cœur du nouveau système Parcoursup, à savoir l’introduction de la sélection.
En effet, les auteurs de la saisine soulevaient également un moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égal accès l’enseignement supérieur en ce que le texte prévoit que dans l’hypothèse où le nombre candidatures excède les capacités d’accueil de la formation, une sélection est opérée en fonction : du projet de formation des candidats, de leurs acquis et de leurs compétences.
Sur ce point – qui le point central dans le changement de philosophie du système universitaire – le Conseil constitutionnel est toutefois laconique et se borne à juger que le législateur a retenu des critères « objectifs » de nature à garantir le respect de l’égal accès l’instruction.
Dès lors, par cette courte affirmation, le Conseil constitutionnel entérine le principe de la sélection à l’entrée à l’université.
Cette sélection, prévue par la loi du 8 mars 2018 est la suivante :
S’il y a davantage de candidats que de places disponibles, alors ces derniers sont sélection en fonction de l’adéquation entre les caractéristiques de la formation (les « attendus » de Parcoursup), d’une part, et les acquis de la formation antérieure et les compétences des étudiants (leur dossier), d’autre part. En effet, bien que le texte ne le dise pas clairement, la « formation antérieure » et les « compétences » des candidats-étudiants seront en réalité leur dossier scolaire.
En se référant aux documents voués à être traités par l’application Parcoursup (arrêté du 19 janvier 2018), l’on constate que ce dossier de candidature sera notamment constitué des bulletins scolaires au titre de la première et de la terminale, d’une lettre de motivation et d’un CV. Ce point est confirmé par le site de Parcoursup lui-même qui évoque ces éléments dans l’onglet « finaliser votre dossier ».
Ainsi, le nouveau système sera bien une sélection en fonction du dossier scolaire (notations, appréciations, établissement d’origine, expérience, motivation).
Dès lors, par sa décision, le Conseil constitutionnel entérine bien la sélection à l’entrée à l’université.
Le Conseil d'Etat ne se prononcera pas sur la légalité de Parcousup
Le 19/03/2018
Par deux ordonnances n° 417905 et 418029 du 20 février 2018, le Conseil d’Etat rejette les référés formés par différentes associations et syndicats contre les décisions de créer la plateforme Parcoursup et l’arrêté du 19 janvier 2018 autorisant la collecte des données.
En effet, à l’instar de ce qu’il avait jugé à propos de la circulaire APB, le conseil d’Etat refuse de se prononcer sur la légalité des décisions qui lui sont soumises. Plus précisément, en matière de référé suspension, il est nécessaire qu’une situation d’urgence soit établie pour que le juge administratif se prononce sur l’existence de moyens sérieux justifiant la « suspension » de l’exécution de la décision contestée dans l’attente d’une décision au fond.
Au cas présent, comme il l’avait jugé pour la circulaire APB, le Conseil d’Etat estime que l’intérêt public s’oppose à ce que l’exécution des décisions soit suspendue. Autrement dit, même si la décision était illégale, il vaudrait mieux qu’elle demeure dans l’ordonnancement juridique, sa suspension créant plus de troubles que son maintien illégal.
Pour ce faire, il retient que la plateforme est accessible aux futurs étudiants depuis le 22 janvier de sorte qu’une suspension mettrait fin à la procédure nationale de préinscription, ce qui perturberait gravement les étudiants et les autorités académiques et compromettrait, de surcroit, le déroulement du début de l’année universitaire 2018/2019. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat considère que l’intérêt public s’oppose à la suspension des décisions de création de Parcoursup et de l’arrêté permettant la collecte des données.
Il relève également que la collecte des données prévue par l’arrêté du 19 janvier 2018 a un caractère limité, de sorte que la gravité de cette collecte n’est pas établie.
Ainsi, il refuse de se prononcer sur la légalité du système Parcoursup.
Cette position est la même qu’il avait adopté en juin dernier à propos de la circulaire APB. La Haute juridiction semble donc avoir adopté une stratégie consistant à ne pas intervenir avant la rentrée universitaire et attendre qu’elle soit passée pour annuler les textes qui lui sont soumis. C’est ce qu’elle a fait avec la circulaire APB puisque cette dernière a finalement été annulée en décembre 2017.
Le résultat est toutefois qu’en agissant de la sorte, le Conseil d’Etat prive ses propres décisions de tout effet utile. En effet, s’agissant d’APB, annuler la circulaire une fois la rentrée passée et alors que le système APB venait d’être supprimé a donné un caractère assez théorique à son annulation.
S’agissant de Parcoursup qui nous intéresse en l’espèce, il est à peu près certain que si le Conseil d’Etat avait accepté de se prononcer, il aurait suspendu l’exécution de la décision de créer Parcoursup. En effet, cette décision, qui instaure la sélection, a été prise avant que la loi du 8 mars 2018 ne l’autorise. Dès lors, à la date de lancement de Parcoursup le 22 janvier 2018, l’ancien texte de l’article L. 612-3 du code de l’éducation interdisait toujours la sélection comme l’a récemment rappelé le Conseil d’Etat.
De la sorte, une nouvelle fois, le Conseil d’Etat renverra – comme il l’a fait pour APB – aux juridictions du fond le soin de se prononcer sur la légalité de ce système à l’occasion des recours formés contre les refus d’admission en première année (qui ne manqueront pas d’être, à nouveau, intentés cette année).
Les sursis à statuer en matière d’urbanisme et la répartition des compétences en Nouvelle-Calédonie
Le 12/03/2018
Par un avis n° 410805 du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat estime que les dispositions de l’article PS. 112-14 du code de l’urbanisme néo-calédonien (applicable à la province Sud) – qui prévoient que le délai de confirmation de la demande à la suite d’un sursis à statuer est inopposable s’il n’a pas été mentionné – sont illégales.
Il convient de rappeler que les règles d’urbanisme néo-calédoniennes ont été récemment réformées, que ce soit celles applicables à l’ensemble du territoire que dans celles, plus spécifiques, applicables en province Sud et en province Nord.
Au terme de cette réforme, l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme de Nouvelle-Calédonie prévoit que les décisions de sursis à statuer, opposés à des demandes d’autorisation d’urbanisme du fait de l’élaboration d’un plan d’urbanisme directeur, doivent être motivées et ne peuvent excéder deux ans. Le texte indique également que la demande initiale peut être confirmée dans un délai de deux mois après l’expiration du sursis.
Cette règle n’a, en soi, rien d’original puisqu’il s’agit d’une simple transposition de la règle applicable en métropole.
Néanmoins, au-delà de cet article en « R. » (compétence réglementaire du territoire), l’article PS. 112-14 du même code (la référence « PS. » indique que cet article a été adopté par la province Sud dans le cadre de l’exercice de ses compétences) apporte deux précisions et limites à cet article.
En effet, il indique :
- D’une part, que la décision de sursis doit rappeler le délai de confirmation de deux mois visé à l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme de Nouvelle-Calédonie.
- D’autre part, qu’à défaut de mention de ce délai, aucun délai n’est opposable (de sorte que la demande peut être confirmée au-delà de deux mois).
La première règle vise à informer les demandeurs de la règle. Et la seconde est imposée pour contraindre les communes à bien indiquer cette information dans les décisions de sursis.
C’est cette seconde règle dont les juridictions administratives ont été saisies et qui a donné lieu à l’avis du Conseil d’Etat. En effet, cette règle a été contestée, non pas pour son contenu – qui semble difficilement discutable sur le plan de la légalité – mais sur la compétence de la province Sud pour édicter une telle règle.
Plus précisément, la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 qui répartit les compétences entre l’Etat, le territoire de la Nouvelle-Calédonie et les autres collectivités territoriales prévoit en son article 22 que le territoire est compétent pour édicter les « principes directeurs du droit de l’urbanisme », les provinces étant compétentes pour le reste des règles applicables en matière d’urbanisme.
Ces « principes directeurs » n’étant pas définis par le texte, l’interprétation de ces termes n’est pas aisée.
Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion d’éclaircir quelque peu cette notion de « principes directeurs » (CE. SSR. Avis. 27 juillet 2012, M. Philippe B, n° 357824, mentionnée aux tables) de sorte que l’avis qui nous intéresse ici n’apporte rien sur le plan du droit. En effet, il rappelle que cette notion ne se confond pas avec :
- Les principes constitutionnels,
- Les principes relevant de l’article 34 de la Constitution (c'est-à-dire réservés au Parlement sur le plan national).
Les « principes directeurs » dépassent les principes législatifs et recouvrent donc également les principes posés, en métropole, par le règlement.
Ces principes sont très larges et concernent le fond et la procédure. De plus, leur champ est également extensif puisqu’ils recouvrent : l’encadrement des atteintes au droit de propriété, la détermination des compétences et la garantie de la cohésion territoriale.
Cette définition restant assez théorique, le Conseil d’Etat donne, dans l’avis commenté et l’avis M. Philippe B, différents exemples :
- Les règles générales relatives à l’utilisation du sol,
- Les règles relatives aux documents d’urbanisme,
- Les règles relatives aux procédures d’aménagement et au droit de préemption,
- Les règles relatives à la détermination des autorités compétentes pour élaborer et approuver les documents d’urbanisme, conduire les procédures d’aménagement, délivrer les autorisations d’urbanisme et exercer le droit de préemption.
L’on constate donc qu’autrement dit, les « principes directeurs » recouvrent peu ou prou toutes les règles de fond et les règles de compétence.
Au vu cet état du droit, le Conseil d’Etat estime que la règle selon laquelle si le délai de confirmation de la demande (deux mois à l’expiration du sursis) n’est pas mentionné dans la décision de sursis à statuer, alors il est inopposable, relevait des « principes directeurs ».
Cette position apparaît logique puisque les règles générales de procédure relatives à la délivrance des permis de construire (et notamment aux sursis à statuer) touchent à « l’encadrement des atteintes au droit de propriété » qui relève de la compétence du territoire.
En outre, une autre considération, plus pratique, de cette solution (évoquée par le rapporteur public, Aurélie Bretonneau, dans ses conclusions) est qu’une telle règle doit s’appliquer indifféremment sur l’ensemble du territoire néo-calédonien. Il serait en effet, dommageable, pour les demandeurs (et pour la cohérence générale du système) que de telles règles soient différentes en province Sud et province Nord.
Dès lors, quand bien même la règle en cause est empreinte de logique, elle n’a pas été adoptée par une autorité compétente et ne sera donc pas opposable. Cela signifie donc – en pratique – que même si le délai de confirmation n’a pas été mentionné dans la décision de sursis à statuer, il sera opposable au demandeur.
La circulaire APB est illégale
Le 29/01/2018
Par une décision n° 410561 du 22 décembre 2017, le Conseil d’Etat fait droit au recours des associations SOS Education, Promotion et défense des étudiants et Droits des lycéens, dirigé contre la circulaire du 24 avril 2017 ou circulaire « APB ». En effet, la Haute juridiction considère que cette circulaire est illégale au motif qu’elle conduit à la mise en oeuvre d’un tirage au sort trop fréquent dans les filières dites « en tension ».
Avant d’évoquer plus en détail le contenu de cette décision, il est nécessaire de rappeler le contexte juridique (voir la saga juridique) dans lequel s’inscrit cette décision relative au système APB, qui devrait être le point final de cette série de décisions – du moins jusqu’au le début de la saga Parcoursup qui commencera à n’en point douter en juin prochain.
1. En effet, la décision du Conseil d’Etat a été prise dans le contexte juridique délicat des inscriptions en première année à l’université qui a donné lieu à de nombreuses décisions de justice ces dernières années. Plus précisément, au cours des dernières rentrées universitaires, de nombreux candidats-étudiants à la première année de licence se sont vu refuser toute inscription à l’issue de la procédure APB. Face à cette année « blanche », certains d’entre eux ont saisi les juridictions administratives de recours contre ces refus.
A l’occasion de ces recours, et avec l’aide d’associations d’étudiants, il est apparu que l’algorithme d’affectation APB avait été « enrichi » d’un tirage au sort permettant de départager les étudiants. Or, cette méthode a été censurée par le juge administratif pour son absence de base légale (voir, par exemple, en ce sens : TA Bordeaux, 16 juin 2016, n° 1504236).
Pour tenter de pallier cette carence, le gouvernement a adopté, dans l’urgence, une circulaire n° 2017-077 du 24 avril 2017 afin de donner un début de base légale à ce système etr tenter de limiter le nombre de contentieux (voir l’article : quel effet pour la circulaire « APB » ?). Un recours en référé a alors été formé par plusieurs associations contre cette circulaire devant le Conseil d’Etat. Toutefois, par une ordonnance du 2 juin 2017, ce dernier a rejeté le recours, estimant que la condition d’urgence pour qu’il se prononce n’était pas remplie.
Cependant, des juridictions du fond se sont prononcées à l’occasion de refus d’admission opposés à des candidats à la première année. Tel est notamment le cas du tribunal administratif de Bordeaux qui a estimé, par trois ordonnances du 21 septembre 2017, que la circulaire APB était illégale dès lors qu’elle introduisait un quatrième critère de départage des candidats (à travers le tirage au sort) en plus des trois critères textuels déjà prévus.
Depuis lors, une réforme profonde de l’entrée à l’université a été décidée par le gouvernement instaurant – en pratique – un début de sélection pour l’accès à la première année. Bien que cette réforme ne soit pas encore adoptée, la plate-forme Parcoursup a déjà été mise en place.
Ainsi, cette nouvelle plate-forme et les nouvelles règles rendent caducs les débats relatifs à la procédure APB. Néanmoins, il est intéressant de rester attentifs aux décisions rendues à propos d’APB, lesquelles restent riches d’enseignements.
2. C’est donc dans ce contexte que, par la décision du 22 décembre 2017, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité de la circulaire APB. Les enseignements de cette décision sont nombreux en matière de droit de l’éducation et, notamment, à propos de l’utilisation du tirage au sort comme mode de départage des candidats.
● En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle dans cette décision que l’article L. 612-3 du code de l’éducation établit, en principe, un droit pour les candidats à la première année d’être inscrit dans l’université de leur choix dans leur académie. Ainsi, la Haute juridiction reconnaît qu’il existe bien un libre choix de la filière et de l’université en première année (dans son académie d’origine). Jusqu’ici, le Conseil d’Etat ne paraissait pas l’avoir reconnu aussi clairement. C’est désormais chose faite.
Néanmoins, il rappelle également la limite de ce principe, à savoir les hypothèses dans lesquelles le nombre de candidatures dépasse le nombre de places. La Haute juridiction souligne que dans ce cas, l’article L. 612-3 du code de l’éducation prévoit trois critères de classement (domicile, préférences du candidat, situation familiale).
● En deuxième lieu, le Conseil d’Etat précise que ces dispositions, qui donnent compétence au ministre pour préciser les modalités de mise en œuvre de ces critères, lui donnent également compétence pour fixer les règles de départage des étudiants si les trois critères ne suffisent pas à le permettre. Ainsi, la Haute juridiction consacre expressément une possibilité pour le ministre d’aller un peu plus loin que les trois critères.
Elle précise également que ce départage peut se faire par tirage au sort. Dès lors, le Conseil d’Etat confirme que le tirage au sort n’est pas, en soi, une technique illégale. C’est ce qu’il avait déjà pu juger implicitement par le passé (CE. SSR. 5 novembre 2001, Ministre de l’éducation, n° 215351, mentionnée aux tables). Cependant, le Conseil d’Etat apporte une limite à ce principe en indiquant que le tirage ne peut intervenir qu’à titre « exceptionnel » afin de respecter le caractère limitatif des critères énoncés par l’article L. 612-3 du code de l’éducation.
Autrement dit, le tirage au sort ne pose pas de difficulté de principe au Conseil d’Etat. Mais il ne peut être utilisé qu’avec parcimonie et ne peut pas constituer une méthode générale de sélection, faute de quoi, le tirage au sort deviendrait un réel critère de sélection, non-prévu par le code de l’éducation.
Dès lors, le ministre doit fixer les modalités des trois critères de telle sorte qu’un départage soit exceptionnel.
● En troisième lieu, appliquant ces principes à la circulaire, le Conseil d’Etat considère qu’ils ont été méconnus. En effet, il relève que le tirage au sort a été appliqué dans un nombre important de filières « en tension ». Il en déduit donc que les modalités de mise en œuvre des trois critères, prévues par la circulaire, ne permettent pas de garantir qu’un départage n’aura lieu qu’à titre exceptionnel. Dans ces conditions, il considère que la circulaire méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’éducation.
Cette position est intéressante à plusieurs titres :
- Tout d’abord, le Conseil d’Etat ne censure pas l’utilisation du tirage au sort mais les modalités de mise en œuvre des trois critères précédant ce tirage au sort. En effet, ce qu’il reproche au ministre, c’est de ne pas avoir trouvé des modalités d’application des trois critères permettant de faire en sorte que le tirage au sort soit utilisé de manière exceptionnelle.
- Ensuite, d’un point de vue contentieux, la méthode utilisée par la Haute juridiction est peu orthodoxe puisqu’elle se fonde sur l’application pratique de la circulaire pour en déduire qu’elle est illégale. En effet, c’est en constant que de nombreuses filières en tension ont fait l’objet d’un tirage au sort que le Conseil d’Etat estime que ce tirage au sort n’est pas exceptionnel et donc illégal. Il prend ainsi en compte des éléments postérieurs à l’émission de la circulaire pour juger de sa légalité méthode qui en principe ne peut être utilisée dans un contentieux d’excès de pouvoir).
- Enfin, le Conseil d’Etat fait application de la jurisprudence AC ! (CE. Ass. 11 mai 2004, Association AC !, n° 255886, publiée au Recueil) en modulant les effets de l’annulation de la circulaire en les limitant à l’avenir. Autrement dit, les inscriptions et refus d’inscription opposés sur le fondement de la circulaire demeurent légaux (sous réserves des décisions d’inscription ou de refus d’inscription qui ont fait l’objet d’un recours à la date de la décision du Conseil d’Etat).
Date de dernière mise à jour : 17/10/2024