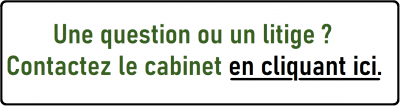- Accueil
- Blog
Blog
Le 30/11/2019
Par un arrêt n° 19NT00515 du 19 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a considéré qu’il était possible de tenir compte du comportement d’un postulant, agent contractuel de l’armée, dans ses fonctions, qui dénotait un « un défaut de respect de la réglementation applicable » pour rejeter sa demande de naturalisation.
1. Dans cette affaire, était en cause la demande de naturalisation présentée par un ancien légionnaire. Cette demande avait été rejetée par le ministre de l’intérieur, motif pris des sanctions prononcées à son encontre à l’époque où le postulant était encore légionnaire (pour non-présentation, retard, non-respect des règles sanitaires, détention d’un ordinateur, etc.).
Malgré les appréciations élogieuses portées par les supérieurs hiérarchiques du postulant sur ses appréciations, le ministre avait considéré que ces sanctions justifiaient un rejet de sa demande de naturalisation.
Dans son arrêt, la cour commence par rappeler la formule qu’elle utilise classiquement selon laquelle « dans le cadre de cet examen d'opportunité, [le ministre] peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant » (CAA Nantes. CHR. 25 février 2014, n° 13NT02262). En effet, dans la mesure où la naturalisation n’est pas un « droit », c’est une décision prise en opportunité (CE. SSR. 30 mars 1984, Ministre des affaires sociales, n° 40735, mentionné aux tables), ce qui laisse une très large marge d’appréciation à l’administration.
Après cela, elle se penche sur les faits de l’espèce.
Elle constate alors que les faits en cause (sanctions par l’employeur public du demandeur) ne sont :
- Ni contraires à l’honneur,
- Ni contraires à la probité ou aux bonnes mœurs,
- Ni sanctionnées pénalement.
Cependant, elle ne censure pas la décision du ministre.
En effet, elle considère que ces sanctions récurrentes révèlent un « défaut de respect de la réglementation applicable » et qu’ainsi, malgré ses « appréciation élogieuses », le ministre pouvait légalement rejeter sa demande de naturalisation.
Une telle position stricte appelle plusieurs observations.
2. Cette solution rappelle que la naturalisation reste une mesure discrétionnaire pour l’Etat qui peut refuser de l’accorder à celui ou celle qui remplit les conditions pour l’obtenir, en se fondant sur de nombreuses informations recueillies sur les postulants.
D’ailleurs, l’utilisation dans le considérant de principe de cet arrêt de la formule « renseignements défavorables recueillis » montre le caractère particulièrement large de l’origine des renseignements que l’administration peut prendre en compte. En règle générale, l’administration se fonde sur les informations recueillies auprès de la justice, de la police, des services de renseignements et des services de l’Etat (notamment l’administration fiscale) pour apprécier le comportement d’une personne demandant sa naturalisation.
Au cas présent, la source de ces renseignements interroge quelque peu.
En effet, ces « renseignements défavorables » proviennent de l’employeur du postulant.
Certes, cet employeur n’est autre que l’Etat lui-même puisque l’intéressé était sous contrat avec la légion étrangère. Toutefois, il n’en reste pas moins que l’administration puis le juge ont retenu les sanctions infligées par un employeur à son agent pour refuser sa naturalisation.
3. Une telle position est problématique pour plusieurs raisons :
D’une part, elle ouvre une porte à la prise en compte, pour tous les postulants travaillant pour l’administration, des appréciations portées par leurs employeurs publics, de sorte que ces derniers puissent s’opposer à une naturalisation future.
En effet, dans cette affaire, était en cause un agent de la légion étrangère mais qu’aurait jugé la cour s’il s’était agi d’un agent de l’Etat travaillant dans un service administratif quelconque ou pour une collectivité territoriale ? Le juge aurait-il considéré que les appréciations et sanctions de la personne publique employeur avaient une telle importance ? de même qu’en aurait-il été si l’employeur n’avait pas été public mais privé ?
Il n’est pas possible de répondre avec certitude à ces questions.
En effet, c’est sans doute la position particulière des employés de la légion (qui sont à la fois sous contrat mais exercent des fonctions de défense de la nation) qui a poussé la cour à tenir compte de ces éléments.
Cependant, il n’est absolument pas certain que la cour n’en aurait pas tenu compte si l’employeur avait été un autre employeur public, voire privé. Dans la mesure où la cour n’a pas mentionné le caractère particulier de la position de légionnaire et s’est bornée à retenir que les sanctions dénotaient « un défaut de respect de la réglementation applicable », la portée de sa décision est difficile à apprécier.
Dès lors, par cet arrêt, la cour a ouvert une brèche et rendu plus poreuse la distinction entre comportement au travail et demande de naturalisation.
D’autre part, cette position apparaît particulièrement stricte dans la mesure où malgré les sanctions infligées à l’intéressé, ce dernier avait fait l’objet, dans son activité « d'appréciation élogieuses de ses supérieurs hiérarchiques ».
En effet, dès lors que les informations émanant de l’employeur public étaient prises en compte pour statuer sur sa naturalisation, il aurait paru opportun de se pencher sur l’appréciation générale du postulant par sa hiérarchie.
Toutefois, tel n’est pas le choix fait par la cour, qui reste très stricte et laisse une très large marge d’appréciation au ministre pour faire droit ou non à une demande de naturalisation.
Le 21/11/2019
Par un jugement du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil rappelle qu’aucune sélection en master 2 n’est possible dès lors que la formation n’est pas sur la liste de celles où, par dérogation, une sélection était autorisée. Il précise que le fait que l’étudiant en question ait ou non été soumis à une sélection au moment de son entrée en master 1 ne change rien à ces principes.
1. En effet, le code de l’éducation prévoit (article L. 612-6 du code) que l’accès en master 1 peut être subordonné « au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». A l’inverse, l’entrée en master 2 est en principe automatique pour les étudiants qui ont obtenu leur master 1 (article L. 612-6-1 du code de l’éducation).
Mais pour permettre la mise en place en douceur de cette réforme (puisqu’auparavant la sélection était effectuée – de manière illégale – entre le master 1 et le master 2), il a été prévu d’autoriser de manière dérogatoire certaines formations à effectuer une sélection entre le master 1 et le master 2 à condition qu’aucune sélection ne soit réalisée à l’entrée en master 1 (voir, sur ce point, l’article : L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective).
Pour que cette sélection dérogatoire en master soit mise en œuvre, il est également nécessaire que la formation en cause soit mentionnée sur la liste dressée en annexe du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016, qui est remise à jour tous les ans.
2. Dans l’affaire jugée par le tribunal administratif de Montreuil, la formation en cause figurait jusqu’à la rentrée universitaire 2019-2020 sur la liste des formations dans lesquelles une sélection pouvait être instaurée entre le master 1 et le master 2.
Toutefois, pour la rentrée universitaire 2019-2020, l’université avait maintenu la sélection à l’entrée en master 2, malgré la disparition de la formation en cause de la liste dérogatoire.
Devant le tribunal administratif de Montreuil, l’université tentais de justifier sa position en affirmant qu’il se dégageait des articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l’éducation un principe général selon lequel un étudiant qui n’avait pas été soumis une sélection en master 1 pouvait faire l’objet d’une sélection en master 2.
Par ce raisonnement, l’université cherchait donc à neutraliser la deuxième condition posée par ces articles pour qu’une sélection à l’entrée en master 2 soit légalement instaurée, à savoir que la formation en cause soit mentionnée sur la liste annexée au décret du 25 mai 2016.
Le tribunal a, assez logiquement, écarté cet argument.
D’une part, les textes sont particulièrement clairs. En effet, le principe est l’absence de sélection à l’entrée en master 2. La sélection n’est qu’une exception.
Or, il est prévu qu’un décret fixe la liste des formations qui peuvent bénéficier de cette dérogation.
Dès lors, si une formation n’est pas mentionnée sur cette liste, aucune circonstance ne peut justifier cette sélection au regard de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation.
D’autre part, il est clair qu’en l’absence de texte autorisant expressément la sélection, une telle sélection ne peut pas être mise en œuvre (CE. SSR. Avis, 10 février 2016, n° 394594, publié au Recueil).
Dans ces conditions, le tribunal juge, en substance, que la circonstance qu’un élève n’ait fait l’objet d’aucune sélection à son entrée en master 1 n’autorise pas, à elle seule, l’université à le soumettre à une sélection à l’entrée en master 2.
Le 19/11/2019
Par un arrêt n° 18NT04440 du 20 juin 2019, la cour administrative d’appel de Nantes estime que l’administration ne peut pas se fonder sur l’existence même de condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation pour rejeter une demande de naturalisation mais peut se fonder sur les faits à l’origine de ces condamnation pour estimer que le postulant n’est pas de « bonne vie et mœurs ».
Cette décision, contestable, se fonde sur une distinction artificielle (mais ancienne) entre condamnation et faits à l’origine de la condamnation pour neutraliser les effets de la réhabilitation.
1. En effet, il convient de rappeler qu’en vertu des articles 133-12 et suivants du code pénal, passé un certain délai, les peines infligées aux personnes condamnées sont regardées comme n’ayant jamais existé.
Ces dispositions ont vocation à préserver la paix sociale et instituent une forme de droit à l’oubli : passé un certain délai, si l’intéressé s’est bien comporté et ne s’est vu imposer aucune condamnation, il est considéré que son passé n’existe plus.
Aussi, l’article 133-11 du code pénal interdit formellement à l’administration « d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque ».
La Cour de cassation a eu l’occasion de juger que toute mention de condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation devait conduire à la nullité de l’acte en faisant mention (Cass. Crim. 8 novembre 1995, n° 95-81306, publié au Bulletin). Elle a précisé qu’il en allait ainsi dans le domaine de l’acquisition de la nationalité (Cass. 1ère civ. 29 février 2012, n° 11-10970, publié au Bulletin).
Il est donc en principe formellement interdit de faire état d’une condamnation ayant donné lieu à réhabilitation à l’occasion d’une demande de naturalisation.
C’est ce qu’a confirmé, anciennement, le Conseil d’Etat (CE. SSR. 23 juin 1995, M. Mohammed X, n° 139897).
2. Dans l’arrêt commenté de la cour administrative d’appel de Nantes, rendu en matière de naturalisation, cette dernière neutraliser les effets de l’article 133-11 du code pénal.
En effet, après avoir censuré la décision de rejet de la demande de naturalisation, en tant qu’elle se fondait sur des condamnations réhabilitées par l’écoulement du temps, la cour considère que l’administration pouvait se fonder, non pas sur les condamnations en elle-même mais sur les faits condamnés pour estimer que le postulant n’était pas « de bonnes vie et mœurs » au sens de l’article 21-23 du code civil.
Autrement dit, la cour estime que même si les condamnations ont disparu et qu’il est interdit d’en faire mention, les faits condamnés restent et peuvent servir de base à un refus de naturalisation.
Cette solution apparaît critiquable dans la mesure où elle crée une distinction artificielle entre la condamnation et les faits condamnés qui n’est pas dans l’esprit des articles 133-11 et suivants du code pénal.
Comme indiqué ci-dessus, l’idée qui irrigue ces dispositions est que la personne condamnée, qui s’est bien conduite pendant un temps défini par la loi, doit être regardé comme étant à nouveau vierge de toute condamnation.
Le but de ces dispositions n’est pas d’interdire de se fonder sur les condamnations anciennes tout en autorisant à se fonder sur les faits à l’origine de cette condamnation. D’ailleurs, c’est pour cette raison que la loi interdit d’en faire mention « sous quelque forme que ce soit ».
Or, lorsque la cour administrative d’appel de Nantes retient : « Le requérant ne peut sérieusement soutenir que les faits de vol, vol avec violence, vol en réunion, violences volontaires et escroquerie ne porteraient pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. En dépit de leur relative ancienneté, ces agissements, dont la matérialité n'est pas contestée, sont de nature, eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, à faire regarder le requérant comme n'étant pas, à la date de la décision contestée, de bonnes vie et mœurs », il ne peut être sérieusement contesté qu’elle fait mention de manière expresse d’infractions pénales qui ont été réhabilitées. En effet, la précaution tirée de l’utilisation des termes « faits » de vol, etc. et non pas de « condamnation pour » vol, etc. ne change rien à l’objet de ce rappel.
De la sorte, la distinction opérée par la cour est artificielle.
Cette position de la cour administrative d’appel de Nantes est ancienne (CAA Nantes, 30 juin 2006, n° 05NT01701) et rappelée régulièrement par cette dernière.
Elle n’en apparaît pas moins contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 133-11 du code pénal.
De plus, cette position est difficilement compatible avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est sévère en ce domaine (Cass. Crim. 10 novembre 2009, n° 09-82368, publié au Bulletin).
Ainsi, cette distinction artificielle retenue par la cour administrative d’appel est particulièrement critiquable.
Le 30/06/2019
Par une décision n° 417548 du 30 janvier 2019, le Conseil d'Etat revient sur la notion d'indignité justifiant l'opposition par le gouvernement à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un Français.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 21-2 du code civil, l'étranger marié depuis plus de quatre ans avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française.
Toutefois, le gouvernement peut s'opposer à cette acquisition pour des motifs tirés de « l'indignité » et du « défaut d'assimilation » de l'intéressé. Cette opposition peut intervenir dans les deux ans suivant la déclaration de nationalité souscrite par l'intéressé. Le gouvernement doit cependant informer au préalable l'intéressé des motifs de son intention de s'opposer à cette acquisition afin de préserver le principe du contradictoire.
Dans l'affaire soumise au Conseil d'Etat, le gouvernement s'est opposé à l'acquisition de la nationalité de l'intéressé au motif qu'il avait été condamné à plusieurs reprises dans un passé récent par les juridictions pénales pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et avait fuit à l'occasion d'un accident de la circulation. En effet, la commission d'infractions peut constituer une indignité.
Le Conseil d'Etat insiste ainsi (comme le montrent d'ailleurs l'analyse et les abstrats de la décision) sur le caractère « encore récent » de ces évènements.
En effet, si les faits reprochés à l'intéressé sont « ancien[s] », le gouvernement ne peut pas nécessairement s'opposer à l'acquisition de la nationalité par l'intéressé (en fonction de leur gravité). Ainsi, dans une affaire où étaient en cause deux condamnations pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique datant de 4 ans à la date de la décision d'opposition du Premier ministre, le Conseil d'Etat avait censuré la décision du ministre (CE. SSR. 28 avril 2014, n° 372679, publiée au Recueil) pour ce motif.
Cela démontre donc que non seulement la gravité des infractions doit être prise en compte mais que leur ancienneté joue un rôle majeur pour le Conseil d'Etat. C'est ce qui ressort d'ailleurs de décisions plus anciennes (CE. SSR. 30 janvier 1991, Ministre de la solidarité c. M. Abdoulaye X, n° 99983, mentionnée aux tables) que la présente décision ne fait que rappeler.
Le 20/06/2019
Par deux ordonnances n° 426884 et n° 426885 du 18 janvier 2019, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté les référés dits « libertés », fondés sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative intentés par deux étudiants interdits d'accès à leur université pour une durée d'un mois dans un contexte de blocages.
Était en cause dans ces affaires, deux arrêtés du président de l'université Paris X Nanterre en date du 21 décembre 2018 qui avaient interdit à deux élèves d'accéder à l'enceinte de l'université à compter du 7 janvier 2019 et jusqu'au 5 février 2019.
Ces arrêtés s'inscrivaient dans un contexte de blocage épisodique de l'université en protestation contre le projet du gouvernement d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers non communautaires.
A l'encontre de ces arrêtés, les étudiants se prévalaient de la liberté d'aller et de venir, de la liberté d'enseignement et du droit à l'éducation. Ils soulevaient différents moyens de procédure et de fond pour affirmer que l'atteinte portée à leurs droits était manifestement illégale.
Toutefois, le Conseil d'Etat répond par la négative à cette argumentation en estimant, d'une part, que la liberté d'aller et de venir ainsi que la liberté d'enseignement n'étaient pas atteintes par la mesure. D'autre part, concernant le droit à l'instruction, le juge des référés estime que l'université pouvait légitimement craindre que des nouvelles actions soient intentées à la rentrée universitaire et que les étudiants visés par les mesures étaient fortement impliqués dans les mouvements, de sorte qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'avait été portée à leur droit à l'instruction.
Cette décision appelle plusieurs observations.
● En premier lieu, il convient de conserver à l'esprit que ces décisions du Conseil d'Etat en matière d'interdiction d'accès à une université ont été rendues dans des procédures de référé-liberté.
Ce référé se distingue d'un recours au fond dans la mesure où le contrôle exercé par le juge n'est pas le même. En effet, le rejet du référé-liberté ne signifie pas pour autant que les mesures sont légales. Elles peuvent parfaitement être censurées au fond par le juge.
Le juge du référé ne censure que les atteintes « grave[s] » et « manifestement illégale[s] » aux libertés fondamentales. Si l'atteinte n'est pas suffisamment grave, ou si elle est illégale sans l'être de manière manifeste, alors il ne censure pas la décision, qui pourra parfaitement l'être ultérieurement.
C'est donc un juge de l'évidence et de la gravité. D'ailleurs, il convient de noter dans la jurisprudence récente du Conseil d'Etat que les recours introduits par une étudiante fortement handicapée qui n'avait pas pu passer ses examens (Déroulement des examens universitaire et juge du référé-liberté) et par un élève de collège exclu préventivement de son établissement (La décision d'éloigner un élève dans l'attente du conseil de discipline ne méconnaît pas le droit à l'éducation) n'avaient pas davantage été regardés comme fondés malgré les arguments forts qui avaient pu être mis en avant.
Cela démontre donc que le référé-liberté ne semble pas particulièrement adapté aux questions d'éducation. Mais il faut surtout conserver à l'esprit que cela ne préjuge pas de la légalité de ces mesures au fond.
● En deuxième lieu, ces décisions démontrent que le Conseil d'Etat a fait le choix d'un contrôle limité sur le lien entre les mesures prises et le risque lié à l'étudiant en cause.
En effet, dans son ordonnance, le juge des référés se borne à constater que l'université peut légitimement craindre que des blocages aient lieu à la rentrée et que l'étudiant en question est investi dans le mouvement.
Néanmoins, il ne recherche pas et ne caractérise pas le lien entre le risque retenu et l'étudiant en question. Il n'indique pas, par exemple, que celui-ci serait à l'origine des tracts justifiant les craintes légitimes de désordres ou serait l'instigateur des mouvements.
En cela, ces décisions risquent (même si ce contrôle restreint est justifié par l'office du juge du référé-liberté) de donner aux présidents d'université l'impression qu'un blanc seing leur a été donné par le Conseil d'Etat. En effet, cela donne l'impression qu'en cas de crainte (plus ou moins sérieuse), tout étudiant « fortement investi » peut être exclu à titre préventif de l'université. Ainsi, par ces ordonnances, le Conseil d'Etat risque fortement de tenter les présidents d'université de faire un usage discutable des pouvoirs de police qu'il tiennent de l'article R. 712-8 du code de l'éducation.
Néanmoins, l'impression donnée est peut-être trompeuse dans la mesure où, en l'espèce, les étudiants avaient fait le choix de former un référé-liberté dans le cadre duquel l'office du juge est particulièrement limitée. S'ils avaient formé un référé-suspension – à l'occasion duquel les pouvoirs du juge sont un peu plus étendus – la solution aurait peut-être été différente devant le juge de première instance.
● En troisième lieu, il est possible et probable que, sur le fond, le contrôle exercé par le juge administratif soit plus sévère.
Même si, en pratique, une annulation intervenant dans un an ou deux n'aura aucune incidence pour les étudiants en question, le débat devant le juge du fond devrait être plus délicat.
En effet, la jurisprudence rendue par le Conseil d'Etat montre que ce dernier exige, pour que la décision d'interdiction soit justifiée au fond que, d'une part, le risque d'atteinte à l'ordre public soit démontré et, d'autre part, que l'université démontre qu'elle n'est pas en mesure de maintenir l'ordre (CE. SSR. 26 octobre 2005, M. Bruno Gollnisch, n° 275512, publiée au Recueil ; voir, pour un exemple d'application plus récent : CAA Paris, 29 janvier 2019, n° 17PA00659).
Certes, ces deux décisions ont été rendues à propos d'interdictions d'accès à l'université prononcées à l'encontre de professeurs. Toutefois, elles étaient fondées sur les mêmes dispositions et il n'existe aucune raison légitime de penser que les juridictions administratives feront une application plus souple de cet article à propos d'étudiants.
Dans ces conditions, au fond, l'université en cause doit être mesure de démontrer un risque réel d'atteinte à l'ordre public et son incapacité à maintenir l'ordre en cas de survenance de ce risque.
Le 10/06/2019
Par une décision n° 413955 du 28 décembre 2018, le Conseil d'Etat revient sur la notion d'ensemble immobilier unique, qui impose en principe le dépôt d'un permis de construire unique.
En effet, par une décision de principe du 17 juillet 2009 (CE. Sect. 17 juillet 2009, Commune de Grenoble, n° 301615, publiée au Recueil), le Conseil d'Etat a posé le principe de l'exigence d'un permis de construire unique pour apprécier la légalité d'un ensemble immobilier unique constitué par plusieurs éléments liés physiquement ou fonctionnellement.
L'idée derrière cette position de principe qui précise la jurisprudence antérieure est que la division d'un projet en différents permis de construire successifs ne doit pas conduire à empêcher l'autorité publique d'apprécier certaines règles d'urbanisme. C'est la raison pour laquelle la décision mentionnée ci-dessus pose le principe d'une permis de construire unique mais prévoit une exception, pour certains éléments autonomes, et lorsque l'ampleur et la complexité du projet justifie, que plusieurs permis de construire soient déposés à condition que l'autorité administrative ait apprécié de manière globale les règles d'urbanisme pour l'ensemble du projet.
Néanmoins, au-delà de ce principe et de son exception, la difficulté principale tient à ce que sont « plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique », autrement dit, à la définition d'un ensemble immobilier au sens de ces dispositions.
Sur ce point, les conclusions prononcées à l'occasion de la décision Commune de Grenoble (J. Burguburu, RFDA 2009, p. 1021) et de la décision Société d'études et de réalisations immobilières et foncières 3B (CE. CHR. 28 décembre 2017, n° 406782, mentionnée aux tables ; conclusions G. Odinet, AJDA 2018 p.589), ainsi que les quelques décisions rendues dans l'intervalle par le Conseil d'Etat, permettent de mieux comprendre quels liens physiques et fonctionnels sont de nature à imposer le recours à un permis de construire unique.
● D'une part, concernant les liens physiques, il s'agit pour simplifier des hypothèses dans lesquelles les différents éléments constituent une seule et même construction sur le plan physique.
Ainsi, dans l'affaire jugée en l'espèce par le Conseil d'Etat, les deux bâtiments en cause avaient de nombreux équipements communs (voie d'entrée et de circulation interne, rampe d'accès commune à leurs parcs de stationnement respectifs, réseaux communs d'eau, d'électricité, de fibre optique, de gaz et d'éclairage collectif, équipements annexes communs : poteau incendie, boîtes aux lettres, local de stockage de conteneurs à déchets) mais cela ne suffit pas à les regarder comme un ensemble unique.
Le lien physique doit être plus important (par exemple des bâtiments qui communiquent à partir de leur premier étage et sont desservis par un escalier commun : CE. SSR. 25 septembre 1995, Mme Giron, n° 120438).
Ainsi, et en résumé, les bâtiments distincts doivent être imbriqués.
● D'autre part, concernant les liens fonctionnels, les conclusions de Mme Burguburu et M. Odinet précisent le sens stricte qu'il convient d'attribuer à cette expression.
En effet, les « liens [...] fonctionnels » peuvent recouvrir des situations particulièrement diverses, avec des liens plus ou moins ténus. Mais, à la lecture de ces conclusions et des décisions rendues en la matière il convient de l'entendre de manière restrictive.
Plus précisément, les liens fonctionnels qui exigent un permis de construire unique sont en réalité des liens juridiques et légaux : des constructions distinctes mais que le droit impose d'apprécier ensemble. Un bon exemple de cette catégorie est donnée dans ces conclusions par les parcs de stationnement qui sont généralement imposés par les plans locaux d'urbanisme. En effet, si les parcs de stationnement sont fréquemment distincts physiquement des bâtiments, ils forment du fait du lien juridique qui les unit (le parc de stationnement conditionnant la légalité de la construction du bâtiment), un ensemble immobilier unique.
C'est la raison pour laquelle Mme Burguburu qualifie dans ses conclusions le lien fonctionnel d'indivisibilité légale.
Dès lors, comme l'a déjà jugé le Conseil d'Etat et comme il le rappelle dans la décision commentée, la seule circonstance que deux constructions distinctes ne peuvent fonctionner (techniquement ou économiquement) l'une sans l'autre ne suffit pas à caractériser un lien fonctionnel (CE. CHR. 12 octobre 2016, Société WPD Energie 21 Limousin, n° 391092, mentionnée aux tables).
Aussi, dans l'affaire qui nous intéresse, il censure le raisonnement du tribunal administratif.
En effet, les nombreux liens techniques évoqué ci-dessus (voies, accès, réseaux, etc.) entre les deux bâtiments étudiés en l'espèce, et qui font que les deux bâtiments sont liés techniquement et économiquement, ne suffisent pas à les faire regarder comme ayant un lien fonctionnel.
Ils ne sont pas légalement liés, de sorte qu'ils ne le sont pas fonctionnellement. Il était dès lors possible de déposer deux permis de construire distincts pour ces deux bâtiments.
Cette décision, qui en réalité n'est qu'une application des principes posés antérieurement, permet surtout de comprendre ce qu'il convient d'entendre par liens physiques ou fonctionnels.
Il en résulte une interprétation assez stricte de ces notions, ce qui s'explique par leur objet qui est seulement d'éviter que des règles d'urbanisme soient improprement appréciées et non de se prononcer sur les liens techniques ou économiques qu'entretiennent les constructions en elles.
Construction abandonnée, affectation du bien et permis de construire
Le 30/05/2019
Par une décision n° 408743 du 28 décembre 2018, le Conseil d'Etat vient rappeler qu'une construction ancienne abandonnée a perdu son affectation de sorte que son usage initial ne peut être opposé à l'occasion d'une demande de permis de construire sur ce bâtiment.
1. Il est fréquent que les dispositions d'urbanisme soient différentes selon la destination des biens au sens du code de l'urbanisme (usage agricole, d'habitation, de commerce, etc. - voir sur ce point les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme). En effet, les exigences en termes d'aspect par exemple pourront être différentes selon le type d'usage du bien. De même, et surtout, certains usages seront interdits dans certains zones de la commune.
Bien d'autres règles sont conditionnées par l'usage de la construction mais ces quelques exemples montrent l'importance de l'affectation initiale du bien lorsqu'un pétitionnaire demande un permis de construire sur un bien, notamment lorsque sa demande le conduit à changer cette affectation.
Se pose alors parfois la question de la manière dont il convient de procéder pour apprécier l'affectation d'un bâtiment lorsque celui-ci abandonné.
En effet, lorsque le bâtiment a été abandonné, faut-il considérer que c'est sa dernière affectation qui doit être prise en compte ou faut-il considérer cette construction comme « vierge » de toute affectation ?
Le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question (CE. SSR. 20 mai 1996, n° 125012, mentionnée aux tables) et avait considéré qu'une ancienne filature, dont l'activité avait cessé depuis de nombreuses années, avait perdu sa destination industrielle. Il en avait déduit que le permis de construire demandé pour transformer le bâtiment en maison d'habitation n'emportait aucun changement de destination.
Cette solution paraissait logique dans la mesure où considérer que la construction, malgré son abandon ancien, avait conservé son affectation aurait été quelque peu artificiel.
Cependant, une décision ultérieure a semé le trouble quant à la pérennité de cette solution. En effet, le Conseil d'Etat a considéré qu'une construction dont les caractéristiques étaient propres à l'habitation devait être regardée comme y étant affectée même si elle n'était pas habitée depuis de nombreuses années (CE. SSR. 9 décembre 2011, M. Martial A c. Commune de Chanos-Curson, n° 335707, mentionnée aux tables).
C'est sans doute qui a conduit, dans l'affaire soumise en Conseil d'Etat en l'espèce, la cour à opposer à une demande de permis de construire l'usage initial de la construction, qui avait pourtant cessé depuis des décennies.
Néanmoins, dans la décision commentée le Conseil d'Etat censure ce raisonnement et vient apporter d'utiles précisions sur ces hypothèses dans lesquelles les constructions ne sont pas utilisées.
2. D'une part, il rappelle qu'en principe, l'affectation d'un bien est déterminée par son permis de construire ou par toute autorisation d'urbanisme ultérieure. En effet, le changement de destination de fait, qui n'a pas été autorisé, n'est pas pris en compte par le juge administratif en matière de règles d'urbanisme (CE. SSJS. 12 mars 2012, Commune de Ramatuelle, n° 336263).
Ainsi, s'il existe un permis de construire ou une autorisation d'urbanisme se prononçant sur l'affectation du bien, c'est cette affectation qui doit être prise en compte.
Au vu de la rédaction de la décision commentée, l'on doit considérer que dans l'hypothèse où une autorisation existe, la destination qui y figure peut être opposée à toute nouvelle de demande de permis de construire ou de changement de destination même lorsque le bien a été abandonné.
3. D'autre part, le Conseil d'Etat vient également régler l'hypothèse – qui se présente encore aujourd'hui – où le bâtiment en question, du fait de son ancienneté, n'a fait l'objet d'aucune autorisation. En effet, de nombreux bâtiments ont été édifiés à une époque où aucune autorisation n'était requise.
Dans cette hypothèse, le juge de cassation estime que, si l'affectation initiale du bien a cessé « depuis longtemps » du fait de son « abandon », alors le bâtiment est regardé comme n'ayant aucune affectation.
Dès lors, au vu de ces différentes décisions rendues par le Conseil d'Etat, la situation est désormais la suivante :
- Si le bâtiment a fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, son affectation est celle indiquée dans cette autorisation quelle que soit son affectation réelle à la date de la nouvelle demande de permis de construire ou d'autorisation d'urbanisme.
- Si le bâtiment ancien, qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation, est toujours affecté à la date de la demande, c'est cette affectation de fait qui doit être prise en compte.
- Si le bâtiment ancien, qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation, n'est plus affecté depuis peu de temps, son ancienne affectation de fait restera opposable aux autorisations sollicitées ultérieurement.
- Si le bâtiment ancien, qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation, n'est plus affecté « depuis longtemps » du fait de son « abandon », il est regardé comme n'ayant aucune affectation particulière.
La situation est donc plus claire au terme de la décision commentée (même s'il est certain que la notion de désaffectation « depuis longtemps » ne manquera pas de donner lieu à d’âpres débats devant les juges du fond).
Le 20/05/2019
Par une décision n° 402321 du 28 décembre 2018, le Conseil d'Etat vient préciser les conséquences qu'il convient de donner, après l'annulation d'un refus de permis de construire ou d'un sursis à statuer sur cette demande de permis, à une injonction de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans un délai déterminé.
En effet, en cas de silence de l'administration au terme de ce délai, et en l'absence de confirmation de la demande par le pétitionnaire, deux analyses s'opposent :
- D’un premier point de vue, il peut être considéré que la commune n’a pas déféré à l’injonction qui lui avait été faite de sorte que le pétitionnaire peut saisir le juge de l’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative pour que le juge contraigne la commune à exécuter le jugement ou l'arrêt.
- D'un second point de vue, il peut être estimé que le tribunal ayant donné un délai à la commune pour se prononcer et celle-ci ayant gardé le silence sur la demande, le pétitionnaire doit être regardé comme bénéficiant d’une décision tacite de permis de construire après l'écoulement du délai d'instruction classique sans qu'aucune confirmation de sa part ne soit nécessaire.
Avant d'évoquer le point tranché par le Conseil d'Etat dans la décision commentée, il est nécessaire de rappeler les obligations qui pèsent sur le demandeur lorsqu'il obtient l'annulation du refus de permis de construire ou du sursis à statuer qui lui a été opposé.
1. En vertu des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un refus de permis a fait l'objet d'une annulation par le juge, l'administration reste saisie de la demande initiale de permis de construire mais il appartient tout de même au pétitionnaire de confirmer cette demande.
Il dispose à cet effet d'un délai de six mois à compter du caractère définitif de l'annulation de la décision.
Ainsi, il doit la confirmer s'il souhaite que l'administration se prononce à nouveau.
2. Se pose donc nécessairement la question de l'articulation entre cette obligation et l'hypothèse dans laquelle le juge enjoint, de lui-même, à l'administration de réétudier le dossier qui lui était soumis lorsqu'il annule le refus de permis de construire.
En effet, dans cette hypothèse, que se passe-t-il en cas de silence de l'administration : faut-il considérer qu'elle a simplement méconnu l'obligation que lui avait imposée le juge (de sorte que le demandeur peut saisir le juge pour contraindre l'administration à se prononcer) ou faut-il en déduire que l'injonction a fait courir un nouveau délai d'instruction sans qu'une confirmation au sens de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne soit nécessaire (de sorte qu'un permis de construire tacite est né) ?
Telle est la question qu'avait à trancher le Conseil d'Etat dans la décision commentée.
3. Différentes juridictions du fond avaient déjà eu à se prononcer sur cette question.
Or, elles s'étaient, semble-t-il, toutes placées dans l'optique d'une inexécution par l'administration de l'injonction prononcée, ce qui ouvrait droit à des mesures plus coercitives sans permettre la naissance d'un permis de construire tacite (voir, par exemple, en ce sens : CAA Nantes, 2 décembre 2011, Epoux X. c. Commune de Campbon, n° 10NT02456 ; CAA Nantes, 16 décembre 2003, M. Guiard, n° 03NT01322 ; CAA Douai, 29 novembre 2007, Mme Gantois, n° 07DA01071 ; CAA Bordeaux, 7 juin 2012, Epoux A. c. Commune de Domme, n° 11BX02679 ; CAA Marseille, 27 mars 2015, Commune de Saint-Guiraud, n° 13MA01787).
Ainsi, et de manière générale, il était considéré qu'en l'absence de confirmation par le pétitionnaire, aucun permis de construire tacite ne pouvait naître.
4. Dans la décision commentée, le Conseil d'Etat confirme donc ces positions et vient procéder à un rappel clair des obligations respectives de l'administration et du demandeur.
D'une part, du fait de l'injonction prononcée par le juge, l'administration est tenue de réexaminer la demande et le pétitionnaire n'est pas obligé de confirmer sa demande pour que l'administration y soit obligée. En effet, l'injonction du juge dispose de sa propre force obligatoire et l'administration doit s'y conformer.
D'autre part, l'éventuelle inexécution de cette obligation ouvre simplement la possibilité au pétitionnaire de saisir le juge administratif pour qu'il fasse exécuter sa décision (autrement dit, qu'il contraigne, par une astreinte, l'administration à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire). Mais cette inexécution ne fait pas naître de permis de construire tacite.
Il reste nécessaire, pour qu'un permis de construire tacite naisse, que le pétitionnaire confirme sa demande sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.
Ainsi, par cette décision, le Conseil d'Etat ne fait que confirmer la position des cours administratives d'appel adoptée antérieurement. Néanmoins, cette confirmation par la juridiction de cassation dans une décision mentionnée aux tables était nécessaire afin de trancher définitivement cette question.