- Accueil
- Blog
Blog
Les demandeurs à la naturalisation sont-ils présumés coupables ?
Le 10/02/2021
Par un arrêt n° 19NT01942 du 3 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Nantes confirme sa position selon laquelle des poursuites qui n’ont pas donné lieu à condamnation peuvent suffire à regarder des faits, punissables pénalement, comme établis et s’opposer à la naturalisation du demandeur.
En effet, dans cet arrêt, comme dans des arrêts précédents (voir, par exemple : CAA Nantes, 26 octobre 2018, n° 18NT00049 ; CAA Nantes, 5 juillet 2016, n° 15NT02752), la cour considère que le classement sans suite d’une action pénale peut suffire à regarder des « renseignements défavorables » comme matériellement établis sur le compte d’un demandeur à la naturalisation et justifier un refus de sa demande de naturalisation.
Cette position, qui mérite d’être détaillée, suppose de rappeler la position de la Cour de cassation, sur la portée des mesures alternatives aux poursuites décidées par le parquet.
● La position de la Cour de cassation est claire quant à la portée des mesures alternatives aux poursuites (classement sans suite après régularisation, rappel à la loi, etc.).
En effet, ces mesures n’apportent aucune preuve de la matérialité des faits :
« Mais attendu, d'abord, que le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité ; » (Cass. Soc. 21 mai 2008, n° 06-44.948, publié au bulletin ; voir, dans le même sens pour une composition pénale : Cass. Soc. 13 janvier 2009, 07-44.718, publié au bulletin).
Autrement dit, une mesure telle qu’un classement sans suite pour régularisation, un rappel à la loi ou une composition pénale n’a pas d’autorité de la chose jugée et ne démontre pas, à elle seule, la matérialité des faits.
Dès lors, elle n’est pas suffisante pour regarder des faits comme établis. Une condamnation est donc nécessaire.
● Cependant, les juridictions administratives ne suivent pas cette position en matière de naturalisation et considèrent qu’un classement sans suite de poursuites suffit à regarder les faits comme établis et justifier un refus de naturalisation pour « renseignements défavorables » obtenus auprès des services de police. Ainsi, sans condamnation, les juges administratifs s'en remettent aux appréciations du parquet.
En effet, dans l’arrêt commenté, le postulant avait formé un recours contre le refus de naturalisation (voir l’article : Comment contester un refus de naturalisation ?) qui se fondait sur des renseignements défavorables, sans condamnation. Or, la cour relève, d’une part, que le classement sans suite des poursuites a eu lieu, mais au motif tiré de la régularisation de la situation du contrevenant, et, d’autre part, que les faits sont mentionnés dans cette décision de classement. Elle en déduit que ces éléments suffisent à démontrer la matérialité des faits « en l'absence d'élément contraire apporté par l'intéressée ».
Autrement dit, face au classement, qui pourtant n’est pas même un commencement de preuve, c’est au demandeur à la naturalisation de démontrer qu’il n’a pas commis les faits relevés par le procureur de la République.
C’est donc la position inverse qui est prise par les juridictions administratives par rapport aux juridictions judiciaires : ce n’est pas à l’Etat de démontrer que les faits sont établis puisque le procureur de la République les a relevés, c’est au demandeur à la naturalisation de démontrer qu’il ne les a pas commis.
Il doit apporter une preuve négative (ce qui est bien entendu impossible).
Dans les autres affaires précitées la position de la cour administrative d’appel de Nantes est la même :
D’une part, dans l’arrêt n° 18NT00049 du 26 octobre 2018, la cour considère que le classement sans suite (pour régularisation) et le rappel à la loi suffisent pour démontrer les informations défavorables détenues.
D’autre part, dans l’arrêt n° 15NT02752 du 5 juillet 2016, la cour estime que les procès-verbaux de police suffisent à établir les faits, sans qu’y fasse obstacle le classement sans suite des poursuites.
● Ainsi, selon les juridictions administratives, il est possible de tenir pour établis – sans procédure contradictoire – des faits qui ont été relatés à l’occasion de classements sans suite ou de mesures alternatives aux poursuites dépourvues de l’autorité de la chose jugée.
La cour administrative d’appel de Nantes saisie de cette question, a déjà écarte la méconnaissance de la présomption d’innocence (CAA Nantes, 5 juillet 2016, n° 15NT02752) au motif que ce moyen est inopérant, le contentieux de la naturalisation n’étant pas une accusation en matière pénale.
Il est effectivement certain que le contentieux de la naturalisation ne relève pas de la matière pénale. Mais il n’en demeure pas moins qu’il appartient de longue date au juge administratif de vérifier la matérialité des faits retenus par l’administration (CE. 14 janvier 1916, Sieur Camino, Rec. 15).
Or, en s’en remettant aveuglément aux éléments retenus explicitement (voire implicitement) par le parquet, le juge administratif ne remplit pas son office, sans même qu’il soit besoin de s’interroger sur la question de l’applicabilité de la présomption d’innocence.
La seule limite retenue par la cour administrative d’appel de Nantes est l’hypothèse dans laquelle l’administration se réfère uniquement au fichier « Système de traitement des infractions constatées » (STIC) sans faire état d’une décision du procureur de la République. En effet, dans cette seule hypothèse, elle considère que cette mention au STIC ne suffit pas à établir les faits (CAA Nantes, 12 juillet 2017, n° 16NT00913).
Toutefois, cette limite apparaît bien maigre en termes de contrôle de la matérialité des faits retenus par l’administration.
Quelle est la nature juridique d’une ordonnance non-ratifiée au-delà du délai de ratification ?
Le 30/01/2021
Par une décision n° 429132 du 1er juillet 2020, le Conseil d’Etat prend le contre-pied du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020.
En effet, dans ces deux décisions, les deux juridictions s’opposent quant à la nature juridique des ordonnances non-ratifiées au-delà du délai de ratification.
Par la décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel avait considéré, malgré la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, qu’une fois passé le délai de ratification, les dispositions de l’ordonnance « doivent être regardées comme des dispositions législatives ».
Pour ce faire, le Conseil constitutionnel s’est fondé sur le libellé de l’article 38 de la Constitution, qui prévoit : « A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. ». Il a déduit de ces dispositions que, même en l’absence de ratification, les ordonnances acquéraient un caractère législatif.
Cette position allait à l’encontre de celle du Conseil d’Etat qui considérait que ces ordonnances non-ratifiées conservaient un caractère réglementaire jusqu’à la ratification. La position ancienne du Conseil d’Etat (CE. Sect. 3 novembre 1961, Damiani, publiée au Recueil ; CE. Ass. 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police, publiée au Recueil) permettait que ces actes ne demeurent pas exempts de tout contrôle.
Dès lors, ce revirement du Conseil constitutionnel, qui donne désormais un caractère législatif aux ordonnances non-ratifiées impliquait en principe une incompétence du Conseil d’Etat pour connaître de ces ordonnances.
En effet, le Conseil d’Etat ne peut connaître de recours directs formés contre les lois. Sa compétence se limite (sous un certain nombre de réserves) au contrôle des actes réglementaires.
Dans ces conditions, cette évolution de la nature des ordonnances non-ratifiées impliquait en principe une incompétence de ce dernier.
Cependant, par la décision commentée, le Conseil d’Etat se reconnaît compétent pour se prononcer sur une ordonnance non-ratifiée en considérant implicitement que cette ordonnance est un acte réglementaire.
Dans ses conclusions, le rapporteur public Guillaume Odinet relève d’ailleurs expressément que si, selon le Conseil constitutionnel, les dispositions de l’ordonnance sont législative son « enveloppe, quelle que soit la nature de son contenu, demeure administrative ».
Ces conclusions sont d’ailleurs éclairantes sur le malaise ressenti par le Conseil d’Etat. En effet, malgré les tentatives de conciliation entre les deux positions avancées par le rapporteur public, il n’en demeure pas moins qu’elles sont frontalement opposées : soit l’ordonnance non-ratifiée est de nature législative et ne peut donc être contrôlée que par le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), soit elle est de nature réglementaire et peut être contrôlée par le Conseil d’Etat.
Certes, des considérations d’opportunité fortes mises en avant par le rapporteur public permettent de comprendre la position du Conseil d’Etat puisqu’elle permet d’éviter un recul du contrôle sur les ordonnances non-ratifiées (à tout le moins avant que le Conseil constitutionnel ne précise selon quelles modalités ces ordonnances non-ratifiées seront contrôlées).
Mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’une réelle divergence de jurisprudence.
Quels sont les effets de la naturalisation sur le statut de réfugié ?
Le 20/01/2021
Par une décision n° 423272 du 1er juillet 2020, le Conseil d’Etat vient préciser les effets de la naturalisation sur le statut du réfugié et ses conséquences pour son conjoint qui bénéficie du statut de réfugié par l’effet du principe d’unité de la famille.
Il est bien établi que l’octroi du statut de réfugié à une personne a des conséquences pour son conjoint et ses enfants mineurs.
En effet, le Conseil d’Etat juge de longue date (CE. Ass. 2 décembre 1994, Mme Mary X, n° 112842, publiée au Recueil ; CE, 25 novembre 1998, Mme Lundundu X, n° 164682, publiée au Recueil) que le « principe d’unité de la famille » a pour conséquence de donner automatiquement ce statut :
- aux enfants mineurs du réfugié,
- au conjoint du réfugié.
Par la décision commentée, le Conseil d’Etat vient régler les conséquences de la naturalisation ultérieure de la personne bénéficiant du statut de réfugié pour elle-même et pour son conjoint.
Les conséquences de la naturalisation sont différentes pour la personne bénéficiant du statut de réfugié et pour son conjoint qui a ce statut en vertu du « principe d’unité de la famille ».
1. En ce qui concerne le réfugié, les conséquences de sa naturalisation dépendent de la nationalité qu’il prend :
- S’il est naturalisé français, il perd automatiquement le statut de réfugié.
En effet, en devant français, la personne acquiert « la protection de la France » qui est due à tout citoyen. Son statut de réfugié (et donc de protection) n’a donc plus lieu d’être puisque sa qualité de Français lui assure une protection supérieure.
- S’il obtient une autre nationalité, la perte du statut de réfugié n’est pas automatique.
L’OFPRA doit alors réexaminer sa situation pour déterminer si sa protection mérite d’être maintenue.
Il est néanmoins probable que, dans la majorité des cas, le réfugié perde sa qualité. En effet, s’il obtient volontairement (par naturalisation) la nationalité d’un autre pays, il est probable que ce pays lui assure désormais sa protection en qualité de ressortissant.
Mais cela n’est pas obligatoire, car le changement de nationalité peut également résulter d’une dislocation d’Etat, d’une sécession d’un territoire ou autre. Auquel cas, le changement de nationalité subi par le réfugié pourra parfaitement n’avoir aucune incidence sur les menaces qui pèsent sur lui.
Ainsi, pour le réfugié lui-même, tout dépendra donc de la nationalité qu’il prend.
2. En ce qui concerne le conjoint du réfugié, les conséquences de l’acquisition d’une autre nationalité par son conjoint sont les mêmes qu’il s’agisse de la nationalité française ou d’une autre nationalité.
En effet, dans tous les cas, l’OFPRA devra réétudier sa situation pour déterminer s’il « doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée ».
A moins qu’il puisse se prévaloir de risques personnels, son statut suivra en principe celui du conjoint par lequel il a obtenu le statut de réfugié :
- Si son conjoint perd le statut de réfugié parce qu’il a obtenu la nationalité française ou une autre nationalité, il perdra en principe (et sauf à démontrer un risque personnel) la qualité de réfugié.
- Si son conjoint conserve son statut malgré un changement de nationalité (par exemple dans les hypothèses évoquées ci-dessus de sécession de territoire ou de dislocation d’Etat), alors le conjoint conservera, par application du principe d’unité de la famille, son statut de réfugié.
Ainsi, pour le conjoint, l’OFPRA interviendra nécessairement pour réexaminer sa situation.
Cette décision du Conseil d’Etat assez pédagogique est donc particulièrement utile car elle explique clairement les conséquences à tirer de la naturalisation du réfugié pour lui et sa famille.
Le 10/01/2021
Par une décision n° 431994 du 5 juin 2020 le Conseil d’Etat vient préciser les conditions d’appréciation de la covisibilité entre un monument historique et un bâtiment situé dans le rayon de 500 mètres autour de ce monument.
Il est nécessaire de rappeler ici que les travaux réalisés sur les bâtiments situés dans un rayon de 500 mètres autour d’un monument historique sont soumis à avis conforme de l’architecte des bâtiments de France s’ils sont en situation de « covisibilité ».
Dès lors, si un permis de construire est consenti sans cet avis alors que le bâtiment sur lesquels les travaux sont réalisés est situé dans ce périmètre et en covisibilité, alors le permis de construire est illégal.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat avait à connaître d’une hypothèse dans laquelle le monument historique et le bâtiment objet des travaux n’étaient pas visibles l’un depuis l’autre mais étaient visibles, tous deux, depuis un autre point.
Cet autre point était cependant situé en dehors du champ de visibilité de 500 mètres et supposait l’utilisation d’un appareil photo en mode zoom.
Le juge des référés du tribunal administratif avait considéré que ces prises de vues étaient suffisantes pour justifier de la covisibilité et suspendre l’exécution du permis de construire au motif que l’architecte des bâtiments de France n’avait pas été consulté.
Toutefois, le Conseil d’Etat suit le raisonnement opposé et apporte d’utiles précisions sur l’appréciation du critère de covisibilité :
- La covisibilité peut être appréciée depuis un autre point, si ce point est normalement accessible au public (autrement dit, la circonstance que les deux bâtiments soient visibles depuis une propriété privée non accessible au public n’est pas de la covisibilité au sens du code du patrimoine).
- Cet autre point peut être situé en dehors du champ de visibilité de 500 mètres autour du monument historique. Le point de vue peut donc être situé en dehors du champ de protection.
- Mais les deux bâtiments doivent être visibles à l’œil nu. Ainsi, il n’est pas possible de tenir compte de la covisibilité s’il est nécessaire d’avoir recours à des jumelles ou à un appareil photographique avec zoom. Autrement dit, le point de vue ne peut pas être situé trop loin.
Dès lors, il considère que, dans le cas d’espèce qui lui est soumis, il n’y avait pas de covisibilité au sens du code du patrimoine.
En effet, il était nécessaire, pour voir les deux bâtiments, de se placer à pris d’un kilomètre et d’utiliser le zoom d’un appareil photographique.
Dans ces conditions, et au vu des principes retenus par le Conseil d’Etat, ce dernier juge qu’il n’était pas nécessaire de consulter l’architecte des bâtiments de France.
Des parcelles construites et bitumées peuvent être inclues dans la zone A (agricole) d’un PLU
Le 30/12/2020
Par une décision n° 429515 du 3 juin 2020, le Conseil d’Etat vient préciser les conditions dans lesquelles des parcelles construites et partiellement bitumées peuvent être classées en zone A (agricole) d’un plan local d’urbanisme (PLU).
● En effet, le Conseil d’Etat considère que les communes (et, après elles, le juge) n’ont pas nécessairement à rechercher si les parcelles sont à usage agricole pour les classer en zone A.
Les communes doivent, selon le Conseil d’Etat, se référer à trois éléments :
- La « vocation du secteur » dans lequel s’insèrent les parcelles (autrement dit l’environnement dans lequel les parcelles sont situées : agricole, urbanisé, etc.),
- Le parti d’urbanisme retenu par la commune (autrement dit la volonté affichée par la commune dans son PLU, par exemple, la préservation ou l’extension des terres agricoles),
- L’existence de « constructions légères et [d’]aménagements d'ampleur limitée » sur ces parcelles (cette précision laisse supposer que si le terrain supporte des constructions importantes par leur ampleur, le terrain ne pourra pas être classé en zone A, même s’il est en plein milieu des champs).
Dès lors, la nature réelle de l’occupation des parcelles n’est que l’un des 3 éléments qui doivent être pris en compte pour apprécier si, oui ou non, elles doivent être classées en zone A du PLU.
Une telle position, si elle n’avait pas été énoncée clairement par le Conseil d’Etat auparavant, ressortait de sa jurisprudence.
Ainsi, il jugeait de manière constante que les auteurs des PLU pouvaient tenir compte « de la situation existante et des perspectives d’avenir » (CE. SSR. 3 novembre 1982, Mlle Bonnaire et a., n° 30396, publiée au Recueil).
De même, dans son contrôle du classement des parcelles dans une zone ou une autre, le Conseil d’Etat tenait compte de l’environnement de ces parcelles (voir, par exemple : CE. SSR. 22 septembre 1997, Commune de Frangy, n° 149191).
Dans ces conditions, la solution retenue ici n’apparaît pas comme révolutionnaire mais elle permet de connaître assez précisément la méthode qu’il convient d’adopter pour classer ou non une parcelle en zone A.
● Appliquant cette solution nouvelle à l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la commune de Saint-Nolff pouvait classer en zone A des parcelles partiellement construites et une parcelle artificialisée en quasi-totalité (bitumée en très grande partie).
Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil d’Etat retient trois éléments :
- Ces parcelles sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune,
- Elles sont en zone très majoritairement agricole,
- Elles disposent d’un potentiel économique en lien avec l’activité agricole (ce faisant, il reconnaît implicitement qu’elles ne peuvent servir à l’agriculture dans la mesure où elles sont construites et artificialisées, mais relève implicitement qu’elles peuvent servir pour la construction de bâtiments agricoles – puisque les bâtiments à usage agricole sont en principe autorisés en zone A).
Dès lors, par cette décision, le Conseil d’Etat confirme la possibilité de classer en zone A des parcelles qui ne sont pas à usage agricole et sont construites.
Le 20/12/2020
Par une décision n° 427781 du 3 juin 2020, le Conseil d’Etat considère qu’un permis de construire, qui impose d’obtenir une servitude de passage pour accéder à la voie publique avant le commencement des travaux, est légal.
Dans cette décision, était en cause un projet de construction de logements sur un terrain qui n’avait pas d’accès à la voie.
Ce projet n’était donc pas conforme à la réglementation en matière d’urbanisme car, pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès à la voie comme le rappellent les plans locaux d’urbanisme (PLU).
Toutefois, plutôt que de rejeter cette demande, le maire de la commune de Fréjus avait fait usage de la possibilité que lui reconnaît le code de l’urbanisme d’assortir son permis de construire d’une prescription (voir l’article : Que sont les prescriptions d’un permis de construire ?) et imposé au demandeur d’obtenir une servitude d’accès à la voie publique avant de commencer les travaux.
En effet, en vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire d’un terrain enclavé peut demander au juge judiciaire d’imposer à ses voisins de lui accorder un passage jusqu’à la voie publique.
Ce permis de construire a été contesté et le tribunal administratif l’a annulé. Le tribunal a retenu que la servitude de passage n’avait pas été obtenue (ni demandée) à la date à laquelle le permis de construire avait été délivré, de sorte que cette prescription ne permettait pas de régulariser le projet.
Ce raisonnement est censuré par le Conseil d’Etat dans la décision commentée.
En effet, il considère que cette prescription permettait de regarder le permis de construire comme conforme aux règles d’urbanisme.
D’une part, il relève explicitement que cette prescription n’entraine pas de modification substantielle du projet (étant précisé qu’une prescription ne peut conduire qu’à modifier des points précis et limités du projet – CE. Sect. 13 mars 2015, n° 358677, publiée au Recueil – voir l’article : Que sont les prescriptions d’un permis de construire ?).
D’autre part, il estime, implicitement qu’il n’est pas nécessaire que la servitude de passage ait été obtenue avant l’octroi du permis de construire.
Comme l’indique la rapporteure publique dans ses conclusions, il s’agit alors d’une autorisation « conditionnelle » possible et, dès lors, légale. L’autorisation ne pourra donc être exécutée qu’une fois la servitude de passage obtenue.
Cette solution – compréhensible sur le plan de l’opportunité – n’en est pas moins étonnante car elle ouvre la voie à l’octroi de permis de construire conditionnels, subordonnés à l’obtention d’autres autorisations.
Toutefois, cette position du Conseil d’Etat ne pourra, très certainement, pas être étendue à d’autres types d’autorisations qui, elles, sont requises par le code de l’urbanisme avant la délivrance d’un permis de construire.
Un recours est irrecevable contre la décision de reconnaître une ZNIEFF ou de la modifier
Le 10/12/2020
Par une décision n° 422182 du 3 juin 2020, le Conseil d’Etat considère que la reconnaissance d’une ZNIEFF ou sa modification ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, la reconnaissance d’une ZNIEFF n’ayant par elle-même aucune portée juridique.
Cette solution suppose de rappeler ce qu’est une ZNIEFF et quelles sont les conséquences de sa reconnaissance avant d’examiner la position prise par le Conseil d’Etat.
● Une « zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique » (ZNIEFF) est, comme le rappelle le Conseil d’Etat dans sa décision, un simple inventaire des richesses naturelles (écologiques, faunistiques ou floristiques) d’un territoire.
Cet inventaire est réalisé par le Muséum national d’histoire naturelle.
Il existe deux types de ZNIEFF :
- Les ZNIEFF de type 2 qui sont en général des grands ensembles naturels plus riches que les milieux alentours.
- Les ZNIEFF de type 1 qui sont en principe plus limitées en taille et qui abritent des espèces ou des milieux rares.
De manière schématique, la ZNIEFF de type 1 est plus précieuse d’un point de vue biologique que la ZNIEFF de type 2.
Toutefois, cette classification n’a vocation qu’à permettre de faire un inventaire.
Dès lors, leur reconnaissance n’emporte, en soi, pas de conséquences juridiques propres.
Cependant, dans la pratique, cette reconnaissance a des conséquences importantes puisque l’existence d’une ZNIEFF est un élément qui est pris en compte au titre des législations relatives à l’environnement et à l’urbanisme.
En effet, pour apprécier l’existence d’une zone à protéger et la nécessité, par exemple, de refuser un permis de construire ou une autre autorisation demandée sur le fondement du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement, le juge administratif s’intéresse nécessairement à l’existence d’une ZNIEFF.
Cela ne signifie pas que l’existence d’une ZNIEFF suffit à justifier un refus de permis de construire (voir, par exemple : CE. SSR. 15 janvier 1999, Société OMYA, n° 181652) mais sa présence est un élément qui sert parfois à justifier un refus (voir, par exemple : CE. SSR. 3 septembre 2009, Commune du Canet-en-Roussillon, n° 306298, mentionnée aux tables).
Dans ces conditions, si le classement d’un terrain en ZNIEFF n’a pas de conséquence juridique directe, c’est un élément objectif, qui renseigne sur l’intérêt écologique d’une zone et sert donc à l’application pratique des législations sur l’environnement et l’urbanisme.
● Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat avait à se prononcer sur la possibilité de contester la reconnaissance de l’existence d’une ZNIEFF ou du refus de modifier le périmètre de cette ZNIEFF.
En effet, le préfet Corse-du-Sud avait été saisi d’une demande de la commune de Piana tendant à voir le périmètre d’une ZNIEFF réduit. Le préfet ayant refusé cette demande, la commune avait saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de ce refus.
Le Conseil d’Etat considère cependant que ce refus ne peut pas être contesté.
Plus précisément, il rappelle qu’une ZNIEFF n’a qu’un objet d’inventaire et n’emporte, par elle-même, aucune conséquence juridique.
Aussi, il n’est pas possible de contester directement la reconnaissance de l’existence d’une ZNIEFF ou sa modification.
Mais cela ne signifie pas pour autant que la délimitation de cette ZNIEFF ou son existence ne peut pas être discutée à l’occasion d’un litige.
En effet, il est possible, lorsqu’une décision a été prise au titre de la législation sur l’environnement ou de l’urbanisme (par exemple un refus de permis de construire), de contester la reconnaissance de la ZNIEFF si l’administration s’est notamment fondée sur l’existence d’une ZNIEFF pour refuser une autorisation.
Cette décision du Conseil d’Etat fixe donc une ligne claire quant aux possibilités de contester l’existence d’une ZNIEFF :
- Pas de recours direct,
- Mais une possibilité de contester lorsqu’une décision se fonde sur l’existence d’une ZNIEFF.
Autrement dit, en matière de permis de construire, il faut attendre qu’un refus soit opposé en se fondant sur l’intérêt écologique du terrain pour contester une ZNIEFF. Il n’est pas possible de demander directement au juge, et préalablement au dépôt d’une demande de permis de construire, de réduire le champ de cette ZNIEFF.
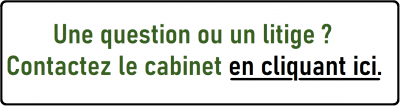
Le retrait de la naturalisation pour fraude ne crée pas d’urgence au sens du référé suspension
Le 30/11/2020
Par une ordonnance n° 440391 du 28 mai 2020, le Conseil d’Etat estime, comme il l’avait fait précédemment, que le retrait d’un décret de naturalisation pour fraude ne crée pas de situation d’urgence.
En effet, dans cette affaire était en cause le retrait d’un décret de naturalisation pour fraude, au motif que la requérante aurait obtenu, antérieurement à sa naturalisation, des titres de séjour par fraude du fait d’une reconnaissance de complaisance.
Face au retrait de son décret de naturalisation, l’intéressée avait formé un référé « suspension » sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui permet, en cas d’urgence, d’obtenir une décision rapide du juge des référés sur la légalité apparente de la décision de l’administration.
Mais dans l’ordonnance commentée, le Conseil d’Etat refuse de se prononcer sur le retrait du décret de naturalisation.
Il estime que, dans la mesure où la décision de retrait de la naturalisation « n'implique pas, par elle-même, que les intéressées soient privées de tout droit au séjour sur le territoire français », il n’y a pas d’urgence à ce qu’il se prononce.
En effet, le retrait de la naturalisation n’empêche pas obligatoirement d’obtenir un titre de séjour même si cela arrive dans certaines hypothèses. Dès lors, le Conseil d’Etat considère que le décret de retrait de la naturalisation ne crée pas de situation d’« urgence » au sens du référé.
Cette position n’est pas nouvelle car le Conseil d’Etat a déjà considéré par le passé que le retrait de la naturalisation ne créait pas de situation d’urgence : CE. Ord. 28 novembre 2017, n° 415482 ; CE. Ord. 5 juillet 2016, n° 400590.
Dès lors, au vu de la réitération de cette position, il faut considérer qu’en principe, le retrait d’un décret de naturalisation ne crée pas de situation d’urgence. De la sorte, il est nécessaire de passer par une procédure au fond (plus longue) pour contester ce retrait.
Cependant, cela ne signifie pas que dans des hypothèses très particulières, l’urgence pourrait être reconnue. Dans l’ordonnance n° 415482 du 28 novembre 2017, le Conseil d’Etat prenait d’ailleurs bien soin de vérifier que la requérante ne devenait pas apatride du fait du retrait de sa naturalisation. Cela laisse donc supposer qu’à l’inverse, si le retrait d’un décret de naturalisation rendait le requérant apatride, cela pourrait conduire à regarder la condition d’urgence comme étant remplie.